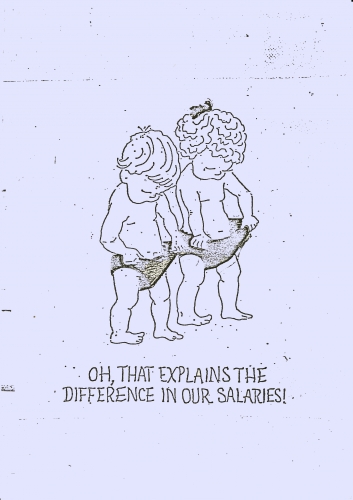lundi, 14 mars 2011
Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.
Inspiré par le tremblement de terre de Lisbonne, qui eut lieu le 1er novembre 1755, suivi d'un raz-de-marée et d'un incendie, et qui fit plus de 50 000 victimes, Voltaire exprime de manière pathétique son émotion devant le désastre et réfute les thèses optimistes. Ce courant, représenté par Leibniz, Pope et Wolf, affirme que le monde créé par Dieu est organisé par la Providence de manière à ce qu'un Mal nécessaire, en proportion infime, soit compensé par un Bien toujours plus grand.. Il va alors dénoncer le danger redoutable de ces thèses qui engendrent le fatalisme et l'inaction. « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » caricaturera-t-il dans Candide.
O malheureux mortels ! ô terre déplorable !
O de tous les mortels assemblage effroyable !
D'inutiles douleurs éternel entretien !
Philosophes trompés qui criez : " Tout est bien " ;
Accourez, contemplez ces ruines affreuses,
Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses.
Ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres dispersés :
Cent mille infortunés que la terre dévore,
Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore,
Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours
Dans l'horreur des tourments leurs lamentables jours !
Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes,
Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes,
Direz-vous : " C'est l'effet des éternelles lois
Qui d'un Dieu libre et bon nécessitent le choix " ?
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :
" Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes " ?
Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants
Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?
Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices ?
Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris.
Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,
De vos frères mourants contemplant les naufrages,
Vous recherchez en paix les causes des orages :
Mais du sort ennemi quand vous sentez les coups,
Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.
Croyez-moi, quand la terre entrouvre ses abîmes,
Ma plainte est innocente et mes cris légitimes.
Partout environnés des cruautés du sort,
Des fureurs des méchants, des pièges de la mort
De tous les éléments éprouvant les atteintes,
Compagnons de nos maux, permettez-nous les plaintes.
C'est l'orgueil, dites-vous, l'orgueil séditieux,
Qui prétend qu'étant mal, nous pouvions être mieux.
Allez interroger les rivages du Tage;
Fouillez dans les débris de ce sanglant ravage;
Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi
Si c'est l'orgueil qui crie "O ciel, secourez-moi!
O ciel, ayez pitié de l'humaine misère!"
"Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire."
Quoi! l'univers entier, sans ce gouffre infernal
Sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal?
Etes-vous assurés que la cause éternelle
Qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle,
Ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats
Sans former des volcans allumés sous nos pas?
Borneriez-vous ainsi la suprême puissance?
Lui défendriez-vous d'exercer sa clémence?
L'éternel artisan n'a-t-il pas dans ses mains
Des moyens infinis tout prêts pour ses desseins?
Je désire humblement, sans offenser mon maître,
Que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre
Eût allumé ses feux dans le fond des déserts.
Je respecte mon Dieu, mais j'aime l'univers.
Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible
Il n'est point orgueilleux, hélas! Il est sensible.
Les tristes habitants de ces bords désolés
Dans l'horreur des tourments seraient-ils consolés
Si quelqu'un leur disait: "Tombez, mourez tranquilles;
Pour le bonheur du monde on détruit vos asiles.
D'autres mains vont bâtir vos palais embrasés
D'autres peuples naîtront dans vos murs écrasés;
Le Nord va s'enrichir de vos pertes fatales
Tous vos maux sont un bien dans les lois générales
Dieu vous voit du même oeil que les vils vermisseaux
Dont vous serez la proie au fond de vos tombeaux"?
A des infortunés quel horrible langage!
Cruels, à mes douleurs n'ajoutez point l'outrage.
Non, ne présentez plus à mon coeur agité
Ces immuables lois de la nécessité
Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes.
O rêves des savants! ô chimères profondes!
Dieu tient en main la chaîne, et n'est point enchaîné
Par son choix bienfaisant tout est déterminé:
Il est libre, il est juste, il n'est point implacable.
Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable?
Voilà le noeud fatal qu'il fallait délier.
Guérirez-vous nos maux en osant les nier?
Tous les peuples, tremblant sous une main divine
Du mal que vous niez ont cherché l'origine.
Si l'éternelle loi qui meut les éléments
Fait tomber les rochers sous les efforts des vents
Si les chênes touffus par la foudre s'embrasent,
Ils ne ressentent point des coups qui les écrasent:
Mais je vis, mais je sens, mais mon coeur opprimé
Demande des secours au Dieu qui l'a formé.
Enfants du Tout-Puissant, mais nés dans la misère,
Nous étendons les mains vers notre commun père.
Le vase, on le sait bien, ne dit point au potier:
"Pourquoi suis-je si vil, si faible et si grossier?"
Il n'a point la parole, il n'a point la pensée;
Cette urne en se formant qui tombe fracassée
De la main du potier ne reçut point un coeur
Qui désirât les biens et sentît son malheur
"Ce malheur, dites-vous, est le bien d'un autre être."
De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître;
Quand la mort met le comble aux maux que j'ai soufferts
Le beau soulagement d'être mangé des vers!
Tristes calculateurs des misères humaines
Ne me consolez point, vous aigrissez mes peines
Et je ne vois en vous que l'effort impuissant
D'un fier infortuné qui feint d'être content.
Je ne suis du grand tout qu'une faible partie:
Oui; mais les animaux condamnés à la vie,
Tous les êtres sentants, nés sous la même loi,
Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.
Le vautour acharné sur sa timide proie
De ses membres sanglants se repaît avec joie;
Tout semble bien pour lui, mais bientôt à son tour
Un aigle au bec tranchant dévore le vautour;
L'homme d'un plomb mortel atteint cette aigle altière:
Et l'homme aux champs de Mars couché sur la poussière,
Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants,
Sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants.
Ainsi du monde entier tous les membres gémissent;
Nés tous pour les tourments, l'un par l'autre ils périssent:
Et vous composerez dans ce chaos fatal
Des malheurs de chaque être un bonheur général!
Quel bonheur! ô mortel et faible et misérable.
Vous criez: "Tout est bien" d'une voix lamentable,
L'univers vous dément, et votre propre coeur
Cent fois de votre esprit a réfuté l'erreur.
Eléments, animaux, humains, tout est en guerre.
Il le faut avouer, le mal est sur la terre:
Son principe secret ne nous est point connu.
De l'auteur de tout bien le mal est-il venu?
Est-ce le noir Typhon, le barbare Arimane,
Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne?
Mon esprit n'admet point ces monstres odieux
Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.
Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même,
Qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime,
Et qui versa sur eux les maux à pleines mains?
Quel oeil peut pénétrer dans ses profonds desseins?
De l'Etre tout parfait le mal ne pouvait naître;
Il ne vient point d'autrui, puisque Dieu seul est maître:
Il existe pourtant. O tristes vérités!
O mélange étonnant de contrariétés!
Un Dieu vint consoler notre race affligée;
Il visita la terre et ne l'a point changée!
Un sophiste arrogant nous dit qu'il ne l'a pu;
"Il le pouvait, dit l'autre, et ne l'a point voulu:
Il le voudra, sans doute"; et tandis qu'on raisonne,
Des foudres souterrains engloutissent Lisbonne,
Et de trente cités dispersent les débris,
Des bords sanglants du Tage à la mer de Cadix.
Ou l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race,
Ou ce maître absolu de l'être et de l'espace,
Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent,
De ses premiers décrets suit l'éternel torrent;
Ou la matière informe à son maître rebelle,
Porte en soi des défauts nécessaires comme elle;
Ou bien Dieu nous éprouve, et ce séjour mortel
N'est qu'un passage étroit vers un monde éternel.
Nous essuyons ici des douleurs passagères:
Le trépas est un bien qui finit nos misères.
Mais quand nous sortirons de ce passage affreux,
Qui de nous prétendra mériter d'être heureux?
Quelque parti qu'on prenne, on doit frémir, sans doute
Il n'est rien qu'on connaisse, et rien qu'on ne redoute.
La nature est muette, on l'interroge en vain;
On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain.
Il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvrage,
De consoler le faible, et d'éclairer le sage.
L'homme, au doute, à l'erreur, abandonné sans lui,
Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui.
Leibnitz ne m'apprend point par quels noeuds invisibles,
Dans le mieux ordonné des univers possibles,
Un désordre éternel, un chaos de malheurs,
Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs,
Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable
Subit également ce mal inévitable.
Je ne conçois pas plus comment tout serait bien:
Je suis comme un docteur, hélas! je ne sais rien.
Platon dit qu'autrefois l'homme avait eu des ailes,
Un corps impénétrable aux atteintes mortelles;
La douleur, le trépas, n'approchaient point de lui.
De cet état brillant qu'il diffère aujourd'hui!
Il rampe, il souffre, il meurt; tout ce qui naît expire;
De la destruction la nature est l'empire.
Un faible composé de nerfs et d'ossements
Ne peut être insensible au choc des éléments;
Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre,
Puisqu'il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre;
Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats
Fut soumis aux douleurs, ministres du trépas:
C'est là ce que m'apprend la voix de la nature.
J'abandonne Platon, je rejette Épicure.
Bayle en sait plus qu'eux tous; je vais le consulter:
La balance à la main, Bayle enseigne à douter,
Assez sage, assez grand pour être sans système,
Il les a tous détruits, et se combat lui-même:
Semblable à cet aveugle en butte aux Philistins
Qui tomba sous les murs abattus par ses mains.
Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue?
Rien; le livre du sort se ferme à notre vue.
L'homme, étranger à soi, de l'homme est ignoré.
Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d'où suis-je tiré?
Atomes tourmentés sur cet amas de boue
Que la mort engloutit et dont le sort se joue,
Mais atomes pensants, atomes dont les yeux,
Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux;
Au sein de l'infini nous élançons notre être,
Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.
Ce monde, ce théâtre et d'orgueil et d'erreur,
Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur.
Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être:
Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître.
Quelquefois, dans nos jours consacrés aux douleurs,
Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs;
Mais le plaisir s'envole, et passe comme une ombre;
Nos chagrins, nos regrets, nos pertes, sont sans nombre.
Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir;
Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir,
Si la nuit du tombeau détruit l'être qui pense.
Un jour tout sera bien, voilà notre espérance;
Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion.
Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison.
Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance,
Je ne m'élève point contre la Providence.
Sur un ton moins lugubre on me vit autrefois
Chanter des doux plaisirs les séduisantes lois:
D'autres temps, d'autres moeurs: instruit par la vieillesse,
Des humains égarés partageant la faiblesse
Dans une épaisse nuit cherchant à m'éclairer,
Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer.
Un calife autrefois, à son heure dernière,
Au Dieu qu'il adorait dit pour toute prière:
"Je t'apporte, ô seul roi, seul être illimité,
Tout ce que tu n'as pas dans ton immensité,
Les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance."
Mais il pouvait encore ajouter l'espérance.
VOLTAIRE
Poème sur le désastre de Lisbonne (1756)
 Voltaire envoie son texte à Rousseau le 4 juin 1756. Rousseau va lui répondre dans sa lettre sur la Providence, le 18 août 1756, où il oppose, au pessimisme voltairien, une foi optimiste en la Providence. Si le mal existe dans le monde, c'est l'homme et non Dieu qui en est responsable.
Voltaire envoie son texte à Rousseau le 4 juin 1756. Rousseau va lui répondre dans sa lettre sur la Providence, le 18 août 1756, où il oppose, au pessimisme voltairien, une foi optimiste en la Providence. Si le mal existe dans le monde, c'est l'homme et non Dieu qui en est responsable.
Vos deux derniers poèmes, Monsieur, me sont parvenus dans ma solitude, et quoique mes amis connaissent l’amour que j’ai pour vos écrits, je ne sais de quelle part ceux-ci me pourraient venir, à moins que ce ne soit de la vôtre…Je ne vous dirai pas que tout m’en plaise également, mais les choses qui m’y blessent ne font que m’inspirer plus de confiance pour celles qui me transportent….Tous mes griefs sont donc contre votre Poème sur le désastre de Lisbonne, parce que j’en attendais des effets plus dignes de l’Humanité qui paraît vous l’avoir inspiré. Vous reprochez à Pope et à Leibniz d’insulter à nos maux en soutenant que tout est bien, et vous amplifiez tellement le tableau de nos misères que vous en aggravez le sentiment : au lieu de consolations que j’espérais, vous ne faites que m’affliger ; on dirait que vous craignez que je ne voie pas assez combien je suis malheureux, et vous croiriez, ce semble, me tranquilliser beaucoup en me prouvant que tout est mal.
Ne vous y trompez pas, Monsieur, il arrive tout le contraire de ce que vous proposez. Cet optimisme que vous trouvez si cruel, me console pourtant dans les mêmes douleurs que vous me peignez comme insupportables. Le poème de Pope1 adoucit mes maux, et me porte à la patience, le vôtre aigrit mes peines, m’excite au murmure, et m’ôtant tout hors une espérance ébranlée, il me réduit au désespoir. Dans cette étrange opposition qui règne entre ce que vous prouvez et ce que j’éprouve, clamez la perplexité qui m’agite, et dites-moi qui s’abuse du sentiment ou de la raison.
" Homme, prends patience, me disent Pope et Leibniz. Tes maux sont un effet nécessaire de ta nature, et de la constitution de cet univers. Si l’Être éternel n’a pas mieux fait, c’est qu’il ne pouvait mieux faire."
Que me dit maintenant votre poème ? "Souffre à jamais, malheureux. S’il est un Dieu qui t’ait créé, sans doute il est tout-puissant ; il pouvait prévenir tous tes maux : n’espère donc jamais qu’ils finissent ; car on ne saurait voir pourquoi tu existes, si ce n’est pour souffrir et mourir." Je ne sais ce qu’une pareille doctrine peut avoir de plus consolant que l’optimisme, et que la fatalité même : pour moi, j’avoue qu’elle me paraît plus cruelle encore que le manichéisme. Si l’embarras de l’origine du mal vous forçait d’altérer quelqu’une des perfections de Dieu, pourquoi justifier sa puissance aux dépends de sa bonté ? S’il faut choisir entre deux erreurs, j’aime encore mieux la première.
Vous ne voulez pas, Monsieur, qu’on regarde votre ouvrage comme un Poème contre la providence, et je me garderai bien de lui donner nom, quoique vous ayez qualité de livre contre le genre humain un écrit où je plaidais la cause du genre humain contre lui-même. Je sais la distinction qu’il faut faire entre les intentions d’un Auteur & les conséquences qui peuvent se tirer de sa doctrine. La juste défense de moi-même m’oblige seulement à vous faire observer qu’en peignant les misères humaines, mon but était excusable & même louable à ce que je crois. Car je montrais aux hommes comment ils faisaient leurs malheurs eux-mêmes, et par conséquent comment ils les pouvaient éviter.
Je ne vois pas qu’on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, partant corrompu ; et, quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l’homme fait partie ; la plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que la nature n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également, et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre, pour vouloir prendre l’un ses habits, l’autre ses papiers, l’autre son argent ?
Vous auriez voulu, et qui ne l’eût pas voulu ! que le tremblement se fût fait au fond d’un désert. Peut-on douter qu’il ne s’en forme aussi dans les déserts, mais nous n’en parlons point, parce qu’ils ne font aucun mal aux Messieurs des villes, les seuls hommes dont nous tenions compte. Ils en font peu même aux animaux et Sauvages qui habitent épars ces lieux retirés, et qui ne craignent ni la chute des toits, ni l’embrasement des maisons. Mais que signifierait un pareil privilège, serait-ce donc à dire que l’ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelque lieu, nous n’avons qu’à y bâtir une ville ?
Il y a des événements qui nous frappent souvent plus ou moins selon les faces par lesquelles on les considère, et qui perdent beaucoup de l’horreur qu’ils inspirent au premier aspect, quand on veut les examiner de près. J’ai appris dans Zadig, et la nature me confirme de jour en jour, qu’une mort accélérée n’est pas toujours un mal réel et qu’elle peut passer quelquefois pour un bien relatif. De tant d’hommes écrasés sous les ruines de Lisbonne, plusieurs, sans doute, ont évité de plus grands malheurs ; et malgré ce qu’une pareille description a de touchant, et fournit à la poésie, il n’est pas sûr qu’un seul de ces infortunés ait plus souffert que si, selon le cours ordinaire des choses, il eût attendu dans de longues angoisses la mort qui l’est venue surprendre. Est-il une fin plus triste que celle d’un mourant qu’on accable de soins inutiles, qu’un notaire & des héritiers ne laissent pas respirer, que les médecins assassinent dans son lit à leur aise, & à qui des prêtres barbares font avec art savourer la mort ? Pour moi, je vois partout que les maux auxquels nous assujettit la nature sont moins cruels que ceux que nous y ajoutons.
[...] Pour revenir, Monsieur, au système que vous attaquez, je crois qu’on ne peut l’examiner convenablement, sans distinguer avec soin le mal particulier, dont aucun philosophe n’a jamais nié l’existence, du mal général que nie l’optimisme. Il n’est pas question de savoir si chacun de nous souffre ou non, mais s’il était bon que l’univers fût, et si nos maux étaient inévitables dans la constitution de l’univers, et au lieu de Tout est bien, il vaudrait peut-être mieux dire : Le tout est bien, ou Tout est bien pour le tout. Alors il est très évident qu’aucun homme ne saurait donner des preuves directes ni pour ni contre. Si je ramène ces questions diverses à leur principe commun, il me semble qu’elles se rapportent toutes à celle de l’existence de Dieu. Si Dieu existe, il est parfait ; s’il est parfait, il est sage, puissant et juste ; s’il est juste et puissant, mon âme est immortelle ; si mon âme est immortelle, trente ans de vie ne sont rien pour moi, et sont peut-être nécessaires au maintien de l’univers. Si l’on m’accorde la première proposition, jamais on n’ébranlera les suivantes ; si on la nie, il ne faut point disputer sur ses conséquences. Non, j'ai trop souffert en cette vie pour n'en pas attendre une autre. Toutes les subtilités de la métaphysique ne me feront pas douter un moment de l’immortalité de l’âme, et d’une Providence bienfaisante.
19:21 Publié dans à méditer, Bavardage, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
samedi, 12 mars 2011
Pétronille
Je suis une petite fille
Mais je mets des pantalons.
J'ai beau m'appeler Pétronille
J'aime mieux etre un garçon.
Quand la crémiere m'interpelle
« Bonjour ma petite demoiselle »
Expres je lui réponds
« Bonjour M'sieur Potiron. »
Quand le boucher s'écrie
« Qu'est-ce que veut aujourd'hui Ma petite escalope ? »
Je fronce les sourcils
Et lui dis : « Du persil, Mademoiselle Pénélope. »
Ça crée la confusion.
J'ai beaucoup d'caractère
Beaucoup de formation
Et sous mes petits airs
Se cache un grand garçon
Je n'aime pas les filles
Aux réflexes sanguins
Moites sous les charmilles
Et pâles dans les trains.
Quand on est un garçon
On siffle dans ses doigts
On est Ali-Baba
On grimpe sur les toits.
On s'en va sur les mers
Où y'a plein de moutons.
On vole dans les airs
Avec les électrons.
Et devant ces exploits
Tout l'monde reste baba.
« Non Maman, pas ma robe, je veux mon pantalon
Ma ceinture de cuir, mon colt, mes munitions
Je vais faire un hold-up
A Plessis-Robinson. »
René de Obaldia
Innocentines
22:30 Publié dans coup de coeur, femmes, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
mardi, 08 mars 2011
MOI, CHRISTINE, QUI AI PLEURÉ
 Christine de Pisan (Venise vers 1363 - vers 1430) est la première femme à vivre de sa plume.
Christine de Pisan (Venise vers 1363 - vers 1430) est la première femme à vivre de sa plume.
Christine de Pizan est née à Venise, vraisemblablement en 1364. Son père, Tommasso di Benvenuto, originaire de Pizzano, près de Bologne, a étudié la médecine dans cette ville et y a enseigné l’astrologie, avant de devenir conseiller de la république de Venise. Peu après la naissance de Christine, il est appelé à Paris par Charles V comme médecin et astrologue. Très en faveur auprès du roi qui rétribue largement ses services, il fait venir sa famille d’Italie vers 1368. Christine reçoit de lui une instruction plus poussée qu’il n’était d’usage, jusqu’à son mariage, en 1379 ou 1380, avec Étienne du Castel, secrétaire du roi. La mort de Charles V, en 1380, affecte gravement la position de Thomas: il meurt dans la gêne vers 1387. Le mari de Christine s’éteint peu après, à l’automne 1390.
Veuve à 25 ans, Christine de Pisan reste seule avec sa mère et ses trois enfants, aux prises avec des débiteurs indélicats, en butte aux attaques des créanciers qui veulent lui enlever les biens hérités de son père, Thomas di Pizzano, et de son mari, Étienne de Castel. Elle se bat courageusement, défend sa famille, et réussit à éviter la ruine complète.
"Je suis veuve, seulette et noir vêtue
A triste vis simplement affublée ;
En grand courroux de manière adoulée
Porte le deuil très amer qui me tue.
De triste coeur, chanter joyeusement
Et rire en deuil, c’est chose forte à faire."
Christine de Pisan ne perd pas courage. Dès la mort de son père, elle cherche à se créer des ressources par ses talents. Le succès des poésies légères qu'elle a composées avec facilité la persuade de s'essayer à des écrits plus sérieux. Mais avant de rien entreprendre, elle se remet, pendant plusieurs années à l'étude des meilleurs auteurs anciens et modernes, qu'elle lit dans leur langue. "Tu ne dois pas te tenir pour malheureuse quand tu as, entre autres biens, une des choses du monde qui te cause le plus de délices et de plaisirs, c’est assavoir le doux goût de science." Ecrit-elle, ou encore "Ce n’est pas à la faiblesse de son esprit, mais à son manque d’instruction que la femme doit son infériorité."
A l’exception des lettres d’Amour d’Héloïse, de quelques oeuvres de nonnes érudites, les ouvrages littéraires écrits par des femmes sont rares. On peut donc dire que Christine de Pisan a été en France la première des femmes savantes et des femmes auteures. C'est d'ailleurs grâce à ses œuvres, riches en confidences autobiographiques, que son existence passablement mouvementée et son parcours littéraire sont relativement bien connus en France. Sa production est considérable. Elle en fait le bilan en 1405, dans le Livre de l’advision : "Depuis l’an 1399 que je commençai jusqu’à cette année 1405 auquel encore je ne cesse, j’ai compilé quinze volumes principaux sans les autres petits dictés, lesquels tout ensemble contiennent environ soixante-dix cahiers de grand volume."
Mais quoique ses diverses productions fussent toujours aussi bien accueillies par la cour et les lettrés, elles suffisent à grand-peine à la subsistance de la famille de Christine de Pisan. Heureusement, elle a nombre de mécènes pour qui elle compose poèmes, éloges et panégyriques. On rapporte aussi que Henri IV d'Angleterre lui offrit de se fixer à sa cour; mais elle ne se laisse pas séduire, et elle préfère rester avec peu d'aisance en France. Mais le premier poème de Christine, l’Épître au dieu d’Amour, écrit en 1399, sera traduit outre-Manche, dès 1402, par Thomas Occleve, lui-même auteur de renom.
 En 1399, le maréchal Jean II Le Maingre (en vieux français , Jehan le Meingre), appelé Boucicaut, fonde l'ordre de chevalerie L'Ecu vert à la Dame blanche un ordre chevaleresque inspiré par l'idéal de l'amour courtois dont la vocation est la défense des femmes. L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, préside à la création de la fameuse "cour d'Amour" qui débat de casuistique amoureuse et se réunit à la Saint-Valentin pour un tournoi poétique en l'honneur des dames. Au même moment, en 1399, Christine se lance dans la polémique littéraire pour défendre les femmes, qui s'achèvera en 1405 par la rédaction de deux traités, la Cité des dames, suivi du Livre des Trois Vertus (ou Trésor de la Cité des Dames), véritable cours d'éducation à l'usage des femmes où la "dame" est une femme dont la noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. Christine y fait une analyse lucide et précise de la société française, vue du côté féminin, détaillant tous les "états des femmes" et donnant de chacun, depuis celui des princesses jusqu’à celui des femmes de laboureur, une vision réaliste et positive. La première, elle a compris que les femmes ont une place à elles dans la société politique, et avec l'aide de Dame Raison, Droiture, Justice, elle veut construire la Cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies
En 1399, le maréchal Jean II Le Maingre (en vieux français , Jehan le Meingre), appelé Boucicaut, fonde l'ordre de chevalerie L'Ecu vert à la Dame blanche un ordre chevaleresque inspiré par l'idéal de l'amour courtois dont la vocation est la défense des femmes. L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, préside à la création de la fameuse "cour d'Amour" qui débat de casuistique amoureuse et se réunit à la Saint-Valentin pour un tournoi poétique en l'honneur des dames. Au même moment, en 1399, Christine se lance dans la polémique littéraire pour défendre les femmes, qui s'achèvera en 1405 par la rédaction de deux traités, la Cité des dames, suivi du Livre des Trois Vertus (ou Trésor de la Cité des Dames), véritable cours d'éducation à l'usage des femmes où la "dame" est une femme dont la noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. Christine y fait une analyse lucide et précise de la société française, vue du côté féminin, détaillant tous les "états des femmes" et donnant de chacun, depuis celui des princesses jusqu’à celui des femmes de laboureur, une vision réaliste et positive. La première, elle a compris que les femmes ont une place à elles dans la société politique, et avec l'aide de Dame Raison, Droiture, Justice, elle veut construire la Cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies
Dans ces ouvrages la narratrice veut combattre les clichés qui circulent sur les femmes et leur infériorité "naturelle", en particulier dans des œuvres misogynes et cyniques comme la seconde partie du Roman de la rose (entre 1275 et 1280) de Jean de Meung, qui s’avère l’antithèse de la première partie écrite par Guillaume de Lorris (vers 1245). La quête amoureuse de la première partie a complètement disparu, en revanche, le mépris de la Femme y est ouvertement affiché et Christine de Pisan estime qu'on est passé d’un culte raffiné de la femme à la conception grossière qui va peu à peu faire d’elle un objet.: "Toutes êtes, serez et fûtes/De fait ou de volonté putes" écrit-il !
Christine de Pisan, qui connaît le latin, a aussi lu Les Lamentations de Matheolus, où l'auteur Matthieu de Boulogne-sur-Mer (vers 1260 – vers 1320) présente sa femme Péronnelle (eh oui, ce serait l'origine du mot ...) sous un jour très noir. Ces œuvres la remplissent d’horreur pour elle-même, "et pour le sexe féminin dans son entier, comme si nous étions des monstres de la nature". Jean Le Fèvre, officier au parlement de Paris qui a traduit les Lamentations de Matheolus, s'est lui aussi insurgé contre les propos misogynes, fréquents dans la littérature et a écrit Le Livre de leesce, sorte d'apologie de ce sexe que l'on dit faible, et qui présente pour la première fois Neuf Preuses,
 La Cité des dames n’est d'ailleurs pas le premier texte féministe de Christine de Pisan ; elle a déjà rédigé quelques années auparavant une Epistre au Dieu d’Amours (1399), une protestation contre les habitudes discourtoises de la société devenue misogyne, et une tentative de réhabilitation de la Femme comme un être moral : "Que les femmes aient de tels vices je le nie ; Je lève les bras pour les défendre …", et un Dit de la rose (14 février 1401, anc. st.), critique justement de la seconde partie du Roman de la rose, ce qui provoque, entre 1401 et 1405, un "débat sur le Roman de la Rose" avec des secrétaires du roi, Jean de Montreuil, prévôt de Lille, et Gontier Col, secrétaire et conseiller du roi, et des clercs, Pierre Col, frère du précédent et chanoine de Paris et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris.
La Cité des dames n’est d'ailleurs pas le premier texte féministe de Christine de Pisan ; elle a déjà rédigé quelques années auparavant une Epistre au Dieu d’Amours (1399), une protestation contre les habitudes discourtoises de la société devenue misogyne, et une tentative de réhabilitation de la Femme comme un être moral : "Que les femmes aient de tels vices je le nie ; Je lève les bras pour les défendre …", et un Dit de la rose (14 février 1401, anc. st.), critique justement de la seconde partie du Roman de la rose, ce qui provoque, entre 1401 et 1405, un "débat sur le Roman de la Rose" avec des secrétaires du roi, Jean de Montreuil, prévôt de Lille, et Gontier Col, secrétaire et conseiller du roi, et des clercs, Pierre Col, frère du précédent et chanoine de Paris et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris.
De ce "débat", on peut citer une lettre de Christine de Pisan adressée à Jean de Montreuil. La lettre répond à l’éloge du Roman de la Rose de Jean de Meung que Jean de Montreuil a écrit et fait circuler dans un petit traité aujourd’hui perdu, Opusculum gallicum. La correspondance qui en résulte provoque le premier débat épistolaire connu dans le monde littéraire français! Prenant le contre-pied de Montreuil, Christine attaque méthodiquement le Roman de la Rose de Jean de Meung comme un ouvrage immoral, misogyne et obscène, l'accusant d'enseigner les moyens de séduire les femmes sous le couvert d'un art d'aimer ... "Une honnête femme est aussi rare qu’un cygne noir" écrit Jean de Meung ! "Le talent de Christine de Pisan aidant, écrit Jean Favier dans sa Guerre de Cent Ans (où Christine n’est citée que trois fois ...), tout Paris se passionnait pour la grande querelle soulevée autour des thèses de l’antiféminisme clérical et du cynisme sentimental formulé au XIIIe siècle par le vieux Roman de la Rose. On était pour le Roman […] ou bien on était contre cette satire acerbe du naturel féminin qui avait fait la joie de générations d’hommes et particulièrement de clercs. Dans son Épître au dieu d’amour, Christine de Pizan se fit, en 1399, la théoricienne d’un équilibre entre les élans du cœur et le plaisir des sens."
 Jean de Montreuil obtient le soutien de son collègue Gontier Col qui attaque vivement Christine dans deux épîtres lui demandant ouvertement de retirer ses affirmations qui, d'après lui, constituent une insulte à la plus grande œuvre littéraire contemporaine. "Folle outrecuidance. Parole trop tôt issue sans avis de la bouche d'une femme", s'écrie Pierre Col, le frère de Gontier. Jean de Montreuil, lui, menace : "Si tu continues à mal parler, sache qu'il y a des champions et des athlètes". Dans le débat, Christine peut compter sur l'appui de Jean de Gerson, auteur d'une Vision contre le Roman de la Rose, de Eustache Moel dit Deschamps, conseiller de Louis d'Orléans, de Guillaume de Tignonville, prévot de Paris, mais aussi de la Reine Isabeau de Bavière à qui elle a fait parvenir une lettre lui demandant son soutien. Quelques années plus tard, Mathieu Thomassin lui rendra hommage dans son Registre Delphinal, Martin Le Franc ne tarira pas d'éloge dans son Champion des Dames (1442). Plus tard Jean Boucher composera Le Jugement poétique de l'honneur féminin et sejour des illustres claires & honnestes Dames (1538), et enfin Clément Marot se fera l'interprète des mêmes sentiments dans La vray disant advocate des Dames
Jean de Montreuil obtient le soutien de son collègue Gontier Col qui attaque vivement Christine dans deux épîtres lui demandant ouvertement de retirer ses affirmations qui, d'après lui, constituent une insulte à la plus grande œuvre littéraire contemporaine. "Folle outrecuidance. Parole trop tôt issue sans avis de la bouche d'une femme", s'écrie Pierre Col, le frère de Gontier. Jean de Montreuil, lui, menace : "Si tu continues à mal parler, sache qu'il y a des champions et des athlètes". Dans le débat, Christine peut compter sur l'appui de Jean de Gerson, auteur d'une Vision contre le Roman de la Rose, de Eustache Moel dit Deschamps, conseiller de Louis d'Orléans, de Guillaume de Tignonville, prévot de Paris, mais aussi de la Reine Isabeau de Bavière à qui elle a fait parvenir une lettre lui demandant son soutien. Quelques années plus tard, Mathieu Thomassin lui rendra hommage dans son Registre Delphinal, Martin Le Franc ne tarira pas d'éloge dans son Champion des Dames (1442). Plus tard Jean Boucher composera Le Jugement poétique de l'honneur féminin et sejour des illustres claires & honnestes Dames (1538), et enfin Clément Marot se fera l'interprète des mêmes sentiments dans La vray disant advocate des Dames
La querelle s'apaise peu à peu. Dans sa dernière lettre à Pierre Col datée du 2 octobre 1402, elle annonce qu'elle se retire du débat : "Non mie tairé pour doubte de mesprendre quant a oppinion, combien que faulte d'engin et de savoir me toult biau stile, mais mieulx me plaist d'excerciter en autre matiere a ma plaisance" [Je ne me tais pas non plus par peur d'être calomniée à cause de mes opinions, bien que je manque d'intelligence et d'un beau style. Je souhaite simplement me tourner vers un sujet qui me plaît davantage.] Christine sent très clairement que le Débat est une perte de temps pour quelqu'un qui a des affaires plus importantes à traiter. Et Philippe Le Hardi, duc de Bourgogne, qui fait confiance à son talent et son jugement, lui demande en 1404 d’écrire le récit du règne son frère, le Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V.
Mais si dans le Livre de Mutacion de Fortune (1403), Christine de Pisan avoue comment le destin, en la faisant devenir écrivain, l'a fait changer de sexe : "de femelle devins masle", elle n'oubliera cependant jamais qu'elle doit défendre, contre les injustices de la société masculine, la dignité de son sexe. Ainsi, en 1405, paraît le Livre de la Cité des Dames ...
1405 marque une rupture. La situation politique en France devient de plus en plus grave, lucide, Christine voit monter le péril de la guerre civile. Les misères du temps, ravagé par la Guerre de Cent ans, expliquent que Christine de Pizan, Italienne devenue Française, ait senti le besoin d’exprimer son patriotisme, en participant, grâce à ses œuvres, aux douleurs publiques : en 1405 le Livre de la Prudence, paraphrasé de Sénèque, et le Trésor de la cité des dames, également appelé le Livre des trois vertus, dédié à la jeune dauphine de France Marguerite de Bourgogne, et dans lequel elle attire l’attention des femmes sur les conflits perpétuels que les hommes se livrent dans leur royaume, en 1407, le Livre du corps de policie (le mot "policie" désignant celui de politique) emprunté d’Aristote et de Plutarque, en 1410 le Livre des fais d’armes et de chevalerie, traité de guerre traduit principalement de Végèce, de Frontin, mais renfermant toutefois une partie originale, un code du droit des gens dans la société féodale, et Lamentation sur les maux de la France, et en 1413 le Livre de la paix, tous ces ouvrages ont désormais un but, sauver la France des divisions.
Elle emploie aussi d’excellents artistes pour illustrer ses livres, dont un grand recueil de ses oeuvres qui est offert à la reine Isabeau de Bavière en 1414. Ce manuscrit des Œuvres de Christine de Pisan (Londres, British Library, Harley 4431) est l'un des plus somptueux, des plus connus et des plus étudiés parmi ceux qui ont été réalisés à Paris en pleine apogée de l'enluminure parisienne.
 La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons conduit à l’intervention étrangère. Ainsi, en 1415, c’est la terrible bataille d’Azincourt. Christine écrit une Epître de la prison de la vie humaine, dans laquelle elle déplore les bouleversements de la guerre et le comportement des Anglais, qui massacrent leurs prisonnier. Christine de Pisan fuit Paris, occupé par le parti bourguignon allié aux Anglais, et se réfugie dans un couvent, probablement l’abbaye des dominicaines de Saint-Louis de Poissy où sa fille est religieuse et dont la sœur de Charles VII, Marie, est devenue prieure. Elle consacre alors la fin de sa vie à un ouvrage d'inspiration purement religieuse, Les Heures de contemplation sur la Passion de Notre Seigneur, un livre pour les femmes, accablées comme elle, par les maux du temps. Mais après la prise de Paris par les Bourguignons et le traité de Troyes, elle sort du silence et écrit Les Lamentations sur les maux de la guerre civile (1420) inspiré par l’actualité de la guerre de Cent Ans :.
La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons conduit à l’intervention étrangère. Ainsi, en 1415, c’est la terrible bataille d’Azincourt. Christine écrit une Epître de la prison de la vie humaine, dans laquelle elle déplore les bouleversements de la guerre et le comportement des Anglais, qui massacrent leurs prisonnier. Christine de Pisan fuit Paris, occupé par le parti bourguignon allié aux Anglais, et se réfugie dans un couvent, probablement l’abbaye des dominicaines de Saint-Louis de Poissy où sa fille est religieuse et dont la sœur de Charles VII, Marie, est devenue prieure. Elle consacre alors la fin de sa vie à un ouvrage d'inspiration purement religieuse, Les Heures de contemplation sur la Passion de Notre Seigneur, un livre pour les femmes, accablées comme elle, par les maux du temps. Mais après la prise de Paris par les Bourguignons et le traité de Troyes, elle sort du silence et écrit Les Lamentations sur les maux de la guerre civile (1420) inspiré par l’actualité de la guerre de Cent Ans :.
Retirée depuis une dizaine d'années elle écrit son Ditié de la Pucelle, saluant l’épopée de Jeanne d’Arc qui venait de faire sacrer le roi (1429); ce sont les derniers vers qu'on a d'elle ... Christine de Pizan meurt en 1430.
 Estimée des meilleurs écrivains de son temps, Christine de Pisan a joui jusqu’au début du XVIe siècle d’une grande réputation en France et dans plusieurs pays d’Occident, où certaines de ses oeuvres ont été traduites. Par la suite, elle plutôt maltraitée. Au XIXeme siècle, Gustave Lanson, historien de la littérature et critique littéraire, mais aussi témoin par excellence de la misogynie qu’il était de bon ton d’afficher à la fin du XIXe siècle, aura même ce jugement dans son Histoire de la littérature française : "Ne nous arrêtons pas à l’excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas-bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n’ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité"
Estimée des meilleurs écrivains de son temps, Christine de Pisan a joui jusqu’au début du XVIe siècle d’une grande réputation en France et dans plusieurs pays d’Occident, où certaines de ses oeuvres ont été traduites. Par la suite, elle plutôt maltraitée. Au XIXeme siècle, Gustave Lanson, historien de la littérature et critique littéraire, mais aussi témoin par excellence de la misogynie qu’il était de bon ton d’afficher à la fin du XIXe siècle, aura même ce jugement dans son Histoire de la littérature française : "Ne nous arrêtons pas à l’excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas-bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n’ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité"
Certes elle n’a jamais été totalement oubliée, mais son œuvre est bien souvent réduite à la trop célèbre ballade Seulete sui et seulete veuil estre. Il faudra attendre Mathilde Laigle, l'une des premières bachelières françaises et également des premières femmes diplômées de l'enseignement supérieur américain et qui fut la première à avoir publié en 1912 une édition critique du Livre des Trois vertus de Christine de Pisan, Le livre des trois vertus de Christine de Pisan et son milieu historique et littéraire, pour qu'on commence à reconnaître timidement son intérêt historique et politique.
Mathilde Laigle écrit que "Les revendications qu'elle propose par le respect de l'usage, la pratique, les devoirs, le culte de l'honneur, tels qu'une femme sensée et vertueuse les concevait au XVe siècle. Il semble que l'antiféministe le plus convaincu ne pourrait que gracieusement s'incliner devant le féminisme de Christine de Pisan", mais ajoute que Christine de Pisan ne formule aucune des revendications que l'on pourrait à proprement appeler qualifier de féministes : "Le livre des Trois Vertus, tout attaché aux devoirs et non aux droits de la femme, ne porte aucune trace de ces timides protestations, et si Christine nourrissait quelques secrètes velléités de révolte contre le sort injuste réservé à ses sœurs, nous n'en savons rien. Elle n'en parle pas. La Cité des dames nous fournirait aussi bien son contingent d'idées anti-féministes.", ajoutant "Ce que Christine prêche, ce n'est pas le murmure, la rébellion contre les lois ou usages établis, c'est l'énergie personnelle, l'effort constant pour parer au mal : l'éviter, si possible, l'atténuer, si on ne peut l'anéantir, ou le subir avec courage, s'il est plus fort que la volonté humaine.". Pourtant les réactions à ses travaux sont parfois rudes : lors d'une conférence en 1912 à Strasbourg, Mathilde Laigle est interrompue par une personne de l'assistance qui lance à propos de Christine de Pisan : "Elle aurait mieux fait de se trouver un autre mari et de s'occuper des gamins" !
Il faudra donc attendre la seconde moitié du XXeme siècle, la naissance des sentiments féministes et le désir de réhabiliter la femme dans la littérature pour que son œuvre prenne vraiment place dans le milieu des études littéraires.
Certes si elle écrivait aujourd'hui, Christine de Pisan, soucieuse de sauvegarder les vertus féminines plus que de prôner liberté et émancipation, passerait pour une traîtresse à la cause féminine, prompte à ramper sous les fourches caudines du mâle ! En effet, si le discours de Christine de Pisan vise à préserver l'intégrité des femmes en tant que jeunes filles et jeunes femmes, il ne préconise pas vraiment une révolte par rapport à leur condition. Christine de Pisan encourage les femmes à se prendre en main afin de défendre et protéger leur honneur, les hommes n’en étant plus capables. Christine ne défend pas les femmes, mais leur honneur, la réalité de leurs capacités intellectuelles, de leur grandeur morale, de leur vertu. Jamais elle ne remet en cause la distribution des rôles des hommes et femmes dans la société. Il est donc délicat de la considérer comme féministe. Mais Christine de Pisan est surtout originale par le fait même qu'elle a pris la première la parole au nom des femmes, contre le flot de méchancetés que déversaient les écrivains de son temps, une position particulièrement inédite à l'époque, suffisamment provocatrice pour que nombre d'érudits l'aient aussitôt combattu.
En tous les cas, 550 ans avant le fameux "on ne naît pas femme, on le devient" de Simone de Beauvoir, Christine de Pisan attribue l'inégalité entre hommes et femmes non à la nature, mais à l'éducation et aux représentations d'elles-mêmes fournies aux femmes par le discours misogyne dominant.
Moi, Christine, qui ai pleuré
Onze ans en abbaye fermée,
Ou j'ai toujours demeuré depuis
Que Charles (c'est chose étrange !)
Le fils du roi, si j'ose rappeler ce souvenir,
S'enfuit de Paris, tout droit,
Par suite de la trahison là incluse :
Maintenant pour la première fois je me prends à rire.
L'an mil quatre cent vingt neuf
Recommença à luire le soleil ;
Il ramène le temps nouveau
Qu'on n'avait pas vu de l'oeil
Depuis longtemps ; dont plusieurs en deuil
Ont vécu. Je suis de ceux-là ;
Mais de rien je ne me chagrine plus,
Puisque maintenant je vois ce que je veux.
Qui vit donc chose advenir
Plus hors de toute atteinte,
Laquelle à noter et de laquelle se souvenir
Est bon en toute région :
C'est à savoir que France, de qui discours,
On faisait qu'à terre était renversée,
Soit par divine mission,
Du mal en si grand bien changée ?
Et cela par tel miracle vraiment
Que, si la chose n'était notoire
Et évidents le fait et la manière,
Il n'est homme qui pût le croire :
C'est une chose bien digne de mémoire
Que Dieu par une vierge tendre
Ait précisément voulu (c'est une chose vraie)
Sur la France si grande grâce étendre.
O ! Quel honneur à la couronne
De France se voit par divine preuve !
C'est par les grâces qu'il lui donne
Il paraît combien Dieu l'approuve
Et que plus de foi d'autre part il trouve
En la maison royale, dont je lis
Que jamais (ce n'est pas une chose nouvelle)
En la foi errèrent les fleurs de lis.
Toi, Jeanne, à une bonne heure née,
Béni soit celui qui te créa !
Pucelle de Dieu envoyée
En qui le Saint Esprit fit rayonner
Sa grande grâce ; et qui eus et as
Toute largesse en son haut don,
Jamais ta requête ne te refusa
Et il te donnera assez grande récompense...
Et sa belle vie, par ma foi !
Montre qu'elle est en la grâce de Dieu,
C'est pourquoi on ajoute plus de foi
A son fait ; car, quoi qu'elle fasse,
Toujours à Dieu devant la face,
Qu'elle invoque, sert et prie
En actions, en paroles ; en quelque endroit qu'elle aille,
Elle ne retarde pas ses dévotions.
Oh ! comme alors cela bien parut
Quand le siège était à Orléans,
Où en premier lieu sa force apparut !
Jamais miracle, ainsi que je pense,
Ne fut plus clair ; car Dieu aux siens
Vint tellement en aide, que les ennemis
Ne se défendirent pas plus que chiens morts.
Là furent pris ou à mort mis.
Hé ! quel honneur au féminin
Sexe ! Que Dieu l'aime il paraît bien,
Quand tout ce grand peuple misérable comme chiens
Par qui tout le royaume était déserté
Par une femme est ressuscité et a recouvré ses forces,
Ce que hommes n'eussent pas fait,
Et les traîtres ont été traités selon leur mérite,
A peine auparavant l'auraient-ils cru.
Une fillette de seize ans
(N'est-ce pas une chose au-dessus de la nature ?)
A qui les armes ne sont pesantes,
Mais il semble que son éducation
Ait été faite à cela, tant elle y est forte et dure ;
Et devant elle vont fuyant
Les ennemis, et nul n'y résiste.
Elle fait cela, maint yeux le voyant.
Et elle va d'eux débarrassant la France
En recouvrant châteaux et villes,
Jamais force ne fut si grande,
Qu'ils soient par centaines ou par milliers...
09:08 Publié dans art, coup de coeur, femmes, Histoire, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
lundi, 14 février 2011
Fantasmes de demoiselles ...
14 février, fête des "amoureux". Mais Cupidon n'a pas encore fait chavirer votre cœur, et vous avez beau jouer les célibataires faussement désinvoltes et vous dire que la Saint-Valentin c’est naze, ringard, commercial ... depuis ce matin vous lorgnez sur le parfum super-sexy ou le bouquet de rose qu'on ne vous offrira pas aujourd'hui.
Alors pourquoi ne pas passer quelques petites annonces. Je vous en propose quelques unes émises par des femmes faites et défaites cherchant l'âme sœur, fantasmes de demoiselles recueillies par René de Obaldia. Ce livre est un petit bijou de drôlerie et, mon dieu, de connaissance des femmes !
 Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme
Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme
Cherche beau jeune homme
Aimant croquer la pomme
Beau comme un troubadour
Quand il me fera l'amour
(La nuit, propice à l'obscurité
Et a moult voluptés)
En son habit de velours
Sa mandoline à côté
Toutes les étoiles se mettront à pleurer
Cherche jeune et beau curé
Tout prêt à se défroquer
Quand il me verra passer
Bouleverd Agrippa d'Aubigné
 Cherche beau jeune homme avec caniche
Cherche beau jeune homme avec caniche
Cherche beau jeune homme avec caniche
Tout noir tout frisé
(Pas le jeune homme, mais le caniche)
Haut sur pattes, gueule distinguée
Amoureux de ma personnalité
Cherche un garde-chasse
Ni beau ni laid
Mais doté d'un membre efficace
Tel l'amant de Lady Chatterley
Cherche un malabar
Plaçant très haut la barre :
Trois Porsche, un sous-marin
Hôtel de luxe avec pingouins
Pédicure mexicain
Palanquin à Pékin
Case de bambou a Ouagadougou
Des tonnes et des tonnes de bagages
Et un tueur a gages.
Reçu par tous les Présidents
Du plus noir jusqu'au plus blanc
Avec tous les honneurs
Toute la raideur
Dus a son rang.
Et moi, sa ravissante épouse
Des perlouzes, des perlouzes, des perlouzes ...
Tant les hommes sont cons cherche une femme exquise
Douceur de lait, manière de Marquise
Tempérament de pharaon
René de Obaldia
Fantasmes de Demoiselles, femmes faites ou défaites cherchant l'âme soeur de (2006) chez Grasset
Bon, si vous n'avez pas celle qui vous convient, il y a encore quarante-cinq "petites-annonces" !
Et si l'an prochain, il n'est pas sûr que vous y gagniez roses, bijoux, lingerie fine et mots doux, au moins aurez-vous eu pendant un an battements de cœur affolés, soupirs d’extase, étreintes moites et souvenirs brûlants !
16:01 Publié dans art, coup de coeur, femmes, litterature, peinture, poèmes, rire, traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
samedi, 05 février 2011
Un champ d'îles
Savoir ce qui dans vos yeux berce
Une baie de ciel un oiseau
La mer, une caresse dévolue
Le soleil ici revenu
Beauté de l'espace ou otage
De l'avenir tentaculaire
Toute parole s'y confond
Avec le silence des Eaux
Beauté des temps pour un mirage
Le temps qui demeure est d'attente
Le temps qui vole est un cyclone
Où c'est la route éparpillée
L'après-midi s'est voilé
De lianes d'emphase et fureur
Glacée, de volcans amenés
Par la main à côté des sables
Le soir à son tour germera
Dans le pays de la douleur
Une main qui fuse le Soir
À son tour doucement tombera
Beauté d'attente Beauté des vagues
L'attente est presque un beaupré
Enlacé d'ailes et de vents
Comme un fouillis sur la berge
Chaque mot vient sans qu'on fasse
À peine bouger l'horizon
Le paysage est un tamis soudain
De mots poussés sous la lune
Savoir ce qui sur vos cheveux
Hagard étrenne ses attelages
Et le sel vient-il de la mer
Ou de cette voix qui circule
Abandonnés les tournoiements
D'aventure sur les tambours
L'assaut du sang dans les plaines
Son écume sur les Hauts
Abandonné le puits de souffrance
La souffrance au large du ciel emporte
Dans la foule des fromagers
Sa meute de mots et sa proie
Abandonnée tarie la mesure
Démesure des coutelas
Cette musique est au coeur
Comme un hameau de lassitude
Beauté plus rare que dans l'île
Ton grand chemin des hébétudes
Va-t-il enfouir son regard
Dans la terre, humide douce
Les hommes sortent de la terre
Avec leurs visages trop forts
Et l'appétit de leurs regards
Sur la voilure des clairières
Les femmes marchent devant eux
L'île toute est bientôt femme
Apitoyée sur elle-même mais crispant
Son désespoir dans son coeur nu
Et parmi les chants de midi
Ravinés de sueurs triomphales
Sur un cheval vient à passer
La morte demain la Pitié
L'île entière est une pitié
Qui sur soi-même se suicide
Dans cet amas d'argiles ruées
Ô la terre avance ses vierges
Apitoyée cette île et pitoyable
Elle vit de mots dérivés
Comme un halo de naufragés
À la rencontre des rochers
Elle a besoin de mots qui durent
Et font le ciel et l'horizon
Plus brouillés que les yeux de femmes
Plus nets que regards d'homme seul
Ce sont les mots de la Mesure
Et le tambour à peine tu
Au tréfonds désormais remue
Son attente d'autres rivages
L'après-midi le Soir les masures
Le poing calé dans le bois dur
La main qui fleurit la douleur
La main qui leva l'horizon
Sur vos chemins quelle chanson
A pu défendre la clarté
Sur vos yeux que l'amour brûla
Quelle terre s'est déposée
Outre mer est la chasteté
Des incendiaires dans les livres
Mais le feu dans le réel et le jour
C'est ce courage des vivants
Ils font l'oiseau ils font l'écume
Et la maison des laves parfois
Ils font la richesse des douves
Et la récolte du passé
Ils obéissent à leurs mains
Fabriquant des échos sans nombre
Et le ciel et sa pureté fuient
Cette pureté de rocailles
Ils font les terres qui les font
Les avenirs qui les épargnent
Ô les filaos les grandissent
Sur les crêtes du souvenir
Mulets serpents et mangoustes
Font ces hommes violents et doux
Et la lumière les aveugle
La nuit au bord des routes coloniales
Toute parole est une terre
Il est de fouiller son sous-sol
Où un espace meuble est gardé
Brûlant, pour ce que l'arbre dit
C'est là que dorment les tam-tams
Dormant ils rêvent de flambeaux
Leur rêve bruit en marée
Dans le sous-sol des mots mesurés
Leur rêve berce dans vos yeux
Des paniques des maelströms
Plus agités que la brousse profonde
Lorsque passe le clair disant
Beauté sanguine des golfes
Ô c'est une plaie une plaie
Où danse le ciel, grave et lent
De voir des hommes nus et tels
Et l'île toute enfin repose
Dans le chaud des maturités
Mûr est le silence sur la ville
Mûre l'étoile dans la faim
Ce qui berce dans vos yeux son chant
Est la parure des troupeaux
L'herbe à taureaux pour les misaines
Le dur reflet des sels au sud
Rien ne distrait d'ordre les vies
Les hommes marchent les enfants rient
Voici la terre bâtée, consentante
De courants d'eau, de voilures
Quelle pensée raide parcourt
Les fibres les sèves les muscles
De la douleur a-t-on fait un mot
Un mot nouveau qui multiplie
Celui qui parmi les neiges enfante
Un paysage une ville des soifs
Celui qui range ses tambours ses étoffes
Dans la sablure des paroles
Guettant le saut des Eaux immenses
Le grand éclat des vagues Midi
Plus ardent que la morsure des givres
Plus retenu que votre impatience d'épine
Celui que prolonge l'attente
Et toutes les mains dans sa tête
Et toutes splendeurs dans sa nuit
Pour que la terre s'émerveille
Il accepte le bruit des mots
Plus égal que l'effroi des sources
Plus uni que la chair des plaines
Déchirée ensemencée
Sa clarté est dans l'océan
Dans la patience que traîne
Vers où nul oeil ne se distend
La flore d'îles du Levant
Ce qui berce en vos yeux son chant
Pour atteindre le matin ô connue
Inconnue c'est la chaleur fauve
Du Chaos où l'oeil enfin touche
Île ces requins vos fumures
Le charroi de votre sang l'homme
Et sa colline la femme et les cases
L'avenue dans ces miroirs les Mains
Est-ce oiseau, une racine qui gicle
Est-ce moisson, l'amitié grandie de la terre
La même couleur éclabousse, caresse
La souffrance est de ne pas voir
Beauté de ce peuple d'aimants
Dans la limaille végétale et vous
Je vous cerne comme la mer
Avec ses fumures d'épaves
Beauté des routes multicolores
Dans la savane que rumine
L'autan plein de mots à éclore
Je vous mène à votre seuil
Écoutant ruisseler mes tambours
Attendant l'éclat brusque des lames
L'éveil sur l'eau des danseurs
Et des chiens qui entre les jambes regardent
Dans ce bruit de fraternité
La pierre et son lichen ma parole
Juste mais vive demain pour vous
Telle fureur dans la douceur marine,
Je me fais mer où l'enfant va rêver.
Edouard Glissant
« Un champ d'îles » est la deuxième partie du poème du même nom, publié aux éditions Seuil en 1965, republié dans Poèmes complets. Paris: Gallimard, 1994
Edouard Glissant, poète, romancier, essayiste, efigure majeure de la littérature antillaise, est mort le 3 février 2011.
19:27 Publié dans art, coup de coeur, litterature, peinture, poèmes, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 03 février 2011
Le 3 février 1851, une loi vote un crédit spécial pour subventionner les lavoirs
 Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.
Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.
Une des plus ancienne description de lavage est sans doute extraite du chant VI de l'Odyssée d'Homère (traduction de Leconte de Lisle)
"[...] Et sa mère était assise au foyer avec ses servantes, filant la laine teinte de pourpre marine ; et son père sortait avec les rois illustres, pour se rendre au conseil où l'appelaient les nobles Phaiakiens. Et, s'arrêtant près de son cher père, elle lui dit :
- Cher père, ne me feras-tu point préparer un char large et élevé, afin que je porte au fleuve et que je lave nos beaux vêtements qui gisent salis ? Il te convient, en effet, à toi qui t'assieds au conseil parmi les premiers, de porter de beaux vêtements. Tu as cinq fils dans ta maison royale ; deux sont mariés, et trois sont encore des jeunes hommes florissants. Et ceux-ci veulent aller aux danses, couverts de vêtements propres et frais, et ces soins me sont réservés.
 Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :
Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :
- Je ne te refuserai, mon enfant, ni des mulets, ni autre chose. Va, et mes serviteurs te prépareront un char large et élevé propre à porter une charge.
Ayant ainsi parlé, il commanda aux serviteurs, et ils obéirent. Ils firent sortir un char rapide et ils le disposèrent, et ils mirent les mulets sous le joug et les lièrent au char. Et Nausikaa apporta de sa chambre ses belles robes, et elle les déposa dans le char. Et sa mère enfermait d'excellents mets dans une corbeille, et elle versa du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune vierge monta sur le char, et sa mère lui donna dans une fiole d'or une huile liquide, afin qu'elle se parfumât avec ses femmes. Et Nausikaa saisit le fouet et les belles rênes, et elle fouetta les mulets afin qu'ils courussent ; et ceux-ci, faisant un grand bruit, s'élancèrent, emportant les vêtements et Nausikaa, mais non pas seule, car les autres femmes allaient avec elle.
 Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."
Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."
Et c'est en rentrant au palais et qu'elles aperçurent Ulysse habillé seulement d'une branche chargée de feuilles ...
Mais ce travail n'est pas si paradisiaque ! Le métier de lavandière est un métier très pénible, la blanchisseuse est agenouillée toute la journée dans l'humidité, et l'hiver, il faut casser la glace du lavoir qui est gelé, battre le linge dans le froid et l'eau glacée et l'humidité ... Les lavandières ont souvent "l'onglée" aux doigts.
 Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...
Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...
La lessive est effectuée à partir d'un point d'eau, fontaine, mare, étang, cours d'eau. Sur les bords de la seine, comme sur les rives de toutes les rivières de France, on pouvait donc rencontrer des lavandières qui se servaient d’une planche à laver, d’une petite caisse pour s’agenouiller près de l’eau, d’un planche à frotter et d’un battoir qu'elles transportaient dans leur brouette lourdement chargée. Elles installaient leur selle (sorte de planche sur deux trétaux) et, à genoux, avec des gestes immuables, elles savonnaient, battaient, malaxaient, roulaient et essoraient leur linge sur les bords du fleuve.
« C’est ici, du matin au soir,
Que par la langue et le battoir
On lessive toute la Ville.
On parle haut, on tape fort,
Le battoir bat, la langue mord !
Pour être une laveuse habile,
Il faut prouver devant témoins
Que le battoir est très agile,
Que la langue ne l’est pas moins."
Achille Millien
A Paris, les rues des Lavandières (ou encore Lavandières Saint-Jacques) et des avandières Sainte Opportune datent du XIIIème siècle et doivent leur nom aux lavandières que le voisinage de la rivière avait attirées. Une rue des Blanchisseuses fut également ouverte, vers 1810, entre le quai de Billy et la rue de Chaillot.
La Taille de 1292 cite 43 lavandiers ou lavandières, parmi lesquels "Jehanne, lavendière de l'abbaie" de Sainte-Geneviève ; elle habitait la "rue du Moustier" qui est devenue la rue des Prêtres-Saint-Étienne du Mont. Cependant, à cette époque et dans la plupart des communautés, les religieux lavaient eux-mêmes leurs vêtements et leur linge. On faisait chauffer l'eau à la cuisine. Les objets blanchis étaient ensuite étendus soit dans le cloître, soit dans un séchoir spécial.
 Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.
Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.
D'autres encore travaillent à la journée au service de particuliers, de maîtres de grandes maisons, de fermiers, de métayers, de notables, pour un maigre salaire en toutes saisons, sauf lorsque le fleuve était pris par les glaces. Une ordonnance du 30 janvier 1350 fixe à "un tournoi en toute saison le prix que pourront demander toutes manières de lavandières de chacune pièce de linge lavé." (source : "La vie privée d'autrefois: arts et métiers, modes, moeurs, usages des parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d'après des documents originaux ou inédits). Elles côtoient les ménagères de condition modeste qui viennent laver elles-mêmes leur linge à la rivière. Ces opérations sont décrites ICI, avec un poème bien sympathique, ICI, ICI ou encore LA, avec des photos anciennes...
Bien que jamais érigées en corporation régulière, les blanchisseuses ou lavandières "professionnelles" doivent se plier à partir du XVIIe siècle aux exigences d'une administration parisienne veillant à la bonne hygiène ! Très tôt, les lois et les décrets visant l’existence et l’implantation d’établissements insalubres dans Paris poussent les industries du blanchissage à quitter la capitale pour s’installer dans les communes voisines.
 Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.
Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.
Lieu de convivialité, le lavoir est également un lieu de chant ; on y fredonne quelques airs à la mode et parfois on y va de ses commérages : "Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens" dit-on !
A Paris et dans de nombreuses villes traversées par un fleuve, est-ce parce que les lavandières étaient réputées de mœurs légères et que les mauvais garçons se mêlaient souvent aux lessives que l'on décida de créer des endroits où les jeunes filles et les femmes honnêtes des classes populaires pourraient laver leur linge en toute tranquillité, les fameux bateaux-lavoirs ?
" Ô Lavandière "
Sachez qu'hier, de ma lucarne,
J'ai vu, j'ai couvert de clins d'yeux,
Une fille qui dans la Marne
Lavait des torchons radieux
Je pris un air incendiaire
Je m'adossais contre un pilier
Puis le lui dis " Ô Lavandière "
Blanchisseuse étant familier
La blanchisseuse gaie et tendre
Sourit et, dans la hameau noir
Au loin, sa mère cessa d'entendre
Le bruit vertueux du battoir.
Je m'arrête. L'idylle est douce
Mais ne veut pas, je vous le dis,
Qu'au delà du baiser on pousse
La peinture du paradis.
Victor Hugo
L'origine des bateaux-lavoirs remonterait au XVIIe siècle. Le 16 septembre 1623, un traité assure à un entrepreneur, Jean de la Grange, secrétaire du roi Louis XIII, divers droits à conditions qu'il poursuive l'aménagement de l'Ile Notre-Dame et de l'Ile aux vaches, dont celui de mette à perpétuité sur la Seine "des bateaux à laver les lessives, en telle quantité qu'il feroit avisé & en tel endroit qu'il jugerroit à propos; pourvû que ce fût sans empêchement de la navigation, ni que le bruit pût incommoder les maisons du Cloître Notre-Dame". (source : "traité de la police" de M.De la mare, volume 1 - page 100 de l'édition de 1722).
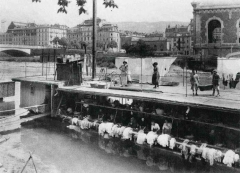 Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.
Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.
 En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.
En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.
Les 4 derniers bateaux-lavoirs sur la Seine disparaissent pendant la dernière guerre mondiale, sur ordre des allemands, pour faciliter la navigation : une vidéo de l'INA annonce cette décision ...
Au fait, vous souvenez-vous qu'une des insultes du capitaine Haddock est "Amiral de bateau-lavoir" ?
Emile Zola a décrit le travail des lavandières dans plusieurs de ses écrits :
"Un grand hangar, monté sur piliers de fonte, à plafond plat, dont les poutres sont apparentes. Fenêtres larges et claires. En entrant, à gauche, le bureau, où se tient la dame; petit cabinet vitré, avec tablette encombrée de registres et de papiers. Derrière les vitres, pains de savon, battoirs, brosses, bleu, etc. A gauche est le cuvier pour la lessive, un vaste chaudron de cuivre à ras de terre, avec un couvercle qui descend, grâce à une mécanique. A côté est l'essoreuse, des cylindres dans lesquels on met un paquet de linge, qui y sont pressés fortement, par une machine à vapeur. Le réservoir d¹eau chaude est là. la machine est au fond, elle fonctionne tout le jour, dans le bruit du lavoir; son volant ; on voit le pied rond et énorme de la cheminée, dans le coin. Enfin, un escalier conduit au séchoir, au-dessus du lavoir, une vaste salle fermée sur les deux côtés par des persiennes à petites lames ; on étend le linge sur des fils de laiton. A l'autre bout du lavoir, sont d'immenses réservoirs de zinc, ronds. Eau froide.
Le lavoir contient cent huit places. Voici maintenant de quoi se compose une place. On a, d¹un côté, une boite placée debout, dans laquelle la laveuse se met debout pour garantir un peu ses jupes. Devant elle, elle a une planche, qu'on appelle la batterie et sur laquelle elle bat le linge ; elle a à côté d'elle un baquet sur pied dans lequel elle met l'eau chaude, ou l'eau de lessive. Puis derrière, de l¹autre côté, la laveuse a un grand baquet fixé au sol, au-dessus duquel est un robinet d'eau froide, un robinet libre ; sur le baquet passe une planche étroite où l'on jette le linge; au-dessus; il y a deux barres, pour prendre le linge et l'égoutter. Cet appareil est établi pour rincer. La laveuse a encore un petit baquet sur pied pour placer le linge, et un seau dans lequel elle va chercher l'eau chaude et l'eau de lessive.
on a tout cela pour huit sous par jour. La ménagère paie un sou l'heure. L'eau de javel coûte deux sous le litre. Cette eau, vendue en grande quantité,est dans des jarres. Eau chaude et eau de lessive, un sou le seau. On emploie encore du bicarbonate - de la potasse pour couler. Le chlore est défendu."
Carnets d'enquêtes - La Goutte d'Or 1875
Sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche et suivit la rue Neuve-de-la-Goutte-d'Or. En passant devant la boutique de Mme Fauconnier, elle salua d'un petit signe de tête. Le lavoir était situé vers le milieu de la rue, à l'endroit où le pavé commençait à monter. Au-dessus d'un bâtiment plat, trois énormes réservoirs d'eau, des cylindres de zinc fortement boulonnés, montraient leurs rondeurs grises ; tandis que, derrière, s'élevait le séchoir, un deuxième étage très haut, clos de tous les côtés par des persiennes à lames minces, au travers desquelles passait le grand air, et qui laissaient voir des pièces de linge séchant sur des fils de laiton. A droite des réservoirs, le tuyau étroit de la machine à vapeur soufflait, d'une haleine rude et régulière, des jets de fumée blanche. Gervaise, sans retrousser ses jupes, en femme habituée aux flaques, s'engagea sous la porte, encombrée de jarres d'eau de javel. Elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir, une petite femme délicate, aux yeux malades, assise dans un cabinet vitré, avec des registres devant elle, des pains de savon sur des étagères, des boules de bleu dans des bocaux, des livres de bicarbonate de soude en paquets. Et, en passant, elle lui réclama son battoir et sa brosse, qu'elle lui avait donnés à garder, lors de son dernier savonnage. Puis, après avoir pris son numéro, elle entra. C'était un immense hangar, à plafond plat, à poutres apparentes, monté sur des piliers de fonte, fermé par de larges fenêtres claires. Un plein jour blafard passait librement dans la buée chaude suspendue comme un brouillard laiteux. Des fumées montaient de certains coins, s'étalant, noyant les fonds d'un voile bleuâtre. Il pleuvait une humidité lourde, chargée d'une odeur savonneuse, une odeur fade, moite, continue ; et, par moments, des souffles plus forts d'eau de javel dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l'allée centrale, il y avait des files de femmes, les bras nus jusqu'aux épaules, le cou nu, les jupes raccourcies montrant des bas de couleur et de gros souliers lacés. Elles tapaient furieusement, riaient, se renversaient pour crier un mot dans le vacarme, se penchaient au fond de leurs baquets, ordurières, brutales, dégingandées, trempées comme par une averse, les chairs rougies et fumantes. Autour d'elles, sous elles, coulait un grand ruissellement, les seaux d'eau chaude promenés et vidés d'un trait, les robinets d'eau froide ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égouttures des linges rincés, les mares où elles pataugeaient s'en allant par petits ruisseaux sur les dalles en pente. Et, au milieu des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette clameur d'orage s'étouffant sous le plafond mouillé, la machine à vapeur, à droite, toute blanche d'une rosée fine, haletait et ronflait sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage."
L'Assommoir
 A partir du XIXème siècle, la lessive se fait aussi "chez soi". En vue de ces lessives, on conserve la cendre de bois des cendriers et on la passe au tamis fin pour obtenir une poudre gris clair, fine et soyeuse au toucher. On chauffe de l'eau puis on la verse dans un cuvier chargé de linge recouvert de ces cendres, qui alors libèrent des sels de potasse qui traversent le linge. La première passe se fait avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, pour ne pas "cuire les taches". ("coulage à froid"). L'eau qui s'écoule est récupérée, remise à chauffer et on recommence ainsi de suite pendant des heures ("coulage à chaud"). Le linge est alors sorti brûlant du cuvier avec de longues pincettes de bois et brossé ("lessivage") puis et mis à égoutter sur des tréteaux. Ensuite, le linge est rincé à la rivière ou au lavoir ("retirage"). Suit le tordage (le linge est frappé et tordu) et le séchage. S´il fait beau il est posé sur l´herbe pour y être azuré ("la mise au pré") ...
A partir du XIXème siècle, la lessive se fait aussi "chez soi". En vue de ces lessives, on conserve la cendre de bois des cendriers et on la passe au tamis fin pour obtenir une poudre gris clair, fine et soyeuse au toucher. On chauffe de l'eau puis on la verse dans un cuvier chargé de linge recouvert de ces cendres, qui alors libèrent des sels de potasse qui traversent le linge. La première passe se fait avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, pour ne pas "cuire les taches". ("coulage à froid"). L'eau qui s'écoule est récupérée, remise à chauffer et on recommence ainsi de suite pendant des heures ("coulage à chaud"). Le linge est alors sorti brûlant du cuvier avec de longues pincettes de bois et brossé ("lessivage") puis et mis à égoutter sur des tréteaux. Ensuite, le linge est rincé à la rivière ou au lavoir ("retirage"). Suit le tordage (le linge est frappé et tordu) et le séchage. S´il fait beau il est posé sur l´herbe pour y être azuré ("la mise au pré") ...
 L'arrivée de l'eau courante dans les foyers achèvera l'histoire des lavoirs. L'"eau courante" dans les maisons se généralise vers 1950 dans les villes puis lentement dans les campagnes. On fait la lessive dans la buanderie où l'on ne craint pas de répandre de l'eau. Même si les machines à laver semi-automatiques existaient déjà depuis plus de 20 ans, elles étaient rares dans les familles et j'ai assisté dans mon enfance à ces séances de lavage, à peine modernisées ! On n'utilisait bien sûr plus de cuvier mais une lessiveuse "à champignon", la cendre était remplacée par du perborate acheté à la pharmacie. La lessiveuse était une grande marmite qui servait à faire bouillir le linge. Au fond se trouvait un double-fond, d'où remontait un tuyau avec, au bout, un pommeau. Après avoir été savonné sur la planche à laver, le linge était disposé dans la lessiveuse. On allumait le feu dans un petit poêle en dessous, et la chaleur faisant monter l'eau dans le tuyau et le pommeau qui arrosait le linge d'eau bouillante. L'eau redescendait en traversant le linge et retombait au fond pour remonter à nouveau ... ça sentait mauvais et il faisait une chaleur moite étouffante dans la buanderie. Ensuite ma mère laissait refroidir un peu la lessiveuse et une femme de ménage venait l'aider à la vider petit à petit dans un grand bac où le linge était rincé à l'eau froide. C'est ensuite toute la maison qui était mise à contribution pour essorer les grosses pièces que l'on prenait à chaque bout pour les tordre.Je me souviens toutefois d'une essoreuse électrique que mes parents avaient achetée à des américains d'un camp de l'OTAN ... Au milieu des années 60, le départ à la retraite de notre "lavandière" rendit nécessaire l'achat d'une machine à laver.
L'arrivée de l'eau courante dans les foyers achèvera l'histoire des lavoirs. L'"eau courante" dans les maisons se généralise vers 1950 dans les villes puis lentement dans les campagnes. On fait la lessive dans la buanderie où l'on ne craint pas de répandre de l'eau. Même si les machines à laver semi-automatiques existaient déjà depuis plus de 20 ans, elles étaient rares dans les familles et j'ai assisté dans mon enfance à ces séances de lavage, à peine modernisées ! On n'utilisait bien sûr plus de cuvier mais une lessiveuse "à champignon", la cendre était remplacée par du perborate acheté à la pharmacie. La lessiveuse était une grande marmite qui servait à faire bouillir le linge. Au fond se trouvait un double-fond, d'où remontait un tuyau avec, au bout, un pommeau. Après avoir été savonné sur la planche à laver, le linge était disposé dans la lessiveuse. On allumait le feu dans un petit poêle en dessous, et la chaleur faisant monter l'eau dans le tuyau et le pommeau qui arrosait le linge d'eau bouillante. L'eau redescendait en traversant le linge et retombait au fond pour remonter à nouveau ... ça sentait mauvais et il faisait une chaleur moite étouffante dans la buanderie. Ensuite ma mère laissait refroidir un peu la lessiveuse et une femme de ménage venait l'aider à la vider petit à petit dans un grand bac où le linge était rincé à l'eau froide. C'est ensuite toute la maison qui était mise à contribution pour essorer les grosses pièces que l'on prenait à chaque bout pour les tordre.Je me souviens toutefois d'une essoreuse électrique que mes parents avaient achetée à des américains d'un camp de l'OTAN ... Au milieu des années 60, le départ à la retraite de notre "lavandière" rendit nécessaire l'achat d'une machine à laver.
La deuxième partie du XXème siècle pensait en avoir fini avec les lavandières quand le fabricant de lave-linge Vedette se choisit la Mère Denis pour raviver un mythe forgé au cours des siècles autour de ce métier. Un petit chemin qui descend au lavoir, une brouette de linge, un battoir, une brosse et l'amour du travail bien fait.d eux bonnes grandes mains de lavandière et l'amour du travail bien fait ... Vedette mérite votre confiance, "C'est ben vrai ça!"
23:43 Publié dans art, femmes, Histoire, Hugo...mania, litterature, peinture, poèmes, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
dimanche, 23 janvier 2011
Dimanche
Charlotte
fait de la compote
Bertrand
suce des harengs
Cunégonde
se teint en blonde
Epaminondas
cire ses godasses
Thérèse
souffle sur la braise
Léon
peint des potirons
Brigitte
s'agite, s'agite
Adhémar
dit qu'il en a marre
La pendule
fabrique des virgules
Et moi dans tout cha ?
Et moi dans tout cha ?
Moi, ze ne bouze pas
Sur ma langue z'ai un chat
René de Obaldia
image http://www.gastonlagaffe.com/saga/franquin/
06:44 Publié dans coup de coeur, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 12 janvier 2011
Lettre d'Eugène Delacroix à George Sand, 12 janvier 1861
Chère amie,
J’ai appris, je ne sais plus par qui, que vous étiez tout à fait bien et que vous alliez passer l’hiver je ne sais où pour vous remettre tout à fait. Tout ce que vous faites est bien, quoique je ne sois pas édifié sur le séjour des auberges pour remettre la santé. Le bon lit auquel on est habitué, dans le coin où le ciel nous a fait prendre racine, est comme le lait de la nourrice qui vous a mis au monde. Grâce au ciel, ma santé est très bonne et jusqu’ici je me vois dispensé, ainsi que je l’avais appréhendé après deux hivers passés au coin de mon feu, de courir les hasards et d’aller m’exposer aux aventures, pour me préserver de la fièvre. Depuis quatre mois je fais un métier qui m’a rendu cette santé que je croyais perdue. Je me lève le matin, je cours au travail hors de chez moi, je rentre le plus tard que je peux et je recommence le lendemain. Cette distraction continuelle et l’ardeur que je porte à une besogne de cheval de carrosse me font croire que je suis revenu à cet âge charmant où l’on court toujours et surtout chez les traîtresses qui nous [mot illisible] et nous charment. Rien ne me charme plus que la peinture et voilà que, par-dessus le marché, elle me donne une santé d’homme de trente ans. Elle est mon unique pensée et je n’intrigue que pour être tout à elle, c’est-à-dire que je m’enfonce dans mon travail comme Newton (qui mourut vierge) dans la fameuse recherche de la gravitation (je crois).
Mes pensées gravitent vers vous, chère et bonne et fidèle amie. Je dis que je n’intrigue pas et cependant je ne vous eusse peut-être pas écrit sans la rencontre que j’ai faite de Bertin, qui m’a conjuré de vous demander sur quoi il devait compter au sujet de la promesse que vous avez bien voulu lui faire de lui envoyer un roman. Il le désire vivement et me prie de vous le dire. Je sais que je m’expose à toutes les fureurs de notre ami Buloz, s’il vient à découvrir ma requête. Il me fit une scène à cette occasion cet été. Il me croit apparemment inféodé aux intérêts de la revue. Je le traitai comme je devais et il se calma. Dites-moi donc, si vous voulez, à moi, quelles sont vos intentions pour les Débats qui, je vous le répète, sont friands, je le crois sans peine, de ces pages qui ont plus de succès que jamais.
Je n’ai plus de place que pour vous dire que je vous aimerai toujours.
Eugène Delacroix
Après avoir été gravement malade de la fièvre typhoïde, George Sand est partie en convalescence à Tamaris (Var) de février à juin 1861. Après l’avoir déclinée, Sand finit par accepter la proposition de Bertin de publier à nouveau dans Le Journal des débats. Son roman La Famille de Germandre paraît dans le périodique du 7 au 29 août 1861. D’après les notes prises durant son séjour, elle écrit également Tamaris, publié en 1862, d’abord dans la Revue des Deux Mondes, puis en volume. En effet après avoir été brouillée avec François Buloz jusqu’en 1858, Sand se remet à publier plusieurs œuvres dans la Revue des Deux Mondes. Le directeur de la revue ne devait donc pas être enchanté par l’idée d’une collaboration de la romancière avec un autre périodique ...
Delacroix recopie l’intégralité de cette lettre dans son Journal, à la même date du 12 janvier 1861.
 En 1834, Eugène Delacroix reçoit commande d’un portrait de George SAND en costume d’homme pour la Revue des Deux Mondes à laquelle elle collabore. Ce sera le début d’une amitié amoureuse intense, qui durera près de 30 ans, nourrie par une correspondance qui durera du 16 novembre 1834 jusqu'à la mort du peintre le 13 août 1863, et qui livre certains de leurs secrets.
En 1834, Eugène Delacroix reçoit commande d’un portrait de George SAND en costume d’homme pour la Revue des Deux Mondes à laquelle elle collabore. Ce sera le début d’une amitié amoureuse intense, qui durera près de 30 ans, nourrie par une correspondance qui durera du 16 novembre 1834 jusqu'à la mort du peintre le 13 août 1863, et qui livre certains de leurs secrets.
George Sand conserva toute sa vie des goûts plutôt académiques. Sa rencontre avec Delacroix, le chef de l'école romantique, bouleversa son approche esthétique. Il lui fit découvrir son maître Géricault. Delacroix séjournait de temps en temps à Nohant et y avait un atelier à demeure.
Delacroix était très proche de Chopin et George Sand, dont il fit un tableau, sans doute au cours du printemps 1838, avant que leur liaison ne devienne officielle. Chopin a fait transporter un piano chez Delacroix pour que ce dernier puisse le peindre en compagnie de George Sand, lui au piano, elle dans la pénombre debout derrière lui, captivée par la musique de son amant. Chopin écrit : "Elle me regardait profondément dans les yeux pendant que je jouais." Le 5 septembre 1838, Delacroix écrit à son ami Pierret : "Autre commission que je réclame de ta bonté; ce serait, en te promenant, d'aller au coin de la rue Grange batelière et du boulevard, chez Pleyel, facteur de pianos, le prier de faire enlever chez moi, Delacroix, rue des Marais Saint-Germain 17 [actuellement rue Visconti], le piano que M. Chopin y a fait porter il y a deux mois environ."
Mais jamais Chopin, George Sand, pas plus que Delacroix, ne mentionnent cette œuvre dans leurs écrits. Ce tableau inachevé resta dans l'atelier de Delacroix jusqu'à sa mort en 1863. L'oeuvre passa ensuite dans la collection du peintre Constant Dutilleux, ami et exécuteur testamentaire. Après plusieurs changements de propriété, le portrait de George Sand est maintenant à l'Ordrupgaard Museum à Copenhague, celui de Chopin est maintenant au Louvre.
En janvier 1841, George Sand rend à Delacroix la monnaie de la pièce en traçant les portraits du peintre et du musicien dans ses Impressions et Souvenirs.
À la mort de Delacroix, en 1863, Sand qui possédait alors plus de vingt tableaux de l'artiste, décida de tout vendre. Elle ne conserva que le premier et dernier des présents que lui avait faits le peintre : La confession du Giaour et le Centaure
Sources :
http://www.correspondance-delacroix.fr/correspondances/bd...
06:38 Publié dans Histoire, litterature, peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 06 janvier 2011
Coeur de bois
Amandine si hautaine
Amandine au coeur de bois
Ce soir, je serai ton Roi.
Si tu veux, tu seras la Reine.
J'ai ôté mon tablier
J'ai mis mes plus beaux souliers
Dans ma poche des sous neufs
Pour les distribuer aux veufs.
Comme trône j'ai le fauteuil
Du Grand Oncle Cancrelat
Qui fume dans son cercueil
Une pipe en chocolat.
Ma couronne vif argent
Vient tout droit du pâtissier.
Sur mes épaules flotte un drap
On se cachera dedans.
Le fauteuil est à roulettes
Quelle aubaine pour un Roi !
Je le déplace et les traîtres
Frappent au mauvais endroit.
Amandine, tes yeux verts
Illuminent toutes mes nuits.
Je voudrais t'écrire en vers
Quand je serai plus instruit.
Amandine, tu m'as dit
« Je viendrai sept heures sonnées.
Je viendrai dans ton grenier
Avec ma chemise à plis. »
L'heure passe et je suis là
Ma couronne pour les rats !
Ah ! ce bruit de patinette !
Mais non, ce n'est pas ici.
Le sang me monte a la tête
J'entends les cloches aussi.
Et pourtant, je suis le Roi !
Tu devrais, genou en terre,
Baiser le bout de mon drap
Et pleurer pour la maniere !
« Madame, relevez-vous »
Te dirai-je noblement !
Et sur tes levres de houx
T'embrasserai jusqu'à cent.
L'heure fuit ; mes oripeaux
Juste bons pour les corbeaux !
Amandine, tu te moques
Tu te ris toujours de moi.
Quand tu remontes tes socques
Je tremble et ne sais pourquoi...
Amandine, je vais mourir
Si vraiment tu ne viens pas.
Je t'ordonne de courir
De grandir entre mes bras !
Le silence, seul, répond
Aile blanche sur mon front.
Le grenier comme un navire
Se balance dans la nuit.
Le trône vide chavire
L'Oncle fume en son réduit.
Amandine sans foi ni loi
Amandine ne viendra pas.
Jamais elle ne sera Reine
D'Occident ou de Saba.
Jamais elle ne régnera
Sur c'qu'il y a de plus sacré.
Peste noire ou choléra
Jamais ne pourra pleurer.
Et pourtant comme je l'aime
Amandine des chevaux d'bois
De Jean-Pierre et de Ghislaine
De tout le monde a la fois !
Et pourtant comme je l'aime
(A mes pieds tombe le drap)
Amandine si hautaine
Amandine au coeur de bois.
René de Obaldia
Innocentines
Photo : http://carla-marie.blogspace.fr/1468054/UN-PETIT-TOUR-DE-MANEGE-HASSAN-DANS-MES-FAVORIS-a-AUTEUR-COMPOSITEUR-a-ECRIT-UNE-BELLE-CHANSON/
05:47 Publié dans litterature, poèmes, traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mardi, 04 janvier 2011
Hiver, vous n’êtes qu’un vilain
Hiver, vous n’êtes qu’un vilain;
Eté est plaisant et gentil,
En témoin de mai et d’avril
Qui l’accompagnent soir et main;
Eté revêt champs, bois et fleurs
De sa livrée de verdure
et de maintes autres couleurs,
Par l’ordonnance de nature.
Mais vous, hiver, trop êtes plein
De neige, vent, pluie et grésil:
on vous dût bannir en exil.
Sans point flatter, je parle plain
Hiver, vous n’êtes qu’un vilain.
Charles d’Orléans
22:10 Publié dans art, coup de coeur, litterature, peinture, poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |