mercredi, 29 février 2012
Le grand saut (suite) ...
J'ai raconté comment, il y a 100 ans, un tailleur pour femmes un peu fou se tuait en sautant de la tour Eiffel, habillé d'une combinaison-parachute de sa fabrication. Le lendemain, le fait divers faisait la une de nombreux journaux nationaux et internationaux. On s'interrogeait ... comment le préfet avait-t-il pu autoriser un tel saut, alors que personne ne croyait en cette invention ? Car en 1912, le parachutisme n'en était pas complètement à ses premiers pas !
L'idée d'utiliser la résistance de l'air pour ralentir une chute remonterait, parait-il, il y a 4 000 ans en Chine. On raconte la légende de l'empereur Shun, souverain mythique de l’antiquité chinoise, l'un des "cinq Empereurs" qui auraient vécu environ en 2200 avant notre ère environ, et aurait utilisé une sorte de parachute fait de deux grands chapeaux de jonc pour protéger sa descente du haut d'un grenier en flamme où son père, qui voulait l'assassiner, l'avait forcé à se hisser. Puis, plus tard vers 200 avant notre ère, dans les palais des empereurs Han, des acrobates faisaient de grands sauts lors de scènes de cascades en utilisant des accessoires semblables à des parachutes. Et plus tard encore, on raconte l'histoire d'un voleur chinois qui aurait tenté d'échapper à des marchands arabes à qui il aurait volé un trésor dans la mosquée de canton en 1180. Forcé à se réfugier un haut minaret avec son butin, son seul moyen d'éviter la capture aurait été de sauter en tenant un parapluie dans chaque main.
 En occident, c’est à Léonard de Vinci que revient le mérite d’avoir, le premier, conçu scientifiquement des instruments permettant à l'homme de voler. "L'homme est capable" affirmait-il, "de se maintenir dans l'air par le moyen d'ailes battantes." De 1480 à sa mort en 1519, il va travailler à vérifier "le plus obsédant et le plus tyrannique de ses rêves", selon l'un de ses biographes. Combinant ses connaissances de physique et de mathématiques avec ses observations sur le vol des oiseaux, il dessine une étonnante variété d'ornithoptères - des mots grecs Ornithos (oiseau) et Ptéron (aile) - mus par la force musculaire. Si ses machines à ailes battantes se montrèrent irréalisables, certaines de ses idées, comme le rotor d'hélicoptère, se retrouvent dans des réalisations aéronautiques modernes.
En occident, c’est à Léonard de Vinci que revient le mérite d’avoir, le premier, conçu scientifiquement des instruments permettant à l'homme de voler. "L'homme est capable" affirmait-il, "de se maintenir dans l'air par le moyen d'ailes battantes." De 1480 à sa mort en 1519, il va travailler à vérifier "le plus obsédant et le plus tyrannique de ses rêves", selon l'un de ses biographes. Combinant ses connaissances de physique et de mathématiques avec ses observations sur le vol des oiseaux, il dessine une étonnante variété d'ornithoptères - des mots grecs Ornithos (oiseau) et Ptéron (aile) - mus par la force musculaire. Si ses machines à ailes battantes se montrèrent irréalisables, certaines de ses idées, comme le rotor d'hélicoptère, se retrouvent dans des réalisations aéronautiques modernes.
Il dessine aussi, probablement en 1485, un homme suspendu en l’air à un cadre en forme de pyramide de 7 mètres de haut, recouvert de tissu, qu'il décrit avec ces mots dans le codex atlanticus :"Se un uomo ha un padiglione di pannolino intasato, che sia 12 braccia per faccia e alto 12 potrà gittarsi d'ogni grande altezza senza danno di sé". Une replique du projet de Vinci, aujourd'hui conservé au Musée national des sciences et de la technologie Leonardo da Vinci à Milan, a démontré que ce parachute ne fonctionnerait pas, et les versions testées avec succès en 2000 et 2008 comportaient quelques modifications ...
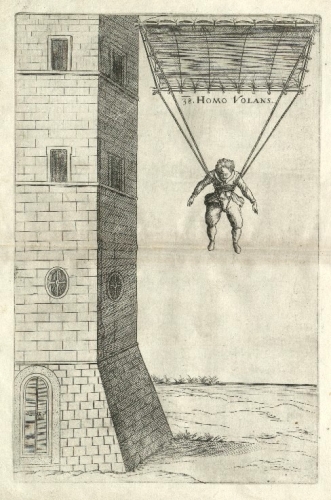 Une centaine d'années après Léonard de Vinci, le vénitien Fausto Veranzio s'intéresse à la science. Son œuvre la plus importante, Machinae Novae (Venise, 1595), contient 49 planches décrivant 56 machines différentes, des outils et des concepts techniques, parmis lesquels l'Homo Volans (Planche 38), un ancêtre du parachute, décrit ainsi dans une des copies qui nous est parvenue : "Avecq un voile carré estendu avecq quattre perches égalles, et ayant attaché quattre cordes aux quattre coings, un homme sans danger se pourra jetter du haut d’une tour ou de quelque autre lieu éminent : car, encore que, à l’heure, il n’aye pas de vent, l’étoffe de celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la voile de peur qu’il ne tombe violemment, mais petit à petit descendra. L’homme donc se doibt mesurer avec la grandeur de la toile"
Une centaine d'années après Léonard de Vinci, le vénitien Fausto Veranzio s'intéresse à la science. Son œuvre la plus importante, Machinae Novae (Venise, 1595), contient 49 planches décrivant 56 machines différentes, des outils et des concepts techniques, parmis lesquels l'Homo Volans (Planche 38), un ancêtre du parachute, décrit ainsi dans une des copies qui nous est parvenue : "Avecq un voile carré estendu avecq quattre perches égalles, et ayant attaché quattre cordes aux quattre coings, un homme sans danger se pourra jetter du haut d’une tour ou de quelque autre lieu éminent : car, encore que, à l’heure, il n’aye pas de vent, l’étoffe de celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la voile de peur qu’il ne tombe violemment, mais petit à petit descendra. L’homme donc se doibt mesurer avec la grandeur de la toile"
Il faut encore attendre 2 siècles pour qu'un homme saute vraiment en parachute avec succès ... peut être d'autres s'y étaient-ils déjà aventurés au péril de leur vie et l'on en a rien su ! C'est Louis Sébastien Lenormand qui effectue plusieurs essais du haut de l’observatoire de Montpellier, avec des charges inertes d’abord, puis avec des animaux. Il expérimente lui-même plusieurs fois du haut des arbres du jardin des Cordeliers, y grimpe et se jette dans le vide, rate, perfectionne sa machine qu’il a baptisé "parachute", recommence ...
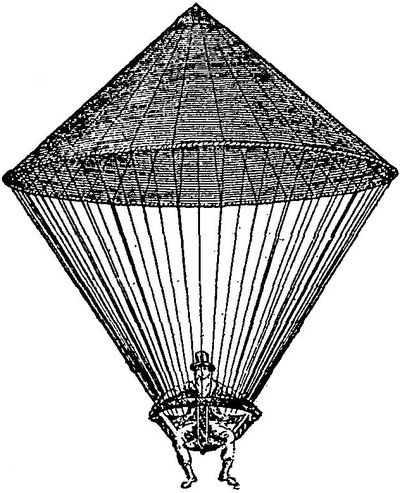 Voici en quels termes Sébastien Lenormand a revendiqué lui-même son invention; on va voir que son droit de propriété a été reconnu.
Voici en quels termes Sébastien Lenormand a revendiqué lui-même son invention; on va voir que son droit de propriété a été reconnu.
"Le 26 décembre 1783 je fis à Montpellier, dans l'enclos des ci-devant Cordeliers, ma première expérience en m'élançant de dessus un ormeau ébranché, et tenant en mes mains deux parasols de trente pouces de rayon, disposés de la manière dont je vais l'indiquer. Cet ormeau présentait une saillie à la hauteur d'un premier étage un peu haut; c'est de dessus cette saillie que je me suis laissé tomber.
Afin de retenir les deux parasols dans une situation horizontale sans me fatiguer les bras, je fixai solidement les extrémités des deux manches aux deux bouts d'un liteau de bois, de cinq pieds de long, je fixai pareillement les anneaux aux deux bouts d'un autre liteau semblable et j'attachai à l'extrémité de toutes les baleines des ficelles qui correspondaient au bout de chaque manche.
Il est facile de concevoir que ces ficelles représentent deux cônes renversés, placés l'un à côté de l'autre, et dont les bases étaient les parasols ouverts. Par cette disposition j'empêchais que les parasols ne fussent forcés de se reployer en arrière par la résistance de la colonne d'air. Je saisis la tringle inférieure avec les mains et me laissai aller: la chute me parut presque insensible lorsque je la fis les yeux fermés. Trois jours après, je répétai mon expérience, en présence de plusieurs témoins, en laissant tomber des animaux et des poids du haut de l'Observatoire de Montpellier.
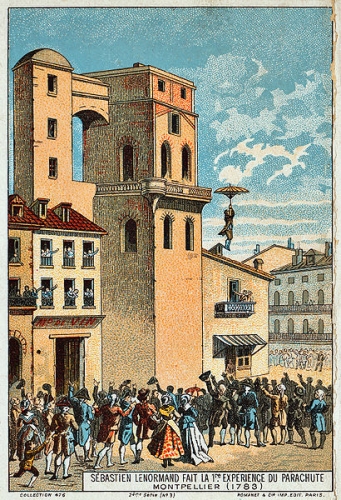 M. Montgolfier était alors dans cette ville, il en eut connaissance et répéta mes expériences à Avignon avec M. de Brante, dans le courant de mars 1784, en changeant quelque chose à mon parachute, dont j'avais communiqué la construction à M. l'abbé Bertholon, alors professeur de physique.
M. Montgolfier était alors dans cette ville, il en eut connaissance et répéta mes expériences à Avignon avec M. de Brante, dans le courant de mars 1784, en changeant quelque chose à mon parachute, dont j'avais communiqué la construction à M. l'abbé Bertholon, alors professeur de physique.
L'Académie de Lyon avait proposé un prix d'après le programme suivant : Déterminer le moyen le plus sûr, le plus facile, le moins dispendieux et le plus efficace de diriger à volonté les globes aérostatiques.
J'envoyai un mémoire au concours, ce fut dans les premiers jours de 1784, j'y insérai la description de mon parachute dans la vue de m'assurer la priorité de la découverte.
L'abbé Bertholon fit imprimer quelque temps après un petit ouvrage, sur les avantages que la physique et les arts qui en dépendent peuvent retirer des globes aérostatiques; et l'on y trouve, page 49 et suivantes, des détails sur le parachute et sur les expériences que nous fîmes ensemble.
Le citoyen Prieur avait inséré dans le tome XXI des Annales de chimie une note historique sur l'invention et les premiers essais des parachutes, il en attribuait la gloire à M. Joseph Montgolfier; je réclamai, et ce savant distingué s'empressa d'insérer dans le tome XXXVI, page 94, une notice qu'il termine par cette phrase: «La justice et l'intérêt de la vérité prescrivaient également la publicité que nous donnons à la réclamation du citoyen Lenormand, ainsi qu'aux preuves, qui paraissent en effet lui assurer la priorité de date pour les premières expériences des parachutes.» Plusieurs journaux répétèrent ce qu'avait avancé le citoyen Prieur.
Voici, monsieur, l'article relatif à mon parachute, que j'extrais mot à mot du mémoire que j'adressai à l'Académie de Lyon, et dont j'ai parlé plus haut; j'y joins aussi la copie de la planche qui l'accompagnait.
Description d'un parachute.
Je fais un cercle de 14 pieds de diamètre avec une grosse corde; j'attache fortement tout autour un cône de toile dont la hauteur est de 6 pieds; je double le cône de papier en le collant sur la toile pour le rendre imperméable à l'air; ou mieux, au lieu de toile, du taffetas recouvert de gomme élastique. Je mets tout autour du cône des petites cordes, qui sont attachées par le bas à une petite charpente d'osier, et forment avec cette charpente, un cône tronqué renversé. C'est sur cette charpente que je me place. Par ce moyen j'évite les baleines du parasol et le manche, qui feraient un poids considérable. Je suis sûr de risquer si peu, que j'offre d'en faire moi-même l'expérience, après avoir cependant éprouvé le parachute sur divers poids pour être assuré de sa solidité."
Ainsi Louis Sébastien Lenormand redevenait officiellement l’auteur de son invention, même si ce statut est souvent attribué à Garnerin. Et si, avec leurs premiers essais de ballon, les frères Montgolfier avaient prouvé que l'on peut s'élever dans l'air, lui montrait qu'on peut en redescendre !
Car d'autres inventions vont suivre !
 Un autre français, l’aéronaute Jean-Pierre Blanchard suit l’exemple des frères Montgolfier et construit un ballon gonflé à l’hydrogène, muni d’une hélice et de rames en plumes mues à la force des bras. Au cours de ses vols il effectue des essais d’un parachute auquel il travaille avec des animaux. En 1785, au cours d'une de ses ascensions, il laisse tomber un chien qui ne se fait aucun mal en atterrissant. Mais il faudra attendre jusqu’au 22 octobre 1797 pour assister à Paris, au Parc Monceau, au premier saut en parachute d'un homme à partir de la montgolfière de son ami Ruggieri, à 680 mètres d’altitude : André Jacques Garnerin devient ainsi le premier parachutiste. On raconte que l'idée lui en serait venue pendant les 3 années qu'il passa en captivité, lorsqu'il se demandait comment sauter les murs de sa prison. Le parachute était constitué d'une calotte de soie de 10 mètres de diamètre, soutenue par 36 sangles de cavaliers.
Un autre français, l’aéronaute Jean-Pierre Blanchard suit l’exemple des frères Montgolfier et construit un ballon gonflé à l’hydrogène, muni d’une hélice et de rames en plumes mues à la force des bras. Au cours de ses vols il effectue des essais d’un parachute auquel il travaille avec des animaux. En 1785, au cours d'une de ses ascensions, il laisse tomber un chien qui ne se fait aucun mal en atterrissant. Mais il faudra attendre jusqu’au 22 octobre 1797 pour assister à Paris, au Parc Monceau, au premier saut en parachute d'un homme à partir de la montgolfière de son ami Ruggieri, à 680 mètres d’altitude : André Jacques Garnerin devient ainsi le premier parachutiste. On raconte que l'idée lui en serait venue pendant les 3 années qu'il passa en captivité, lorsqu'il se demandait comment sauter les murs de sa prison. Le parachute était constitué d'une calotte de soie de 10 mètres de diamètre, soutenue par 36 sangles de cavaliers.
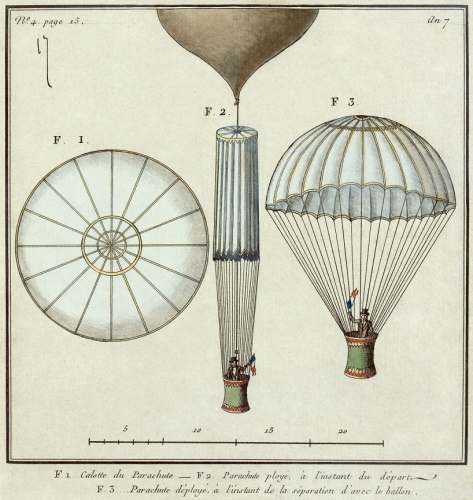 Parmi les spectateurs accourus au Parc Monceau, l’illustre astronome Lalande note sur le vif les péripéties de la descente et, le soir même, adresse au Journal de Paris la lettre suivante: 1er Brumaire : «L’expérience effrayante de parachute annoncée par le citoyen Garnerin vient d’être exécutée et elle a réussi complètement. Le parachute était en toile et il avait 24 pieds de diamètre (7 m environ). Le ballon est parti à 5 h 28’. Au bout d’une minute, Garnerin étant à plus de 200 toises de hauteur* (environ 400 m) et voulant redescendre à la vue des spectateurs, a coupé la corde. Le ballon s’est élevé seul et a éclaté peu de temps après, n’étant plus assujetti par le filet et par les cordes.
Parmi les spectateurs accourus au Parc Monceau, l’illustre astronome Lalande note sur le vif les péripéties de la descente et, le soir même, adresse au Journal de Paris la lettre suivante: 1er Brumaire : «L’expérience effrayante de parachute annoncée par le citoyen Garnerin vient d’être exécutée et elle a réussi complètement. Le parachute était en toile et il avait 24 pieds de diamètre (7 m environ). Le ballon est parti à 5 h 28’. Au bout d’une minute, Garnerin étant à plus de 200 toises de hauteur* (environ 400 m) et voulant redescendre à la vue des spectateurs, a coupé la corde. Le ballon s’est élevé seul et a éclaté peu de temps après, n’étant plus assujetti par le filet et par les cordes.
L’effroi a été général. Des femmes se sont évanouies. Notre incertitude a augmenté en voyant le parachute s’incliner de plus de 25 degrés, mais il s’est bientôt relevé pour s’incliner de l’autre sens. Il descendait avec une très grande vitesse. Il n’a pas été plus d’une minute à descendre. Le choc devait être rude! Le citoyen Garnerin a eu le pied un peu foulé mais c’est bien peu de chose en comparaison de ce que j’avais redouté. »
 Les fluctuations étaient terribles et la descente instable. La première amélioration au parachute l'a été par Garnerin lui-même sur les conseils de Lalande qui diagnostiqua immédiatement la cause des oscillations : l'accumulation d'air sous la coupole du parachute s'évacuait latéralement, ce qui induisait ce balancement associé à une réduction de la portance, et donc à une accélération de la descente. Le remède était simple, il fut appliqué dès le saut suivant : il suffisait de créer une ouverture au sommet de la coupole pour canaliser l'évacuation de l'air en surpression.
Les fluctuations étaient terribles et la descente instable. La première amélioration au parachute l'a été par Garnerin lui-même sur les conseils de Lalande qui diagnostiqua immédiatement la cause des oscillations : l'accumulation d'air sous la coupole du parachute s'évacuait latéralement, ce qui induisait ce balancement associé à une réduction de la portance, et donc à une accélération de la descente. Le remède était simple, il fut appliqué dès le saut suivant : il suffisait de créer une ouverture au sommet de la coupole pour canaliser l'évacuation de l'air en surpression.
Le 12 octobre 1799, son élève et future épouse, Jeanne Geneviève Labrosse, est la première femme à sauter en parachute. Le 11 octobre 1802, elle dépose au nom de son mari un brevet sur l'"appareil dit parachute, destiné à ralentir la chute de la nacelle d'un ballon après l'explosion de celui-ci. Ses organes essentiels sont une calotté d'étoffe supportant la nacelle et un cercle de bois qui se trouve en dessous et à l'extérieur du parachute et servant à le tenir un peu ouvert lors de l'ascension : il doit faciliter son développement au moment de la séparation avec le ballon, en y maintenant une colonne d'air."
La presse salue ces exploits, même si quelques caricatures d'époque illustrent la crainte que les jeunes gens ne s'enthousiasment un peu trop pour le saut en parachute. Mais cette invention s'avère bien utile puisqu'en 1808, le polonais Judaki Kuparento échappe à la mort en sautant en en parachute depuis son ballon en feu au dessus de Varsovie.
 Pour résoudre les problèmes de fluctuation durant le vol, les inventeurs proposent également de nouvelles formes. Un anglais, Sir George Cayley, publie un article "Sur la navigation aérienne" en 1809-1810, où il fait l'hypothèse que le parachute en forme de cône est plus stable. Robert Cocking, aquarelliste de métier mais passionné de science, passe de nombreuses années à développer son parachute amélioré, basé sur la conception de Cayley, et constitué d'un cône inversé d'environ 33 mètres de circonférence. Des cerceaux, de plus en plus petits en se rapprochant de la pointe, maintiennent le reste du tissu. L’engin pèse plus de 90 kg et comporte 100m² de toile fine. Cocking approche Charles Green et Edward Spencer, les propriétaires d'un ballon, afin de lui donner une occasion de tester son invention. Malgré le fait que Cocking soit âgé de 61 ans, ne soit pas un chercheur professionnel, et n'ait aucune expérience du parachutisme, les propriétaires du ballon acceptent et annoncent l'événement comme la principale attraction d'une fête au Vauxhall Garden de Londres, le 24 juillet 1837. À 1 200 mètres, il coupe la corde reliant le parachute au ballon. Les calculs de Cocking sont faux, la vitesse est trop rapide et le parachute se met à l'envers ... : quelques secondes plus tard, le malheureux inventeur s'écrase au sol au milieu des débris de sa machine. Mais cette conception aurait cependant été utilisée avec succès par l'aéronaute allemand Lorenz Hengler dans les sauts d'une hauteur de seulement 30 à 120m.
Pour résoudre les problèmes de fluctuation durant le vol, les inventeurs proposent également de nouvelles formes. Un anglais, Sir George Cayley, publie un article "Sur la navigation aérienne" en 1809-1810, où il fait l'hypothèse que le parachute en forme de cône est plus stable. Robert Cocking, aquarelliste de métier mais passionné de science, passe de nombreuses années à développer son parachute amélioré, basé sur la conception de Cayley, et constitué d'un cône inversé d'environ 33 mètres de circonférence. Des cerceaux, de plus en plus petits en se rapprochant de la pointe, maintiennent le reste du tissu. L’engin pèse plus de 90 kg et comporte 100m² de toile fine. Cocking approche Charles Green et Edward Spencer, les propriétaires d'un ballon, afin de lui donner une occasion de tester son invention. Malgré le fait que Cocking soit âgé de 61 ans, ne soit pas un chercheur professionnel, et n'ait aucune expérience du parachutisme, les propriétaires du ballon acceptent et annoncent l'événement comme la principale attraction d'une fête au Vauxhall Garden de Londres, le 24 juillet 1837. À 1 200 mètres, il coupe la corde reliant le parachute au ballon. Les calculs de Cocking sont faux, la vitesse est trop rapide et le parachute se met à l'envers ... : quelques secondes plus tard, le malheureux inventeur s'écrase au sol au milieu des débris de sa machine. Mais cette conception aurait cependant été utilisée avec succès par l'aéronaute allemand Lorenz Hengler dans les sauts d'une hauteur de seulement 30 à 120m.
Après la mort de Robert Cocking dans ce premier accident "homologué" de parachutisme moderne, de nombreuses questions sont soulevées pour savoir laquelle des deux conceptions concurrentes de parachutistes est supérieure : le parachute en forme de cône proposé par Sir George Cayley, ou la conception en forme de parapluie utilisé par André-Jacques Garnerin lors de son saut réussi de 1797. L'aérostier américain John Wise réalise de nombreuses expériences comparant les deux modèles et constate que celle de Cayley a toujours une descente plus stable. La conception de Cocking aurait été couronnée de succès si seulement elle avait été plus grande et mieux construite. Le problème inhérent à l'oscillation du parachute Garnerin sera plus tard résolu par l'introduction d'un évent sur le dessus de la calotte.
 Après la mort de Cocking, le parachutisme devient impopulaire, et limité à quelques acrobaties aériennes jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque des développements tels que le harnais le rendra rendu plus sûr. C’est donc bien plus tard, avec l’apparition des premiers avions, au début du 20ème siècle que le développement du parachutisme connaitra son véritable essor, avec la prise de conscience que le parachute pourrait sauver la vie de nombreux pilotes.
Après la mort de Cocking, le parachutisme devient impopulaire, et limité à quelques acrobaties aériennes jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque des développements tels que le harnais le rendra rendu plus sûr. C’est donc bien plus tard, avec l’apparition des premiers avions, au début du 20ème siècle que le développement du parachutisme connaitra son véritable essor, avec la prise de conscience que le parachute pourrait sauver la vie de nombreux pilotes.
Cependant, les recherches se poursuivent dans le but de réduire l'encombrement de ces engins. Dans les années 1887, Thomas Scott Baldwin, monte en ballon, emportant avec lui un parachute sans armature, indépendant de la nacelle. Il saute à 1250 m et descend pendu par les mains à un anneau reliant les suspentes. Il invente un système de harnais rudimentaire. Assis sur un trapèze directement suspendu au ballon, l'homme est muni de ce harnais relié au parachute disposé près de lui, suspendu par son sommet au trapèze par un lien lâche. Il suffit, au moment favorable, de se jeter du trapèze pour entraîner avec soit le décrochage du parachute, prêt à se déployer.
Il est imité par les frères Spencer qui se produisent dans le monde entier.
 Et l'Allemande Kathchen Paulus réalise, en 1892, le premier pliage d'un parachute. Vêtue en toréador, était assise sur un trapèze, suspendu à la nacelle d'un ballon. Quand celui-ci arrivait assez haut, elle débouclait la sangle qui retenait son appareil attaché à la nacelle et se laissait choir dans ce qu'elle appelait le vide horrible. Son poids faisait céder une boucle serrant le gainage, et le parachute se trouvait libéré. "Chacun sait, déclara-t-elle en juin 1900, que le public vient peut-être moins pour s'instruire que pour jeter un coup d'œil sur des préparatifs qui peuvent aboutir à une catastrophe. Aussi dois-je exécuter tout personnellement la manœuvre avec un aide et c'est seulement ainsi que je puis me précipiter dans le vide horrible avec la certitude que tout est dans l'ordre et doit nécessairement comporter un résultat heureux. J'ai exécuté cette expérience jusqu'à ce jour soixante-cinq fois avec succès complet, grâce à la main protectrice de Dieu." De 1893 à 1909, la jeune femme exécutera ainsi 147 sauts publics.
Et l'Allemande Kathchen Paulus réalise, en 1892, le premier pliage d'un parachute. Vêtue en toréador, était assise sur un trapèze, suspendu à la nacelle d'un ballon. Quand celui-ci arrivait assez haut, elle débouclait la sangle qui retenait son appareil attaché à la nacelle et se laissait choir dans ce qu'elle appelait le vide horrible. Son poids faisait céder une boucle serrant le gainage, et le parachute se trouvait libéré. "Chacun sait, déclara-t-elle en juin 1900, que le public vient peut-être moins pour s'instruire que pour jeter un coup d'œil sur des préparatifs qui peuvent aboutir à une catastrophe. Aussi dois-je exécuter tout personnellement la manœuvre avec un aide et c'est seulement ainsi que je puis me précipiter dans le vide horrible avec la certitude que tout est dans l'ordre et doit nécessairement comporter un résultat heureux. J'ai exécuté cette expérience jusqu'à ce jour soixante-cinq fois avec succès complet, grâce à la main protectrice de Dieu." De 1893 à 1909, la jeune femme exécutera ainsi 147 sauts publics.
A la même époque, les Américains Charles Broadwick et Léo Stewens ont l'idée de placer leur appareil dans un sac dorsal. La voilure est reliée à un point fixe du ballon par une sangle qui en assure l'extraction. Le parachute à ouverture automatique est né. En 1908, Leo Stevens conçoit un parachute dont l’ouverture peut être déclenchée par le sauteur qui tire sur une corde. Son parachute comporte 16 suspentes en chanvre de 15 pieds de long ainsi que 2 suspentes centrales de 13 pieds pour augmenter le diamètre efficace ou projeté.
Puis ce sont les sauts à partir d'un avion. Pour cela les français Robert, Esnault-Peletrie et Frédéric Bonnet prévoient de placer leur voilure allongée sur le fuselage à l'arrière du pilote. Libérée par un système mécanique ou à sandows, elle se gonfle et arrache le pilote de son siège. Ces dispositifs sont souvent dangereux car il y a risque de libération intempestive de la voilure. Bonnet imagine alors une attache du pilote à l'avion qui ne se déverrouille que sur commande du pilote, un instant avant de libérer la voilure.
 En 1911 Grant Morton saute d'un Wright Model Bau dessus de Venice, en Californie, avec son parachute replié sous le bras. Puis, le 28 février 1912, le capitaine Albert Berry saute d'un avion près de St Louis, dans le Missouri; avec un parachute emballé dans un conteneur métallique en forme de cône fixé sous le fuselage, conçu par Leo Stevens. Au lieu d'être sanglé dans un harnais, Berry était assis sur une barre de trapèze attaché aux suspentes. Et le 19 août 1913, Adolphe Pégoud expérimente au dessus de Chateaufort, dans les Yvelines, un parachute qui extrait le pilote de son vieux Blériot XI préalablement mis en piqué et abandonné pour l'occasion. Au concepteur du parachute Frédéric BONNET, il avait écrit en avril "Votre parachute est une merveille et sauvera la vie à bon nombre de pilotes ; d’ailleurs je tiens à l’essayer le plus tôt possible". Ce saut permet au constructeur du parachute, Bonnet, de remporter le prix Lalande de l'Aéroclub de France. Jean d'Ors, Jean Le Bourchis, sautent eux aussi d'avions dans les mois qui suivent. Un concours de sécurité en aéroplane est organisé en juin 1914 et est remporté par 1e constructeur Robert.
En 1911 Grant Morton saute d'un Wright Model Bau dessus de Venice, en Californie, avec son parachute replié sous le bras. Puis, le 28 février 1912, le capitaine Albert Berry saute d'un avion près de St Louis, dans le Missouri; avec un parachute emballé dans un conteneur métallique en forme de cône fixé sous le fuselage, conçu par Leo Stevens. Au lieu d'être sanglé dans un harnais, Berry était assis sur une barre de trapèze attaché aux suspentes. Et le 19 août 1913, Adolphe Pégoud expérimente au dessus de Chateaufort, dans les Yvelines, un parachute qui extrait le pilote de son vieux Blériot XI préalablement mis en piqué et abandonné pour l'occasion. Au concepteur du parachute Frédéric BONNET, il avait écrit en avril "Votre parachute est une merveille et sauvera la vie à bon nombre de pilotes ; d’ailleurs je tiens à l’essayer le plus tôt possible". Ce saut permet au constructeur du parachute, Bonnet, de remporter le prix Lalande de l'Aéroclub de France. Jean d'Ors, Jean Le Bourchis, sautent eux aussi d'avions dans les mois qui suivent. Un concours de sécurité en aéroplane est organisé en juin 1914 et est remporté par 1e constructeur Robert.
Observant pendant sa descente les évolutions de son avion livré à lui-même ("je fais la balançoire pendant que mon coucou fait le guignol tout seul" note-t-il dans ses carnets), Pégoud est convaincu qu’un avion peut effectuer des manœuvres jusqu’ici impensables qui permettraient, dans bien des cas, de sauver la vie de pilotes en situations jugées désespérées, et il va le prouver ! Le 1er septembre 1913, Pégoud exécute à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en présence de quelques journalistes, le premier vol "ête en bas" de l’histoire, sur 400 mètres. C’est un nouvel exploit. Le lendemain, à Buc (Yvelines) devant des représentants de l’aviation civile et militaire, il réalise une série de figures acrobatiques et termine son programme en "bouclant la boucle", l'un des tout premiers looping, qu’il reproduira officiellement en public le 21 septembre 1913. "J’ai bouclé la boucle avec joie. J’ai satisfait un peu, je l’avoue, mon amour propre. Je voulais la boucler ; ce fut parfait : l’appareil obéit dans la perfection, ne se montrant récalcitrant qu’au redressement final, car je dus gauchir avec force pour éviter de tourner sur une aile. Je voulais la boucle complète et normale. Je suis heureux : j’espère avoir montré la voie à mes camarades, leur avoir prouvé qu’il faut avoir confiance en soi et ne jamais désespérer, même dans les cas les plus critiques". Dès lors, c’est la gloire !
Les femmes ne sont pas en reste !
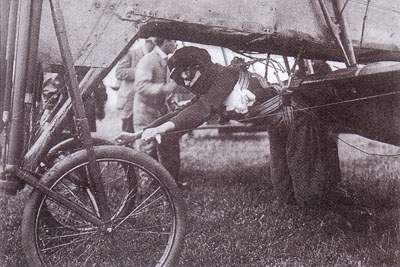 Avec la Française Lucienne Cayat de Castella, Giorgia "Tiny" Broadwick est considérée comme la première femme à sauter d'un avion en 1913 mais il est impossible de savoir qui a réellement sauté en premier. Lucienne Cayat de Castella teste les parachutes fabriqués par son mari, créateur d'un surprenant système d'ouverture assisté à air comprimé. Elle était attachée par trois courroies de cuir sous la carlingue, le visage à 50 cm de l'hélices, et c'est son mari qui, à 800 m d'altitude, la détachait. Mais en 1914, elle est victime d'un accident mortel durant une démonstration en Belgique où le parachute ne s'ouvre pas. Quand à Tiny Broadwick, elle devint en 1914 la première personne à effectuer une chute libre. La sangle d’ouverture automatique était prise dans la queue d’un avion d’entraînement, un Martin, lors de son 4ème saut. Elle coupe la sangle et déclenche elle-même l’ouverture du parachute en tirant sur la sangle. Sa demande pour être reconnue comme la personne ayant effectué le premier saut en parachute en utilisant un déploiement déclenché manuellement fut malheureusement contestée. Par la suite elle effectua plus de 100 sauts en chute libre.
Avec la Française Lucienne Cayat de Castella, Giorgia "Tiny" Broadwick est considérée comme la première femme à sauter d'un avion en 1913 mais il est impossible de savoir qui a réellement sauté en premier. Lucienne Cayat de Castella teste les parachutes fabriqués par son mari, créateur d'un surprenant système d'ouverture assisté à air comprimé. Elle était attachée par trois courroies de cuir sous la carlingue, le visage à 50 cm de l'hélices, et c'est son mari qui, à 800 m d'altitude, la détachait. Mais en 1914, elle est victime d'un accident mortel durant une démonstration en Belgique où le parachute ne s'ouvre pas. Quand à Tiny Broadwick, elle devint en 1914 la première personne à effectuer une chute libre. La sangle d’ouverture automatique était prise dans la queue d’un avion d’entraînement, un Martin, lors de son 4ème saut. Elle coupe la sangle et déclenche elle-même l’ouverture du parachute en tirant sur la sangle. Sa demande pour être reconnue comme la personne ayant effectué le premier saut en parachute en utilisant un déploiement déclenché manuellement fut malheureusement contestée. Par la suite elle effectua plus de 100 sauts en chute libre.
Dans les années qui suivent, les avions commencent à être équipés de parachutes et les pilotes ont maintenant la possibilité d’avoir la vie sauve en cas de danger.
Lorsque la Première Guerre mondiale commence en 1914, très peu de membres d'équipage des ballons ou des avions portaient des parachutes. Les Allemands furent probablement les premiers à comprendre l'intérêt du parachute en cas d'urgence. Moins d'un an, les Allemands avaient équipé leurs équipages avec un parachute conçu par Kathchen Paulus. Les Britanniques et les Français suivent bientôt l'exemple, avec des parachutes emballés dans des conteneurs coniques positionnés à l'extérieur du fuselage et les Américains adoptent le parachute de conception française. Puis se créera dans les armées de ces pays un corps autonome de parachutistes
A partir de ce moment, l’utilisation du parachute croît en popularité. Certains commencent à sauter pour le plaisir ... Les meetings tant civils que militaires vont alors se multiplier, les équipes s'affrontant notamment sur leurs capacités à effectuer des sauts de masse et des sauts groupés avec réalisation de figures diverses dont la plus prisée est l'étoile.
Quelques articles sur le sujet :
http://fandavion.free.fr/parachute.htm
http://lepetitphaco.free.fr/histoire%20des%20paras%203.htm
http://www.gutenberg.org/files/28397/28397-h/28397-h.htm
http://parachutisme.tra-son.fr/Levolution-du-parachute-au...
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9buts_de_l%27aviation_...
03:39 Publié dans espace, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
lundi, 27 février 2012
Il y a 100 ans ... la retraite à 60 ans !
Eh oui, au moment où l'âge de la retraite est repoussé à 62 ans, qui se souvient qu'il y a 100 ans jour pour jour, les travailleurs pouvaient partir à 60 ans ?
En effet l’âge auquel on peut faire valoir ses droits à la retraite a varié à plusieurs reprises depuis qu’il existe une législation concernant les "retraites ouvrières".
La loi du 18 juin 1850 avait créé une caisse des retraites pour la vieillesse (qui deviendra avec les lois de 1884 et 1886 la Caisse nationale des retraites), à laquelle l'adhésion était "volontaire, spontanée et libre" donc facultatif. Le cotisant pouvait prendre sa retraite à sa guise à partir de cinquante ans, la rente qui lui était versée étant proportionnelle aux versements qu’il avait accomplis. Il n'y avait pas d’âge maximum au delà duquel le travailleur avait l'obligation de partir, du moins jusqu'à la loi du 20 juillet 1886 où le maximum fut alors fixé à 65 ans. C’était la première loi (capitalisation) qui concernait les salariés du secteur privé. Les ouvriers, aux capacités d’épargne limitées, n’y souscriront guère ...
Envisagé à partir de 1880, le principe des retraites ouvrières et paysannes (ROP) ne commence à être débattu véritablement que 10 ans plus tard. Avec l'entrée d'Alexandre Millerand dans le cabinet Waldeck-Rousseau en 1899, l'état s'implique dans ce dossier et soutient le projet du 14 mai 1901 de Paul Guieysse pour une Caisse nationale de retraite ouvrière inspirée de celle des mineurs. Il veut mettre en place un système plus efficace que les caisses de secours qui mécontentent tout le monde et dont l’équilibre financier est toujours incertain. Ils prétend, au nom de la laïcité, combattre aussi l’influence des sociétés de bienfaisance catholiques. La mutualité peut assurer des caisses de retraite, les sociétés de secours mutuels collecter les cotisations et prendre en charge le service des retraites. Mais la caisse d'Etat est privilégiée au détriment de la Caisse autonome, les concepteurs de la loi, René Viviani, Alexandre Millerand, tous deux anciens socialistes, estimant que les mutualistes ne sont pas capables de gérer techniquement ce système.
Jules Guesde et Paul Lafargue estiment que "la société bourgeoise et capitaliste qui crée et favorise l'exploitation du prolétariat doit pourvoir au bien-être et à la subsistance des vieux travailleurs" mais dénoncent en 1901 le projet qui veut rendre obligatoire les cotisations de retraite.
 Le projet dans son ensemble fait d'ailleurs l’objet de vives critiques, venant de tous bords : d'un côté la droite, le monde paysan et le patronat qui dénoncent le coût de la mesure et "l’invitation à la paresse", ainsi que l'Eglise qui craint pour ses sociétés de bienfaisance, de l'autre côté la Mutualité, farouchement attachée à la cotisation volontaire et qui ne veulent pas admettre qu'à eux seuls ils n'ont pas les moyens d'assurer cette retraite, et les anarcho-syndicalistes (Jouhaux, Monatte, Merrheim) de la CGT qui estiment par contre que c'est à l'état de financer les retraites. Ces derniers dénoncent une "retraite pour les morts" compte tenu de l’espérance de vie peu élevée des ouvriers. Les cotisations apparaissent trop élevées pour des salaires misérables, et les pensions versées sont, de surcroît, très modiques. Ce nouveau dispositif est donc assimilé à "une vaste escroquerie étatiste, dont les travailleurs feront tous les frais", où "tous paieront pour cela et, de ce chef, des milliards s'entasseront bientôt dans les coffres de l'Etat" (L'Action syndicale du 3 mars 1910).
Le projet dans son ensemble fait d'ailleurs l’objet de vives critiques, venant de tous bords : d'un côté la droite, le monde paysan et le patronat qui dénoncent le coût de la mesure et "l’invitation à la paresse", ainsi que l'Eglise qui craint pour ses sociétés de bienfaisance, de l'autre côté la Mutualité, farouchement attachée à la cotisation volontaire et qui ne veulent pas admettre qu'à eux seuls ils n'ont pas les moyens d'assurer cette retraite, et les anarcho-syndicalistes (Jouhaux, Monatte, Merrheim) de la CGT qui estiment par contre que c'est à l'état de financer les retraites. Ces derniers dénoncent une "retraite pour les morts" compte tenu de l’espérance de vie peu élevée des ouvriers. Les cotisations apparaissent trop élevées pour des salaires misérables, et les pensions versées sont, de surcroît, très modiques. Ce nouveau dispositif est donc assimilé à "une vaste escroquerie étatiste, dont les travailleurs feront tous les frais", où "tous paieront pour cela et, de ce chef, des milliards s'entasseront bientôt dans les coffres de l'Etat" (L'Action syndicale du 3 mars 1910).

Pourtant, peu à peu une minorité autour de Jean Jaurès, Edouard Vaillant, Albert Thomas, et Marcel Sembat, bientôt soutenue par les allemanistes et les syndicalistes réformistes, voire quelques guesdistes (Jean Ducasse, Victor Renard, Charles Goniaux ...), en est venu à défendre la loi sur les ROP, tout en la trouvant insuffisante. Tous soulignent l’importance d’inscrire dans la législation le passage de l’assistance au droit, la reconnaissance de la légitime intervention de l’État, le progrès de la socialisation des richesses et le potentiel d’émancipation ouvrière par la gestion des caisses de retraites.
Edouard Vaillant est favorable à l'assurance obligatoire, toutefois, comme il l'explique à la chambre des députés le 26 mars 1910, il refuse le principe de la retenue sur le salaire ouvrier. Quelques semaines plus tôt, il a fait adopter, par 197 voix contre 157 lors du VIIème congrès de la SFIO, un texte en faveur de la loi et de son amélioration immédiate sur la base de 3 principes : refus de la capitalisation, gestion ouvrière des caisses et abaissement rapide de l'âge de la retraite. En revanche Paul Lafargue s'y oppose au congrès de la SFIO de 1910 et Jules Guesde, à la Chambre des députés le 31 mars, persiste dans son opposition et est le seul député SFIO à voter contre. Comme la CGT, ils demandent que la retraite soit financée par un impôt spécial "n'atteignant que les privilégiés du capitalisme industriel et terrien.". Les autres votent pour ... Il sera toujours temps, considèrent-ils, d'améliorer ce système. Finalement les mutualistes, convaincus par Léopold Mabilleau, s'y rallient aussi.
 Jaurès écrit dans "l'Humanité" du 1er avril 1910 : "A la presque unanimité, la Chambre a voté hier soir la loi des retraites ouvrières et paysannes. Quels que soient les défauts de la loi que nous avons signalé et que nous corrigerons, c'est chose émouvante de voir consacré ainsi le principe même du droit à la vie et de l'assurance sociale. Ce qui était encore, il y a dix ans, l'utopie lointaine, la chimère raillée, devient par l'effort du prolétariat, par la revendication des travailleurs, la vérité légale, la réalité sociale [...] Dès maintenant, en ce qui concerne la loi même des retraites, notre plan est formé, selon la volonté du Parti, pour l'améliorer et la compléter [...]"
Jaurès écrit dans "l'Humanité" du 1er avril 1910 : "A la presque unanimité, la Chambre a voté hier soir la loi des retraites ouvrières et paysannes. Quels que soient les défauts de la loi que nous avons signalé et que nous corrigerons, c'est chose émouvante de voir consacré ainsi le principe même du droit à la vie et de l'assurance sociale. Ce qui était encore, il y a dix ans, l'utopie lointaine, la chimère raillée, devient par l'effort du prolétariat, par la revendication des travailleurs, la vérité légale, la réalité sociale [...] Dès maintenant, en ce qui concerne la loi même des retraites, notre plan est formé, selon la volonté du Parti, pour l'améliorer et la compléter [...]"
Avec la loi du 5 avril 1910 qui crée les retraites ouvrières et paysannes, les ROP, pour les salariés gagnant moins de 3 000 francs (ce qui permet d’exempter ceux qui préfèreraient se constituer une épargne en achetant un bien immobilier ...), les salariés peuvent prendre leur retraite à 65 ans et recevoir une allocation viagère de l'Etat. Afin de financer celle-ci, une cotisation est prélevée sur les salaires.
La mise en œuvre de la loi fait l’objet d’un rapport annuel au président de la république et le suivi est effectué par un conseil supérieur des retraites ouvrières, composé de personnes qualifiées sur le sujet et de hauts fonctionnaires. En 1912, on constate que si près de 7,5 millions de travailleurs peuvent bénéficier de cette loi, ils ne sont en réalité que 2,65 millions à en profiter, les autres n'ayant versé aucune cotisation, d'ailleurs encouragés par les patrons qui ne voulaient pas de cette retraite obligatoire. Ces chiffres vont d'ailleurs décroître dans les années qui suivent.
La loi de finances du 27 février 1912 donne satisfaction à la revendication syndicale sur l'âge de départ, en abaissant à 60 ans l’âge auquel on pouvait faire valoir ses droits, étant entendu qu’il est possible d’attendre d’avoir atteint 65 ans ... Ce dispositif ne résistera pas à la première guerre et à l'inflation durable, l’employeur n’ayant de plus pas la possibilité d’imposer le prélèvement à ses salariés.
La loi du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 qui instituent, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès, conserve la disposition d'âge de départ acquise en 1912.
La loi du 14 mars 1941, relative à l’"allocation aux vieux travailleurs salariés", comporte une réforme majeure. En effet l'érosion monétaire ne permet plus de préserver le pouvoir d'achat des retraités, ce qui conduit à l'abandon du système de la capitalisation au profit de celui de la répartition, qui va permettre de verser rapidement des retraites aux personnes âgées. Mais l'âge "normal" de la retraite reste 60 ans, sauf pour l’allocation spéciale "aux vieux travailleurs français sans ressources suffisantes" qui n’ont pas cotisé assez longtemps ou pas cotisé du tout, qui n'est versée qu'à partir de 65 ans.
C'est l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui, de fait, reculera l'âge de la retraite à 65 ans en minorant les droits acquis à 60 ans à seulement 20% du salaire
Il faudra attendre les deux ordonnances du 26 et du 30 mars 1982 pour revenir à l'âge de la retraite à 60 ans, avec une pension à taux plein pour 37 ans et demi de cotisation.
En repoussant l’âge de la retraite à 62 ans, le gouvernement a donc renié un acquis si longuement attendu par les salariés.
12:28 Publié dans chronique à gauche, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 23 février 2012
Le grand saut ...
Deux parachutistes, l'autrichien Felix Baumgartner et le français Michel André Fournier, poursuivent le rêve de sauter depuis 40 km d’altitude et de franchir le mur du son en chute libre.
L'autrichien est un passionné de base jump, époustouflante activité consistant à sauter en chute libre de falaises, de ponts ou de tours, et s'entraîne depuis plusieurs années avec l'aide financière de Red Bull, marque de boisson à la mode ...
Le français, qui totalise, selon son site web, plus de 8700 sauts en parachute, dont une centaine à très haute altitude (plus de 8500 mètres); et le record de France de saut en chute libre à 12 000 mètres, veut battre 4 records du monde :
- Record d’altitude de vol humain sous un ballon, qui date de 1960. Le 16 août de cette année-là, Joe Kittinger, pilote de l’US Air Force, participant au projet Excelsior, s’élançait d’un ballon gonflé à l’hélium qui venait de grimper à 31 300 m au-dessus du sol, pour un vol de 13 minutes et 45 secondes au dessus du désert du Nouveau Mexique. Mais jusqu'à l'altitude d'environ 20 000 m, il a utilisé un petit parachute pour la stabilité avant d'ouvrir son parachute principal dans l'atmosphère plus dense. Son saut n’est donc pas homologué ...
- Record d’altitude de saut en chute libre établi par Roger Eugène ANDREYEV (Russie) qui sauta à 24.483 mètres le 1er novembre 1962.
- Record de durée en chute libre pour un vol d'environ 7min 25s
- Record de vitesse en chute libre à environ 1 200 km/h
Ce grand saut sera surtout une expérience scientifique qui permettra de réaliser des avancées dans le domaine du tourisme spatial ... La tentative de Michel Fournier s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du projet "S38" de l'Armée française à la fin des années 1980, prévoyant de tels sauts à 38 000 m pour mettre au point la capsule d'éjection du projet de navette européen Hermès. Les deux sélectionnés pour ces essais avaient été en 1987 Michel Fournier et Jean-François Clervoy, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, qui parraine l'exploit.
Comme il y a cent ans, à 8h15 le 4 février 1912 ! Ce jour-là, un tailleur pour dames dans le quartier de l'Opéra, Frantz Reichelt, se jette du haut de la tour Eiffel, muni d’une combinaison-parachute de sa fabrication et se tue. Les quotidiens du lendemain en font leur une, avec photos de la chute de la "tragique expérience". La tentative de Reichelt est filmée, ce qui contribue à sa notoriété.
Mais qu'est-ce qui a poussé Reichelt à faire cette expérience mortelle ?
Les débuts de l'aviation et les accidents qui endeuillent ce monde de pionniers entrainent différentes études sur la mise au point du parachute. A la fin de 1910, on compte déjà 28 morts. L'opinion publique s'émeut. Aussi dès 1910, l'aéroclub de France crée le prix Lalance doté de 10 000 francs pour récompenser la réalisation d'un parachute d'avion efficace, pliable, et d'un volume réduit au maximum. En août 1910, la conférence internationale des lignes aériennes émet le vœu "qu'à chaque appareil soit annexé un dispositif formant parachute". Mais il faudra encore attendre au moins dix ans pour que le parachute devienne obligatoire.
Frantz Reichelt a choisi d’opter pour un parachute incorporé à la tenue même d’aviateur. Son système se compose d’une combinaison en toile caoutchoutée, munie d’ailes ressemblant à celles des chauves-souris, avec une surface portant de 12 mètres carrés. Reichelt procède à des essais avec des mannequins depuis la cour de son immeuble, au 8 rue Gaillon, puis se lance lui-même depuis une hauteur d'une dizaine de mètres à Joinville. La tentative est un échec et sa chute est amortie par de la paille au sol. Le Petit Journal rapporte qu'il a également réalisé un essai en novembre 2010 avec un mannequin depuis le premier étage de la tour Eiffel mais apparemment peu concluant.
Persuadé que l'échec vient du fait qu'il n'expérimente pas lui-même son système, Reichelt demande au préfet de police une nouvelle autorisation pour le 4 février 1912. En bas, une trentaine de personnes, journalistes, photographes ou curieux matinaux attendent la minute décisive. Il y a même Gaston Hervieu, qui, l'année précédente, a réussi une expérience similaire, mais avec un mannequin. Reichelt pose, se tient bien droit, face à l'objectif, fait un petit tour sur lui-même pour faire voir son habit-parachute. On tente de le dissuader, mais il monte à la première plateforme de la tour Eiffel, à environ 60m d'altitude Sur la bande d'actualité du Pathé journal, on voit Reichelt, saisi par le vertige, hésiter. Il sait qu'il risque sa vie, la veille il a rédigé son testament ! Mais plus personne pour empêcher le saut, sauf le caméraman qui filme. Il reste à Reichelt de franchir la rambarde pour sauter, mais il se recule instinctivement, prend un journal, le déchire et se rend compte de la violence du vent. Il hésite encore, va plus loin, s'empare d'une table, la dispose et s'apprête à s'élancer. Une fois encore, il recule, puis revient et prend une rapide décision devant l'opérateur qui tremble de tous ses membres. Il fait le mouvement du nageur qui va faire un plongeon, met la tête en avant, fait jouer les ressorts de son vêtement, s'élance, et s'écrase au sol.
En bas, un autre cameraman de Pathé filme la chute, puis la foule autour du cadavre. Le corps est conduit tout d’abord à l’hôpital Necker, où l’interne de service ne peut que constater le décès, puis au poste de police de la rue Amélie, et enfin rue Gaillon, au domicile du malheureux inventeur. (Sources : Le Petit Parisien du 5 février 1912 et Un-tailleur-pour-dames-au-temps-des-aéroplanes de David Darriulat)
Le lendemain, le fait divers fait la une de nombreux journaux nationaux et internationaux. On s'interroge ... comment le préfet a-t-il pu autoriser un tel saut, alors que personne ne croyait en ce costume-parachute ? Car en 1912, le parachutisme n'en est pas complètement à ses premiers pas !
Mais ça, je le raconterai peut être une autre fois ...
19:43 Publié dans espace, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
lundi, 17 octobre 2011
Zarafa, la girafe du Roi au jardin des plantes
 Il y a quelques jours, je visitais le jardin des plantes. Au cœur de Paris, son zoo abrite 1800 animaux dont un tiers représente des espèces menacées d’extinction. Ces espèces rares, plus extraordinaires les unes que les autres sont présentées dans un site exceptionnel par son architecture et sa végétation exubérante.
Il y a quelques jours, je visitais le jardin des plantes. Au cœur de Paris, son zoo abrite 1800 animaux dont un tiers représente des espèces menacées d’extinction. Ces espèces rares, plus extraordinaires les unes que les autres sont présentées dans un site exceptionnel par son architecture et sa végétation exubérante.
La présence d'une ménagerie dans un jardin est une tradition remontant à l'Antiquité et au Moyen-Age. A Vincennes, Louis XIV a déjà pu voir un "sérail" dans lequel se déroulaient des combats de fauves. Il fait donc édifier celle de Versailles par Le Vau entre 1663 et 1665. Les animaux rejoindront le Jardin des Plantes en l'an II.
Avec ses étonnants éléments d'architecture datant pour la plupart du XVIIIe et du XIXe siècle), la Ménagerie du Jardin des Plantes est le plus ancien zoo du monde conservé dans son aspect d'origine. Elle est officiellement ouverte le 11 décembre 1794 à l'initiative de Bernardin de Saint-Pierre, professeur de zoologie au Muséum national d'histoire naturelle. Les animaux proviennent d'animaux de foire de ménageries privées et foraines et par le transfert le 26 avril 1794 des animaux des Ménageries royales de Versailles et de ceux du Raincy appartenant au duc d'Orléans, le 27 mai 1794.
Au cours de son histoire, elle a présenté une quantité innombrable d'espèces animales, dont la première girafe présentée en France.
 Le matin du 9 juillet 1826, une girafe se frayait un chemin dans Paris en liesse pour être reçue par Charles X et sa cour. C'était la première fois qu'un tel animal foulait le sol de France et la conclusion d'un étonnant périple de près de trois ans et quatre mille kilomètres.
Le matin du 9 juillet 1826, une girafe se frayait un chemin dans Paris en liesse pour être reçue par Charles X et sa cour. C'était la première fois qu'un tel animal foulait le sol de France et la conclusion d'un étonnant périple de près de trois ans et quatre mille kilomètres.
C'est au sud de Khartoum que Zarafa, présent de Méhémet Ali, vice-roi d'Egypte, va commencer son voyage vers la France. L'Egypte était alors en froid avec la France à cause de sa participation à la répression de la révolte des Chrétiens grecs contre les Turcs. C'est pourquoi, lorsque Berbardino Drovetti, consul de France au Caire, reçoit une circulaire du Ministère des Affaires Étrangères rédigée par le Museum d’Histoire Naturelle qui y réclame des spécimens d’animaux exotiques, Méhémet Ali, désireux se soustraire à la tutelle du Sultan de Constantinople et de resserrer les liens avec l'occident, propose d'envoyer à Charles X l'un des 2 girafons qu'il vient de recevoir d'un seigneur soudanais. L'Angleterre demande pour son compte le second girafon ... On décide alors de tirer au sort les deux girafons et c’est le plus chétif qui échoie à l’Angleterre. Drovetti se vante alors que "notre girafe est ... solide et vigoureuse", tandis que celle qui a échu au roi d’Angleterre "est malade et ne vivra pas longtemps".
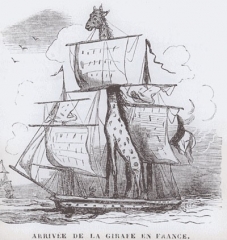 L'animal, baptisé Zarafa, de l'arabe zarafah "douceur de vivre", ou encore "gracieuse créature", embarque à Sennar sur une felouque, descend le Nil Bleu jusque Khartoum, et de là au Caire, puis à Alexandrie, est chargé à bord d'un navire sarde, I Due Fratelli, un deux-mâts qui fait la liaison Alexandrie-Libourne. Son capitaine s’appelle Stefano Manara. On installe la girafe dans une cale, mais on fait un trou sur le pont pour qu’elle puisse passer sa tête. La girafe porte autour du cou un gris-gris composé d’un ruban rouge et d’un pendentif en métal contenant des versets du Coran. On embarque avec elle ses deux palefreniers Atir et Hassan, les trois vaches soudanaises et un couple d’antilopes. La girafe anglaise, elle, passe l’hiver à Malte avant d’être embarqué par bateau pour Londres. Mais elle supporte mal le long voyage et meurt peu après son arrivée dans les bras du roi George.
L'animal, baptisé Zarafa, de l'arabe zarafah "douceur de vivre", ou encore "gracieuse créature", embarque à Sennar sur une felouque, descend le Nil Bleu jusque Khartoum, et de là au Caire, puis à Alexandrie, est chargé à bord d'un navire sarde, I Due Fratelli, un deux-mâts qui fait la liaison Alexandrie-Libourne. Son capitaine s’appelle Stefano Manara. On installe la girafe dans une cale, mais on fait un trou sur le pont pour qu’elle puisse passer sa tête. La girafe porte autour du cou un gris-gris composé d’un ruban rouge et d’un pendentif en métal contenant des versets du Coran. On embarque avec elle ses deux palefreniers Atir et Hassan, les trois vaches soudanaises et un couple d’antilopes. La girafe anglaise, elle, passe l’hiver à Malte avant d’être embarqué par bateau pour Londres. Mais elle supporte mal le long voyage et meurt peu après son arrivée dans les bras du roi George.
 Le 23 octobre 1826, Zarafa est accueillie à Marseille par le grand naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire et le préfet des Bouches-du-Rhône, le comte de Villeneuve-Bargemont, qui décide de l’installer pour l’hiver dans la cour de la Préfecture, où il a aménagé à son attention des appartements chauffés. Pendant des semaines la foule se presse pour admirer l'animal, que l'on appelle alors camélo-pardalis parce qu’on le croit issu des amours d’un léopard et d’une chamelle ! Jamais on n’avait vu pareil animal sur le sol de France. Même le grand Buffon, n’en avait jamais vu et s’était contenté d’en dresser le portrait d’après des témoignages erronés et d’anciennes lectures … "La Giraffe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands des animaux, et qui sans être nuisible, est en même temps des plus inutiles " clame-t-il dans son Histoire Naturelle.
Le 23 octobre 1826, Zarafa est accueillie à Marseille par le grand naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire et le préfet des Bouches-du-Rhône, le comte de Villeneuve-Bargemont, qui décide de l’installer pour l’hiver dans la cour de la Préfecture, où il a aménagé à son attention des appartements chauffés. Pendant des semaines la foule se presse pour admirer l'animal, que l'on appelle alors camélo-pardalis parce qu’on le croit issu des amours d’un léopard et d’une chamelle ! Jamais on n’avait vu pareil animal sur le sol de France. Même le grand Buffon, n’en avait jamais vu et s’était contenté d’en dresser le portrait d’après des témoignages erronés et d’anciennes lectures … "La Giraffe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands des animaux, et qui sans être nuisible, est en même temps des plus inutiles " clame-t-il dans son Histoire Naturelle.
 Mais au printemps, le Roi réclame "sa" girafe, que tout le monde appelle le bel animal du Roi. Un temps on pense la faire voyager sur le Rhône, la Saône puis les canaux jusqu’à Paris, ou encore par laMéditerranée, Gibraltar, le golfe de Gascogne et la Manche … Mais les deux solutions sont jugées dangereuses et on les abandonne, la girafe ira à pied jusqu’à Paris. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors âgé de 55 ans, professeur de zoologie au Muséum et membre de l’Académie des sciences, prend la décision, malgré ses rhumatismes et une rétention d’urine, de faire les 880 kilomètres à pied, il ne laissera à personne la responsabilité de conduire l’étrange animal auprès du roi ! cela lui vaudra d'être parfois surnommé "Monsieur le comte de la girafe". Il lui fait confectionner un costume imperméable en toile gommée, boutonné par-devant, et frappé à la fois aux armes du Roi de France et à celles du Pacha d’Égypte et d'un bonnet qui couvre la tête et le cou. Et le 20 mai 1827, c'est un cortège surréaliste qui s'ébranle pour Paris, composé de la girafe, de ses gardes égyptiens Hassan le Bédouin et l’Africain Atir, tous deux enturbannés et vêtus de djellabas, et de leur interprète le jeune Joseph Ebeïd (dit Youssef), d'un jeune Marseillais du nom de Barthélemy Chouquet, d'employés de la préfecture et de quelques gendarmes à pied chargés de faire de la place, de trois vaches nourricières, précédés d'un peloton entier de gendarmes à cheval, sabres au clair. Suit une voiture tirée par un cheval sur laquelle on a chargé les bagages et une cage contenant les deux antilopes, un mouflon et quelques autres animaux exotiques. La progression est de 20 à 25 km par jour.... on nourrit la girafe de grain mélangé de maïs, d’orge et de fèves de marais brisées au moulin, et pour boisson, du lait matin et soir.
Mais au printemps, le Roi réclame "sa" girafe, que tout le monde appelle le bel animal du Roi. Un temps on pense la faire voyager sur le Rhône, la Saône puis les canaux jusqu’à Paris, ou encore par laMéditerranée, Gibraltar, le golfe de Gascogne et la Manche … Mais les deux solutions sont jugées dangereuses et on les abandonne, la girafe ira à pied jusqu’à Paris. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors âgé de 55 ans, professeur de zoologie au Muséum et membre de l’Académie des sciences, prend la décision, malgré ses rhumatismes et une rétention d’urine, de faire les 880 kilomètres à pied, il ne laissera à personne la responsabilité de conduire l’étrange animal auprès du roi ! cela lui vaudra d'être parfois surnommé "Monsieur le comte de la girafe". Il lui fait confectionner un costume imperméable en toile gommée, boutonné par-devant, et frappé à la fois aux armes du Roi de France et à celles du Pacha d’Égypte et d'un bonnet qui couvre la tête et le cou. Et le 20 mai 1827, c'est un cortège surréaliste qui s'ébranle pour Paris, composé de la girafe, de ses gardes égyptiens Hassan le Bédouin et l’Africain Atir, tous deux enturbannés et vêtus de djellabas, et de leur interprète le jeune Joseph Ebeïd (dit Youssef), d'un jeune Marseillais du nom de Barthélemy Chouquet, d'employés de la préfecture et de quelques gendarmes à pied chargés de faire de la place, de trois vaches nourricières, précédés d'un peloton entier de gendarmes à cheval, sabres au clair. Suit une voiture tirée par un cheval sur laquelle on a chargé les bagages et une cage contenant les deux antilopes, un mouflon et quelques autres animaux exotiques. La progression est de 20 à 25 km par jour.... on nourrit la girafe de grain mélangé de maïs, d’orge et de fèves de marais brisées au moulin, et pour boisson, du lait matin et soir.
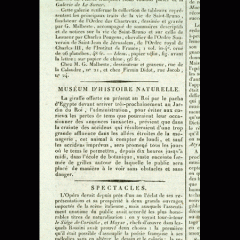 Pendant quarante et un jours, de ville en ville, Aix, puis à Avignon, Orange, Valence, Lyon, etc. cette extraordinaire caravane va susciter l'émerveillement, la curiosité et la stupeur de dizaines de milliers de personnes venues à sa rencontre.
Pendant quarante et un jours, de ville en ville, Aix, puis à Avignon, Orange, Valence, Lyon, etc. cette extraordinaire caravane va susciter l'émerveillement, la curiosité et la stupeur de dizaines de milliers de personnes venues à sa rencontre.
Impatients et curieux, certains Parisiens n'attendent pas l'arrivée du cortège dans la capitale et se portent à sa rencontre. Fin juin, Georges Cuvier, directeur des Jardins du Roy, apprend que la girafe approche de Paris. Bien qu’opposé aux théories de Geoffroy Saint-Hilaire et brouillé avec lui, il ne peut manquer de s’intéresser vivement à l’arrivée de l’animal. Il organise un voyage en coche d’eau sur la Seine pour conduire à sa rencontre son épouse, de sa fille et de sa belle-fille, Sophie Duvaucel, que Stendhal courtise. Ils la voient passer sur la route à Corbeil, alors qu’ils déjeunent sur l’herbe. Stendhal, qui rapporte cette promenade dans une lettre du 2 juillet 1827 : "nous sommes allés par le Steamboat de la Seine, à Villeneuve-Saint-Georges au devant de la girafe, le 30 juin", est apparemment peu impressionné et poursuit le fil de sa correspondance sans autre forme de commentaire.
 Théodore Chassériau, qui a alors huit ans, se poste lui aussi sur son passage et la croque, avec ses deux cornacs enturbannés : cette œuvre de jeunesse est conservée au Département des arts graphiques du Louvre.
Théodore Chassériau, qui a alors huit ans, se poste lui aussi sur son passage et la croque, avec ses deux cornacs enturbannés : cette œuvre de jeunesse est conservée au Département des arts graphiques du Louvre.
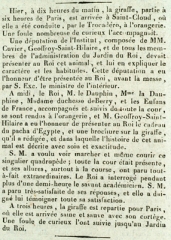 Le 30 juin, la Girafe du Roi est donc au Jardin des Plantes à 5 h du soir. Elle vient de faire à pied 880 km. Un enclos spécial a été préparé pour la recevoir. Mais le 9 juillet, le Roi exige qu'on la conduise dans son château de Saint-Cloud : "C’est à la girafe d’être conduite au roi, et non pas au souverain de se précipiter comme le vulgaire au-devant du cadeau qu’on lui fait." La girafe porte son manteau armorié, on lui a mis une couronne de fleurs. Elle mange des pétales de roses dans la main du souverain. Le soir elle retrouve son enclos près du Muséum, où elle continue de recevoir d'innombrables visites. Près de 600.000 personnes se pressent ainsi pour l'admirer en l'espace d'un an seulement ... leur curiosité se partage alors entre "la belle égyptienne" et une troupe de Peaux Rouges – des Osages – ramenés en France depuis l’Oklahoma.
Le 30 juin, la Girafe du Roi est donc au Jardin des Plantes à 5 h du soir. Elle vient de faire à pied 880 km. Un enclos spécial a été préparé pour la recevoir. Mais le 9 juillet, le Roi exige qu'on la conduise dans son château de Saint-Cloud : "C’est à la girafe d’être conduite au roi, et non pas au souverain de se précipiter comme le vulgaire au-devant du cadeau qu’on lui fait." La girafe porte son manteau armorié, on lui a mis une couronne de fleurs. Elle mange des pétales de roses dans la main du souverain. Le soir elle retrouve son enclos près du Muséum, où elle continue de recevoir d'innombrables visites. Près de 600.000 personnes se pressent ainsi pour l'admirer en l'espace d'un an seulement ... leur curiosité se partage alors entre "la belle égyptienne" et une troupe de Peaux Rouges – des Osages – ramenés en France depuis l’Oklahoma.
 L'arrivée à Paris déclenche une véritable "girafomania"(Olivier Lebleu "Les Avatars de Zarafa, chronique d'une girafomania 1826-1845"). Sa renommée est telle que l'on voit fleurir son image un peu partout, sur des faïences, poteries, sculptures, peintures, bronzes, éventails, ombrelles, ou encore des étoffes, et elle envahit le langage, la mode, le mobilier la chansonnette, les pamphlets, les spectacles. Au théâtre du Vaudeville on donne une pièce intitulée La girafe ou une journée aux Jardins du Roy. Balzac écrit un pamphlet : Discours de la girafe au chef des six Osages prononcé le jour de leur visite aux Jardins du Roi et traduit de l’arabe par l’interprète de la girafe. Les dames adoptent la coiffure à la girafe. Les cravates se nouent à la girafe ... Le péage du pont d’Austerlitz, qui est alors l’une des voies d’accès à la ménagerie, fait une recette sans précédent, on s’arrache des billets vendus au double de leur prix pour contempler de plus près la vedette. Sa vogue est telle que sa haute silhouette, accompagnée de son cornac, est intégrée au moins dès 1830, à la galerie des trente-neuf personnages typiques du Carnaval de Paris, au même titre que Robert Macaire, Pierrot ou Polichinelle.
L'arrivée à Paris déclenche une véritable "girafomania"(Olivier Lebleu "Les Avatars de Zarafa, chronique d'une girafomania 1826-1845"). Sa renommée est telle que l'on voit fleurir son image un peu partout, sur des faïences, poteries, sculptures, peintures, bronzes, éventails, ombrelles, ou encore des étoffes, et elle envahit le langage, la mode, le mobilier la chansonnette, les pamphlets, les spectacles. Au théâtre du Vaudeville on donne une pièce intitulée La girafe ou une journée aux Jardins du Roy. Balzac écrit un pamphlet : Discours de la girafe au chef des six Osages prononcé le jour de leur visite aux Jardins du Roi et traduit de l’arabe par l’interprète de la girafe. Les dames adoptent la coiffure à la girafe. Les cravates se nouent à la girafe ... Le péage du pont d’Austerlitz, qui est alors l’une des voies d’accès à la ménagerie, fait une recette sans précédent, on s’arrache des billets vendus au double de leur prix pour contempler de plus près la vedette. Sa vogue est telle que sa haute silhouette, accompagnée de son cornac, est intégrée au moins dès 1830, à la galerie des trente-neuf personnages typiques du Carnaval de Paris, au même titre que Robert Macaire, Pierrot ou Polichinelle.
 Cet engouement durera plus de trois ans, et la fin de la "mode girafe" coïncidera avec le déclin de la faveur dont bénéficiait Charles X dans l’opinion de ses sujets. Le voyage et le soin accordé à la girafe ne manquent pas de susciter la raillerie des opposants aux Bourbons : "Rien n'est changé en France si ce n'est qu'il s'y trouve une grande bête de plus". Cela n’a pas échappé à Honoré de Balzac, qui écrit ces lignes prophétiques dans une nouvelle publiée par le journal La Silhouette quelques semaines avant la Révolution de 1830 : "Elle n’est plus visitée que par le provincial arriéré, la bonne d’enfant désœuvrée. À cette leçon frappante, bien des hommes devraient s’instruire et prévoir le sort qui les attend". Durant la monarchie de Juillet, Louis-Philippe Ier sera alors caricaturé en girafe au long cou ...
Cet engouement durera plus de trois ans, et la fin de la "mode girafe" coïncidera avec le déclin de la faveur dont bénéficiait Charles X dans l’opinion de ses sujets. Le voyage et le soin accordé à la girafe ne manquent pas de susciter la raillerie des opposants aux Bourbons : "Rien n'est changé en France si ce n'est qu'il s'y trouve une grande bête de plus". Cela n’a pas échappé à Honoré de Balzac, qui écrit ces lignes prophétiques dans une nouvelle publiée par le journal La Silhouette quelques semaines avant la Révolution de 1830 : "Elle n’est plus visitée que par le provincial arriéré, la bonne d’enfant désœuvrée. À cette leçon frappante, bien des hommes devraient s’instruire et prévoir le sort qui les attend". Durant la monarchie de Juillet, Louis-Philippe Ier sera alors caricaturé en girafe au long cou ...
Atir continue de partager sa vie : tous les jours il la lave et la peigne (d’où peut être l’expression peigner la girafe qui signifie faire un travail inutile et très long, ne rien faire d'efficace, mais que certains utilisent pour décrire des pratiques plus ... sexuelles !). Il porte un turban blanc et des babouches rouges. Il restera douze ans auprès d’elle.
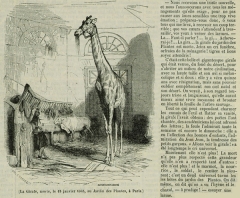 Zarafa coule des jours paisibles jusqu'en 1845, où elle a atteint l'âge tout à fait respectable pour une girafe de 21 ans. Elle avait été rejointe en 1839 par une autre girafe, envoyée par Antoine Clot, dit Clot-Bey, médecin français devenu directeur de l’Ecole de médecine du Caire. Elle meurt le 12 janvier, sept mois après Geoffroy Saint-Hilaire.
Zarafa coule des jours paisibles jusqu'en 1845, où elle a atteint l'âge tout à fait respectable pour une girafe de 21 ans. Elle avait été rejointe en 1839 par une autre girafe, envoyée par Antoine Clot, dit Clot-Bey, médecin français devenu directeur de l’Ecole de médecine du Caire. Elle meurt le 12 janvier, sept mois après Geoffroy Saint-Hilaire. 
Girafe. Buffon. XIII. Camelopardalis girafe. Cervus camelopardalis, L., du Darfour. Donnée par S.A. le pacha d’Egypte, a vécu 17 ans et demi à la ménagerie.
Quelques sources :
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire - Quelques Considérations sur la Girafe http://fr.wikisource.org/wiki/Quelques_Consid%C3%A9ration...
http://guimik.org/wp-content/2010/05/dossier-presentation...
http://www.vacarme.org/article1009.html
http://bibliotheque-desguine.hauts-de-seine.net/desguine/...
http://pdf.actualite-poitou-charentes.info/079/actu79janv...
17:59 Publié dans Bavardage, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 08 juin 2011
Les revenants ...
 Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.
Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante.
Depuis deux ans, je vivais sans visage. Nul miroir, à Buchenwald. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine, aux douches. Pas de visage, sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des pommettes saillantes, le creux d'une joue. J'aurais pu me procurer un miroir, sans doute. On trouvait n'importe quoi au marché noir du camp, en échange de pain, de tabac, de margarine. Même de la tendresse, à l'occasion.
Mais je ne m'intéressais pas à ces détails.
La preuve d'ailleurs, je suis là.
Ils me regardent, l'œil affolé, rempli d'horreur?
Mes cheveux ras ne peuvent pas être en cause, en être la cause. Jeunes recrues, petits paysans, d'autres encore, portent innocemment le cheveu ras. Banal, ce genre. Ca ne trouble personne, une coupe à zéro. Ca n'a rien d'effrayant. Ma tenue, alors? Sans doute a-t-elle de quoi intriguer: une défroque disparate. Mais je chausse des bottes russes, en cuir souple. J'ai une mitraillette allemande en travers de la poitrine, signe évident d'autorité par les temps qui courent. Ca n'effraie pas, l'autorité, ça rassure plutôt. Ma maigreur? Ils ont dû voir pire, déjà. S'ils suivent les armées alliées qui s'enfoncent en Allemagne en ce printemps, ils ont déjà vu pire, d'autres camps, des cadavres vivants.
Ca peut surprendre, intriguer, ces détails: mes cheveux ras, mes hardes disparates. Mais ils ne sont pas surpris, ni intrigués. C'est de l'épouvante que je lis dans leurs yeux.
Il ne reste que mon regard, j'en conclus, qui puisse autant les intriguer. C'est l'horreur de mon regard que révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard de fou, dévasté.
Je voyais mon corps, de plus en plus flou, sous la douche hebdomadaire. Amaigri mais vivant : le sang circulait encore, rien à craindre. Ca suffirait, ce corps amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable.
On peut toujours tout dire, en somme. L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'alibi. Ou signe de paresse. On peut toujours tout dire, le langage contient tout. On peut dire l'amour le plus fou, la plus terrible cruauté. On peut nommer le mal, son goût de pavot, ses bonheurs délétères. On peut dire Dieu et ce n'est pas peu dire. On peut dire la rose et la rosée, l'espace d'un matin. On peut dire la tendresse, l'océan tutélaire de la bonté. On peut dire l'avenir, les poètes s'y aventurent les yeux fermés, la bouche fertile.
On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser. Et de s'y mettre. D'avoir le temps, sans doute, et le courage, d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé –clôturé aussi, bien entendu- par cette possibilité de se poursuivre à l'infini. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement. Quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort, le cas échéant, à la faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement.
Mais peut-on tout entendre, tout imaginer ? Le pourra-t-on ? Et auront-ils la patience, la passion, la compassion, la rigueur nécessaire ? Le doute me vient, dès ce premier instant, cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors –venus de la vie, à voir le regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers.
Ils sont silencieux, ils évitent de me regarder.
Je me suis vu dans leur œil horrifié pour la première fois depuis deux ans. Ils m'ont gâché cette première matinée, ces trois zigues. Je croyais en être sorti, vivant. Revenu dans la vie, du moins. Ce n'est pas évident. A deviner mon regard dans le miroir du leur, il ne semble pas que je sois au-delà de tant de mort.
Une idée m'est venue, soudain –si l'on peut appeler idée cette bouffée de chaleur, tonique, cet afflux de sang, cet orgueil d'un savoir du corps, pertinent-, la sensation, en tout cas, soudaine, très forte, de ne pas avoir échappé à la mort, mais de l'avoir traversée. D'avoir été, plutôt, traversé par elle. De l'avoir vécue, en quelque sorte. D'en être revenu comme on revient d'un voyage qui vous a transformé : transfiguré, peut-être.
J'ai compris soudain qu'ils avaient raison de s'effrayer, ces militaires, d'éviter mon regard. Car je n'avais pas vraiment survécu à la mort, je ne l'avais pas évitée. Je n'y avais pas échappé. Je l'avais parcourue, plutôt, d'un bout à l'autre. J'en avais parcouru les chemins, m'y étais perdu et retrouvé, contrée immense où ruisselle l'absence. J'étais un revenant, en somme.
Cela fait toujours peur, les revenants.
Soudain, ça m'avait intrigué, excité même, que la mort ne fût plus à l'horizon, droit devant, comme le butoir imprévisible du destin, m'aspirant vers son indescriptible certitude. Qu'elle fût déjà dans mon passé, usée jusqu'à la corde, vécue jusqu'à la lie, son souffle chaque jour plus faible, plus éloigné de moi, sur ma nuque.
C'était excitant d'imaginer que le fait de vieillir, dorénavant, à compter de ce jour d'avril fabuleux n'allait pas me rapprocher de la mort, mais bien au contraire m'en éloigner.
Peut-être n'avais-je pas tout bêtement survécu à la mort mais en étais-je ressuscité : peut-être étais-je immortel, désormais. En sursis illimité, du moins, comme si j'avais nagé dans le fleuve Styx jusqu'à l'autre rivage.
Ce sentiment ne s'est pas évanoui dans les rites et les routines du retour à la vie, lors de l'été de ce retour. Je n'étais pas seulement sûr d'être vivant, j'étais convaincu d'être immortel. Hors d'atteinte, en tout cas. Tout m'était arrivé, rien ne pouvait plus me survenir. Rien d'autre que la vie, pour y mordre à pleines dents. C'est avec cette assurance que j'ai traversé, plus tard, dix ans de clandestinité en Espagne. (…)
Mais je suis encore dans la lumière du regard sur moi, horrifié, des trois officiers en uniforme britanniques.
Depuis bientôt deux ans, je vivais entouré de regards fraternels. Quand regard il y avait : la plupart des déportés en étaient démunis. Eteint, leur regard, obnubilé, aveuglé par la lumière crue de la mort. La plupart d'entre eux ne vivaient plus que sur la lancée : lumière affaiblie d'une étoile morte, leur œil.
Ils passaient, marchant d'une allure d'automates, retenue, mesurant leur élan, comptant leurs pas, sauf aux moments de la journée où il fallait justement le marquer, le pas, martial, lors de la parade devant les SS, matin et soir, sur la place d'appel, au départ et au retour des kommandos de travail, ils marchaient les yeux mi-clos, se protégeant ainsi des fulgurances brutales du monde, abritant des courants d'air glacial la petite flamme vacillante de leur vitalité.
Mais il était fraternel, le regard qui aurait survécu. D'être nourri de tant de mort, probablement. Nourri d'un si riche partage."
Jorge Semprun - L'écriture ou la vie
02:44 Publié dans coup de coeur, Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mardi, 12 avril 2011
12 avril 1961 ... une date à part !
 Sans doute va-t-on sourire si j'écris que cette journée fut celle qui a le plus décidé de mon avenir ! Et pourtant c'est bien à partir de ce moment que, petit à petit, a germé en moi l'idée de devenir ingénieure pour travailler dans le spatial ... et c'est finalement bien ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs tellement dû le répéter à mes camarades qu'en fin de seconde, elles m'avaient dédicacé une photo de classe avec ces mots "à notre future astronaute". Bon, je ne me suis jamais envolé dans le ciel, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les fusées, en particulier ARIANE. Et j'avoue que je m'y suis "défoncée" !
Sans doute va-t-on sourire si j'écris que cette journée fut celle qui a le plus décidé de mon avenir ! Et pourtant c'est bien à partir de ce moment que, petit à petit, a germé en moi l'idée de devenir ingénieure pour travailler dans le spatial ... et c'est finalement bien ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs tellement dû le répéter à mes camarades qu'en fin de seconde, elles m'avaient dédicacé une photo de classe avec ces mots "à notre future astronaute". Bon, je ne me suis jamais envolé dans le ciel, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les fusées, en particulier ARIANE. Et j'avoue que je m'y suis "défoncée" !
Ce 12 avril donc, j'étais pensionnaire, car ma mère, atteinte d'un cancer, était soignée loin de nous, à l'institut Curie, elle allait mourir 4 mois plus tard et mes grands parents avaient déjà beaucoup de mal à s'occuper des plus jeunes pendant que mon père sillonnait les routes avec son métier et "montait" un week-end sur deux à Paris. C'est dire que ce qui se passait "dehors" ne me parvenait que très peu ... le procès d'Eichmann qui avait commencé la veille, la crise de Berlin avec le bouclage de la frontière entre l'est et l'ouest ce même 12 avril, le fiasco de la Baie des Cochons ou le putsch d'Alger quelques jours plus tard, tous des évènements importants qui ont fait la une des journaux et des radios, je n'en ai aucun souvenir personnel. Mais de Iouri Gagarine dans l'espace, si !!!
Pourtant à 12 ans, j'étais déjà très intéressée par l'actualité, à l'image de mes parents qui se passionnaient pour la politique, lisaient les journaux et écoutaient beaucoup la radio. Avant la maladie de ma mère, mon père avait d'ailleurs eu des velléités de militer ... je préfère ne pas trop savoir où ...
J'étais pensionnaire donc, dans une école privée, où la majorité des enseignants et encadrants étaient des laïcs, mais où quelques personnes de la cantine ou de l'internat étaient des religieuses. Nous avions donc comme surveillante une polonaise qui avait fui le communisme et était rentrée dans la congrégation à qui appartenait cette école. Très catholique, elle détestait les juifs et aurait bien pardonné à Adolf Eichmann ses crimes, mais elle détestait encore plus les communistes qui l'avaient obligée à fuir sa campagne polonaise pour ne pas renier sa religion. Elle était rondouillarde, avec un teint rouge, et ne parlais pas bien le français, c'est à peu près tout ce dont je me souviens d'elle car avec les années, ma mémoire la confond avec une autre religieuse polonaise, surveillante de cantine elle aussi, mais quelques années plus tard et dans une autre école. La première était une "peau de vache" aigrie, alors que la seconde était la crème des surveillante, chouchoutant les pensionnaires en leur donnant les meilleures parts au détriment des demi-pensionnaires, sous le prétexte que celles-ci mangeraient mieux le soir ...
Ce jour là donc, un mercredi, nous étions à la cantine. Peut être pour le repas de midi ou pour le gouter ... Bien sûr nous n'avions aucun écho de ce qui se passait dans le monde. Je vois encore très bien la grande salle où nous nous trouvions, donnant sur la cour de récréation par une large porte-fenêtre, avec une grande table en fer à cheval où nous prenions nos repas. Je tournais le dos à la fenêtre et faisais face à la porte qui menait à la cuisine, ça j'en suis sure. A ce moment notre surveillante polonaise, d'habitude peu loquace, est rentrée dans la salle en courant et surtout en criant "un homme dans l'espace, un homme dans l'espace !". Il lui fallut bien cinq minutes pour reprendre son souffle et nous raconter qu'un homme, un jeune Russe de 27 ans, était le premier à réaliser un vieux rêve humain, aller dans l'espace, et qu'il était revenu vivant et même en bonne santé de ces 108 minutes en apesanteur ... notre surveillante polonaise avait trouvé son héros, et le comble, c'était un russe !
illustration tirée du livre Jusqu'à la lune en fusée aérienne de Otfrid von Hanstein, paru en 1928 en Allemagne , traduit en France en 1948 par Tancrède Vallerey et finement illustré par Maurice Toussaint.
19:20 Publié dans coup de coeur, espace, Histoire, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 10 mars 2011
"Dans la nuit du 10 au 11 mars tous les français vont subitement rajeunir de 9 minutes et 21 secondes"
"Dans la nuit du 10 au 11 mars tous les français vont subitement rajeunir de 9 minutes et 21''. L’heure légale française ne sera plus celle du méridien de Paris, mais celle du méridien de Greenwich. Il en résultera un retard de 9’21’’ sur l’heure actuelle.
En conséquence le 10 mars toutes les horloges publiques seront arrêtées à minuit pendant 9’21’’ pour reprendre ensuite leur marche régulière.
En ce qui concerne les trains, afin de les mettre en concordance avec leurs horaires, ils devront s’arrêter 9’21’’ dans la première gare où ils s’arrêteront après minuit.
Les Compagnies de chemins de fer profiteront de cette circonstance pour mettre en concordance les horloges intérieures et les horloges extérieures. Ces dernières n’avanceront plus de 5 minutes."
L’Indépendant du Loir et Cher du 3 Mars 1911

La loi du 9 mars 1911 marquait donc la "capitulation" française. Le changement d'heure fut mis en application dans la nuit du 10 au 11 mars 1911 à minuit par les P & T pour ce qui concerne en particulier les signaux horaires envoyés par l'Observatoire de Paris aux navires. Puis toutes les horloges de France s'arrêtèrent à minuit dans la nuit du 18 au 19 mars 1911 pour repartir 9 minutes et 21 secondes plus tard. C'en était bel et bien fini de la rivalité franco-anglaise, en astronomie comme dans en politique!
 Cette heure légale fut ensuite aménagée par la loi du 9 juin 1916 qui instaurait une "heure d'été" décalée de 30 minutes du 14 juin au 1er octobre, à l'instigation d'André Honnorat ("la prolongation de la guerre nous fait un devoir impérieux de ne négliger aucune source d'économie") qui reprend une idée déjà développée en Australie sous le nom de "Day light saving bill" (la lumière du soleil limite la facture"), puis par la loi du 24 mai 1923 qui instaurait un décalage d'une heure avec l'heure "GMT" du dernier samedi de mars à 23 h au premier samedi d'octobre à 24 h. Toutefois, en cas d'entente avec les nations voisines, le gouvernement pouvait reporter la première date au troisième samedi d'avril et la seconde au troisième samedi de septembre.
Cette heure légale fut ensuite aménagée par la loi du 9 juin 1916 qui instaurait une "heure d'été" décalée de 30 minutes du 14 juin au 1er octobre, à l'instigation d'André Honnorat ("la prolongation de la guerre nous fait un devoir impérieux de ne négliger aucune source d'économie") qui reprend une idée déjà développée en Australie sous le nom de "Day light saving bill" (la lumière du soleil limite la facture"), puis par la loi du 24 mai 1923 qui instaurait un décalage d'une heure avec l'heure "GMT" du dernier samedi de mars à 23 h au premier samedi d'octobre à 24 h. Toutefois, en cas d'entente avec les nations voisines, le gouvernement pouvait reporter la première date au troisième samedi d'avril et la seconde au troisième samedi de septembre.
Durant la guerre, un décret-loi du 26 septembre 1939 permit de nouvelles dérogations à la loi de 1923. Mais l'Allemagne suivait l'heure d'Europe centrale, GMT + 1, ce qui risquait d'engendrer des problèmes pour son armée, aussi dès le début de l'invasion du territoire français, celle-ci imposa "l'heure allemande" au fur et à mesure de sa progression. On peut donc supposer que depuis Sedan le 14 mai 1940 jusqu'à Angoulême le 24 juin, l'heure "change" peu à peu dans la France occupée, jusqu'à l'application de l'armistice le 25 juin à 0 h 35. Celui-ci mentionne d'ailleurs qu'il a été signé le 22 juin 1940 à 18 h 50 "heure d'été allemande".
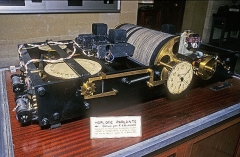 A Paris, le "bulletin municipal officiel" du samedi 15 juin avise la population du changement d'heure le 14 juin à 23h. Quand à l'horloge parlante, elle a déménagé à Bordeaux avec le directeur de l'Observatoire de Paris Ernest Esclangon et le gouvernement, pour ce qui est de donner l'heure à la radio lors des informations. L'horloge parlante de l'observatoire de Paris, un temps interrompue, reprend son service pour les consultations par téléphone avec le numéro ODE 84 00 !
A Paris, le "bulletin municipal officiel" du samedi 15 juin avise la population du changement d'heure le 14 juin à 23h. Quand à l'horloge parlante, elle a déménagé à Bordeaux avec le directeur de l'Observatoire de Paris Ernest Esclangon et le gouvernement, pour ce qui est de donner l'heure à la radio lors des informations. L'horloge parlante de l'observatoire de Paris, un temps interrompue, reprend son service pour les consultations par téléphone avec le numéro ODE 84 00 !
Dans la France coupée en deux par la ligne de démarcation, c'est une complication de plus, et une perturbation pour les horaires de chemin de fer ... les trains venant de la zone non occupée circulent avec une heure de retard dans la zone occupée, et les trains venant de la zone occupée attendent une heure à la ligne de démarcation, tout cela bouleversant les correspondances ! Il suffit de conserver l'heure d'été "française" pour avoir la même heure d'hiver "allemande" ... on aboutit donc finalement à la loi du 19 décembre 1940 selon laquelle "le gouvernement fixera chaque année par décret l'amplitude de l'avance de l'heure légale, [...] ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'avance de l'heure et de rétablissement de l'heure normale". L'unité des deux zones semble donc acquise. Et comme en 1891, lorsque les horaires des bateaux avaient imposé cette unité, c'est maintenant ceux des trains qui l'emportent sur toute autre considération, même de souveraineté nationale.
La libération du territoire en 1944-1945 s'effectue donc, selon l'avance des alliés, pour partie à l'heure d'été fixée par Vichy (GMT+2), pour partie à l'heure d'hiver (GMT+1) fixé par le gouvernement provisoire à partir du 8 octobre 1944.
Ce n'est qu'au mois d'août 1945 qu'un décret prévoit le rétablissement de l'heure d'hiver à l'heure de Greenwich en 2 étapes, le 16 septembre et le 18 novembre, avec chaque fois un retard d'une heure. Mais un décret du 5 novembre supprime le second changement prévu pour le 18 novembre, si bien que la France reste de fait à l'heure d'hiver d'Europe centrale (GMT+1) ... ou pour ménager les susceptibilités issues du conflit avec l'Allemagne, à l'heure d'été d'Europe occidentale. De nouveaux les heures anglaises et françaises divergent, sauf 6 mois de l'année jusqu'au 28 mars 1975, puisqu'il n'est plus question alors, en France, de changement saisonnier de l'heure !
Voir aussi un article plus ancien sur le même sujet dans ce blog ...
22:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mardi, 08 mars 2011
MOI, CHRISTINE, QUI AI PLEURÉ
 Christine de Pisan (Venise vers 1363 - vers 1430) est la première femme à vivre de sa plume.
Christine de Pisan (Venise vers 1363 - vers 1430) est la première femme à vivre de sa plume.
Christine de Pizan est née à Venise, vraisemblablement en 1364. Son père, Tommasso di Benvenuto, originaire de Pizzano, près de Bologne, a étudié la médecine dans cette ville et y a enseigné l’astrologie, avant de devenir conseiller de la république de Venise. Peu après la naissance de Christine, il est appelé à Paris par Charles V comme médecin et astrologue. Très en faveur auprès du roi qui rétribue largement ses services, il fait venir sa famille d’Italie vers 1368. Christine reçoit de lui une instruction plus poussée qu’il n’était d’usage, jusqu’à son mariage, en 1379 ou 1380, avec Étienne du Castel, secrétaire du roi. La mort de Charles V, en 1380, affecte gravement la position de Thomas: il meurt dans la gêne vers 1387. Le mari de Christine s’éteint peu après, à l’automne 1390.
Veuve à 25 ans, Christine de Pisan reste seule avec sa mère et ses trois enfants, aux prises avec des débiteurs indélicats, en butte aux attaques des créanciers qui veulent lui enlever les biens hérités de son père, Thomas di Pizzano, et de son mari, Étienne de Castel. Elle se bat courageusement, défend sa famille, et réussit à éviter la ruine complète.
"Je suis veuve, seulette et noir vêtue
A triste vis simplement affublée ;
En grand courroux de manière adoulée
Porte le deuil très amer qui me tue.
De triste coeur, chanter joyeusement
Et rire en deuil, c’est chose forte à faire."
Christine de Pisan ne perd pas courage. Dès la mort de son père, elle cherche à se créer des ressources par ses talents. Le succès des poésies légères qu'elle a composées avec facilité la persuade de s'essayer à des écrits plus sérieux. Mais avant de rien entreprendre, elle se remet, pendant plusieurs années à l'étude des meilleurs auteurs anciens et modernes, qu'elle lit dans leur langue. "Tu ne dois pas te tenir pour malheureuse quand tu as, entre autres biens, une des choses du monde qui te cause le plus de délices et de plaisirs, c’est assavoir le doux goût de science." Ecrit-elle, ou encore "Ce n’est pas à la faiblesse de son esprit, mais à son manque d’instruction que la femme doit son infériorité."
A l’exception des lettres d’Amour d’Héloïse, de quelques oeuvres de nonnes érudites, les ouvrages littéraires écrits par des femmes sont rares. On peut donc dire que Christine de Pisan a été en France la première des femmes savantes et des femmes auteures. C'est d'ailleurs grâce à ses œuvres, riches en confidences autobiographiques, que son existence passablement mouvementée et son parcours littéraire sont relativement bien connus en France. Sa production est considérable. Elle en fait le bilan en 1405, dans le Livre de l’advision : "Depuis l’an 1399 que je commençai jusqu’à cette année 1405 auquel encore je ne cesse, j’ai compilé quinze volumes principaux sans les autres petits dictés, lesquels tout ensemble contiennent environ soixante-dix cahiers de grand volume."
Mais quoique ses diverses productions fussent toujours aussi bien accueillies par la cour et les lettrés, elles suffisent à grand-peine à la subsistance de la famille de Christine de Pisan. Heureusement, elle a nombre de mécènes pour qui elle compose poèmes, éloges et panégyriques. On rapporte aussi que Henri IV d'Angleterre lui offrit de se fixer à sa cour; mais elle ne se laisse pas séduire, et elle préfère rester avec peu d'aisance en France. Mais le premier poème de Christine, l’Épître au dieu d’Amour, écrit en 1399, sera traduit outre-Manche, dès 1402, par Thomas Occleve, lui-même auteur de renom.
 En 1399, le maréchal Jean II Le Maingre (en vieux français , Jehan le Meingre), appelé Boucicaut, fonde l'ordre de chevalerie L'Ecu vert à la Dame blanche un ordre chevaleresque inspiré par l'idéal de l'amour courtois dont la vocation est la défense des femmes. L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, préside à la création de la fameuse "cour d'Amour" qui débat de casuistique amoureuse et se réunit à la Saint-Valentin pour un tournoi poétique en l'honneur des dames. Au même moment, en 1399, Christine se lance dans la polémique littéraire pour défendre les femmes, qui s'achèvera en 1405 par la rédaction de deux traités, la Cité des dames, suivi du Livre des Trois Vertus (ou Trésor de la Cité des Dames), véritable cours d'éducation à l'usage des femmes où la "dame" est une femme dont la noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. Christine y fait une analyse lucide et précise de la société française, vue du côté féminin, détaillant tous les "états des femmes" et donnant de chacun, depuis celui des princesses jusqu’à celui des femmes de laboureur, une vision réaliste et positive. La première, elle a compris que les femmes ont une place à elles dans la société politique, et avec l'aide de Dame Raison, Droiture, Justice, elle veut construire la Cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies
En 1399, le maréchal Jean II Le Maingre (en vieux français , Jehan le Meingre), appelé Boucicaut, fonde l'ordre de chevalerie L'Ecu vert à la Dame blanche un ordre chevaleresque inspiré par l'idéal de l'amour courtois dont la vocation est la défense des femmes. L'année suivante, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, préside à la création de la fameuse "cour d'Amour" qui débat de casuistique amoureuse et se réunit à la Saint-Valentin pour un tournoi poétique en l'honneur des dames. Au même moment, en 1399, Christine se lance dans la polémique littéraire pour défendre les femmes, qui s'achèvera en 1405 par la rédaction de deux traités, la Cité des dames, suivi du Livre des Trois Vertus (ou Trésor de la Cité des Dames), véritable cours d'éducation à l'usage des femmes où la "dame" est une femme dont la noblesse est celle de l'esprit plutôt que de la naissance. Christine y fait une analyse lucide et précise de la société française, vue du côté féminin, détaillant tous les "états des femmes" et donnant de chacun, depuis celui des princesses jusqu’à celui des femmes de laboureur, une vision réaliste et positive. La première, elle a compris que les femmes ont une place à elles dans la société politique, et avec l'aide de Dame Raison, Droiture, Justice, elle veut construire la Cité imprenable où les femmes seront à l'abri des calomnies
Dans ces ouvrages la narratrice veut combattre les clichés qui circulent sur les femmes et leur infériorité "naturelle", en particulier dans des œuvres misogynes et cyniques comme la seconde partie du Roman de la rose (entre 1275 et 1280) de Jean de Meung, qui s’avère l’antithèse de la première partie écrite par Guillaume de Lorris (vers 1245). La quête amoureuse de la première partie a complètement disparu, en revanche, le mépris de la Femme y est ouvertement affiché et Christine de Pisan estime qu'on est passé d’un culte raffiné de la femme à la conception grossière qui va peu à peu faire d’elle un objet.: "Toutes êtes, serez et fûtes/De fait ou de volonté putes" écrit-il !
Christine de Pisan, qui connaît le latin, a aussi lu Les Lamentations de Matheolus, où l'auteur Matthieu de Boulogne-sur-Mer (vers 1260 – vers 1320) présente sa femme Péronnelle (eh oui, ce serait l'origine du mot ...) sous un jour très noir. Ces œuvres la remplissent d’horreur pour elle-même, "et pour le sexe féminin dans son entier, comme si nous étions des monstres de la nature". Jean Le Fèvre, officier au parlement de Paris qui a traduit les Lamentations de Matheolus, s'est lui aussi insurgé contre les propos misogynes, fréquents dans la littérature et a écrit Le Livre de leesce, sorte d'apologie de ce sexe que l'on dit faible, et qui présente pour la première fois Neuf Preuses,
 La Cité des dames n’est d'ailleurs pas le premier texte féministe de Christine de Pisan ; elle a déjà rédigé quelques années auparavant une Epistre au Dieu d’Amours (1399), une protestation contre les habitudes discourtoises de la société devenue misogyne, et une tentative de réhabilitation de la Femme comme un être moral : "Que les femmes aient de tels vices je le nie ; Je lève les bras pour les défendre …", et un Dit de la rose (14 février 1401, anc. st.), critique justement de la seconde partie du Roman de la rose, ce qui provoque, entre 1401 et 1405, un "débat sur le Roman de la Rose" avec des secrétaires du roi, Jean de Montreuil, prévôt de Lille, et Gontier Col, secrétaire et conseiller du roi, et des clercs, Pierre Col, frère du précédent et chanoine de Paris et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris.
La Cité des dames n’est d'ailleurs pas le premier texte féministe de Christine de Pisan ; elle a déjà rédigé quelques années auparavant une Epistre au Dieu d’Amours (1399), une protestation contre les habitudes discourtoises de la société devenue misogyne, et une tentative de réhabilitation de la Femme comme un être moral : "Que les femmes aient de tels vices je le nie ; Je lève les bras pour les défendre …", et un Dit de la rose (14 février 1401, anc. st.), critique justement de la seconde partie du Roman de la rose, ce qui provoque, entre 1401 et 1405, un "débat sur le Roman de la Rose" avec des secrétaires du roi, Jean de Montreuil, prévôt de Lille, et Gontier Col, secrétaire et conseiller du roi, et des clercs, Pierre Col, frère du précédent et chanoine de Paris et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris.
De ce "débat", on peut citer une lettre de Christine de Pisan adressée à Jean de Montreuil. La lettre répond à l’éloge du Roman de la Rose de Jean de Meung que Jean de Montreuil a écrit et fait circuler dans un petit traité aujourd’hui perdu, Opusculum gallicum. La correspondance qui en résulte provoque le premier débat épistolaire connu dans le monde littéraire français! Prenant le contre-pied de Montreuil, Christine attaque méthodiquement le Roman de la Rose de Jean de Meung comme un ouvrage immoral, misogyne et obscène, l'accusant d'enseigner les moyens de séduire les femmes sous le couvert d'un art d'aimer ... "Une honnête femme est aussi rare qu’un cygne noir" écrit Jean de Meung ! "Le talent de Christine de Pisan aidant, écrit Jean Favier dans sa Guerre de Cent Ans (où Christine n’est citée que trois fois ...), tout Paris se passionnait pour la grande querelle soulevée autour des thèses de l’antiféminisme clérical et du cynisme sentimental formulé au XIIIe siècle par le vieux Roman de la Rose. On était pour le Roman […] ou bien on était contre cette satire acerbe du naturel féminin qui avait fait la joie de générations d’hommes et particulièrement de clercs. Dans son Épître au dieu d’amour, Christine de Pizan se fit, en 1399, la théoricienne d’un équilibre entre les élans du cœur et le plaisir des sens."
 Jean de Montreuil obtient le soutien de son collègue Gontier Col qui attaque vivement Christine dans deux épîtres lui demandant ouvertement de retirer ses affirmations qui, d'après lui, constituent une insulte à la plus grande œuvre littéraire contemporaine. "Folle outrecuidance. Parole trop tôt issue sans avis de la bouche d'une femme", s'écrie Pierre Col, le frère de Gontier. Jean de Montreuil, lui, menace : "Si tu continues à mal parler, sache qu'il y a des champions et des athlètes". Dans le débat, Christine peut compter sur l'appui de Jean de Gerson, auteur d'une Vision contre le Roman de la Rose, de Eustache Moel dit Deschamps, conseiller de Louis d'Orléans, de Guillaume de Tignonville, prévot de Paris, mais aussi de la Reine Isabeau de Bavière à qui elle a fait parvenir une lettre lui demandant son soutien. Quelques années plus tard, Mathieu Thomassin lui rendra hommage dans son Registre Delphinal, Martin Le Franc ne tarira pas d'éloge dans son Champion des Dames (1442). Plus tard Jean Boucher composera Le Jugement poétique de l'honneur féminin et sejour des illustres claires & honnestes Dames (1538), et enfin Clément Marot se fera l'interprète des mêmes sentiments dans La vray disant advocate des Dames
Jean de Montreuil obtient le soutien de son collègue Gontier Col qui attaque vivement Christine dans deux épîtres lui demandant ouvertement de retirer ses affirmations qui, d'après lui, constituent une insulte à la plus grande œuvre littéraire contemporaine. "Folle outrecuidance. Parole trop tôt issue sans avis de la bouche d'une femme", s'écrie Pierre Col, le frère de Gontier. Jean de Montreuil, lui, menace : "Si tu continues à mal parler, sache qu'il y a des champions et des athlètes". Dans le débat, Christine peut compter sur l'appui de Jean de Gerson, auteur d'une Vision contre le Roman de la Rose, de Eustache Moel dit Deschamps, conseiller de Louis d'Orléans, de Guillaume de Tignonville, prévot de Paris, mais aussi de la Reine Isabeau de Bavière à qui elle a fait parvenir une lettre lui demandant son soutien. Quelques années plus tard, Mathieu Thomassin lui rendra hommage dans son Registre Delphinal, Martin Le Franc ne tarira pas d'éloge dans son Champion des Dames (1442). Plus tard Jean Boucher composera Le Jugement poétique de l'honneur féminin et sejour des illustres claires & honnestes Dames (1538), et enfin Clément Marot se fera l'interprète des mêmes sentiments dans La vray disant advocate des Dames
La querelle s'apaise peu à peu. Dans sa dernière lettre à Pierre Col datée du 2 octobre 1402, elle annonce qu'elle se retire du débat : "Non mie tairé pour doubte de mesprendre quant a oppinion, combien que faulte d'engin et de savoir me toult biau stile, mais mieulx me plaist d'excerciter en autre matiere a ma plaisance" [Je ne me tais pas non plus par peur d'être calomniée à cause de mes opinions, bien que je manque d'intelligence et d'un beau style. Je souhaite simplement me tourner vers un sujet qui me plaît davantage.] Christine sent très clairement que le Débat est une perte de temps pour quelqu'un qui a des affaires plus importantes à traiter. Et Philippe Le Hardi, duc de Bourgogne, qui fait confiance à son talent et son jugement, lui demande en 1404 d’écrire le récit du règne son frère, le Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V.
Mais si dans le Livre de Mutacion de Fortune (1403), Christine de Pisan avoue comment le destin, en la faisant devenir écrivain, l'a fait changer de sexe : "de femelle devins masle", elle n'oubliera cependant jamais qu'elle doit défendre, contre les injustices de la société masculine, la dignité de son sexe. Ainsi, en 1405, paraît le Livre de la Cité des Dames ...
1405 marque une rupture. La situation politique en France devient de plus en plus grave, lucide, Christine voit monter le péril de la guerre civile. Les misères du temps, ravagé par la Guerre de Cent ans, expliquent que Christine de Pizan, Italienne devenue Française, ait senti le besoin d’exprimer son patriotisme, en participant, grâce à ses œuvres, aux douleurs publiques : en 1405 le Livre de la Prudence, paraphrasé de Sénèque, et le Trésor de la cité des dames, également appelé le Livre des trois vertus, dédié à la jeune dauphine de France Marguerite de Bourgogne, et dans lequel elle attire l’attention des femmes sur les conflits perpétuels que les hommes se livrent dans leur royaume, en 1407, le Livre du corps de policie (le mot "policie" désignant celui de politique) emprunté d’Aristote et de Plutarque, en 1410 le Livre des fais d’armes et de chevalerie, traité de guerre traduit principalement de Végèce, de Frontin, mais renfermant toutefois une partie originale, un code du droit des gens dans la société féodale, et Lamentation sur les maux de la France, et en 1413 le Livre de la paix, tous ces ouvrages ont désormais un but, sauver la France des divisions.
Elle emploie aussi d’excellents artistes pour illustrer ses livres, dont un grand recueil de ses oeuvres qui est offert à la reine Isabeau de Bavière en 1414. Ce manuscrit des Œuvres de Christine de Pisan (Londres, British Library, Harley 4431) est l'un des plus somptueux, des plus connus et des plus étudiés parmi ceux qui ont été réalisés à Paris en pleine apogée de l'enluminure parisienne.
 La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons conduit à l’intervention étrangère. Ainsi, en 1415, c’est la terrible bataille d’Azincourt. Christine écrit une Epître de la prison de la vie humaine, dans laquelle elle déplore les bouleversements de la guerre et le comportement des Anglais, qui massacrent leurs prisonnier. Christine de Pisan fuit Paris, occupé par le parti bourguignon allié aux Anglais, et se réfugie dans un couvent, probablement l’abbaye des dominicaines de Saint-Louis de Poissy où sa fille est religieuse et dont la sœur de Charles VII, Marie, est devenue prieure. Elle consacre alors la fin de sa vie à un ouvrage d'inspiration purement religieuse, Les Heures de contemplation sur la Passion de Notre Seigneur, un livre pour les femmes, accablées comme elle, par les maux du temps. Mais après la prise de Paris par les Bourguignons et le traité de Troyes, elle sort du silence et écrit Les Lamentations sur les maux de la guerre civile (1420) inspiré par l’actualité de la guerre de Cent Ans :.
La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons conduit à l’intervention étrangère. Ainsi, en 1415, c’est la terrible bataille d’Azincourt. Christine écrit une Epître de la prison de la vie humaine, dans laquelle elle déplore les bouleversements de la guerre et le comportement des Anglais, qui massacrent leurs prisonnier. Christine de Pisan fuit Paris, occupé par le parti bourguignon allié aux Anglais, et se réfugie dans un couvent, probablement l’abbaye des dominicaines de Saint-Louis de Poissy où sa fille est religieuse et dont la sœur de Charles VII, Marie, est devenue prieure. Elle consacre alors la fin de sa vie à un ouvrage d'inspiration purement religieuse, Les Heures de contemplation sur la Passion de Notre Seigneur, un livre pour les femmes, accablées comme elle, par les maux du temps. Mais après la prise de Paris par les Bourguignons et le traité de Troyes, elle sort du silence et écrit Les Lamentations sur les maux de la guerre civile (1420) inspiré par l’actualité de la guerre de Cent Ans :.
Retirée depuis une dizaine d'années elle écrit son Ditié de la Pucelle, saluant l’épopée de Jeanne d’Arc qui venait de faire sacrer le roi (1429); ce sont les derniers vers qu'on a d'elle ... Christine de Pizan meurt en 1430.
 Estimée des meilleurs écrivains de son temps, Christine de Pisan a joui jusqu’au début du XVIe siècle d’une grande réputation en France et dans plusieurs pays d’Occident, où certaines de ses oeuvres ont été traduites. Par la suite, elle plutôt maltraitée. Au XIXeme siècle, Gustave Lanson, historien de la littérature et critique littéraire, mais aussi témoin par excellence de la misogynie qu’il était de bon ton d’afficher à la fin du XIXe siècle, aura même ce jugement dans son Histoire de la littérature française : "Ne nous arrêtons pas à l’excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas-bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n’ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité"
Estimée des meilleurs écrivains de son temps, Christine de Pisan a joui jusqu’au début du XVIe siècle d’une grande réputation en France et dans plusieurs pays d’Occident, où certaines de ses oeuvres ont été traduites. Par la suite, elle plutôt maltraitée. Au XIXeme siècle, Gustave Lanson, historien de la littérature et critique littéraire, mais aussi témoin par excellence de la misogynie qu’il était de bon ton d’afficher à la fin du XIXe siècle, aura même ce jugement dans son Histoire de la littérature française : "Ne nous arrêtons pas à l’excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas-bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, à qui nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête, n’ont affaire que de multiplier les preuves de leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité"
Certes elle n’a jamais été totalement oubliée, mais son œuvre est bien souvent réduite à la trop célèbre ballade Seulete sui et seulete veuil estre. Il faudra attendre Mathilde Laigle, l'une des premières bachelières françaises et également des premières femmes diplômées de l'enseignement supérieur américain et qui fut la première à avoir publié en 1912 une édition critique du Livre des Trois vertus de Christine de Pisan, Le livre des trois vertus de Christine de Pisan et son milieu historique et littéraire, pour qu'on commence à reconnaître timidement son intérêt historique et politique.
Mathilde Laigle écrit que "Les revendications qu'elle propose par le respect de l'usage, la pratique, les devoirs, le culte de l'honneur, tels qu'une femme sensée et vertueuse les concevait au XVe siècle. Il semble que l'antiféministe le plus convaincu ne pourrait que gracieusement s'incliner devant le féminisme de Christine de Pisan", mais ajoute que Christine de Pisan ne formule aucune des revendications que l'on pourrait à proprement appeler qualifier de féministes : "Le livre des Trois Vertus, tout attaché aux devoirs et non aux droits de la femme, ne porte aucune trace de ces timides protestations, et si Christine nourrissait quelques secrètes velléités de révolte contre le sort injuste réservé à ses sœurs, nous n'en savons rien. Elle n'en parle pas. La Cité des dames nous fournirait aussi bien son contingent d'idées anti-féministes.", ajoutant "Ce que Christine prêche, ce n'est pas le murmure, la rébellion contre les lois ou usages établis, c'est l'énergie personnelle, l'effort constant pour parer au mal : l'éviter, si possible, l'atténuer, si on ne peut l'anéantir, ou le subir avec courage, s'il est plus fort que la volonté humaine.". Pourtant les réactions à ses travaux sont parfois rudes : lors d'une conférence en 1912 à Strasbourg, Mathilde Laigle est interrompue par une personne de l'assistance qui lance à propos de Christine de Pisan : "Elle aurait mieux fait de se trouver un autre mari et de s'occuper des gamins" !
Il faudra donc attendre la seconde moitié du XXeme siècle, la naissance des sentiments féministes et le désir de réhabiliter la femme dans la littérature pour que son œuvre prenne vraiment place dans le milieu des études littéraires.
Certes si elle écrivait aujourd'hui, Christine de Pisan, soucieuse de sauvegarder les vertus féminines plus que de prôner liberté et émancipation, passerait pour une traîtresse à la cause féminine, prompte à ramper sous les fourches caudines du mâle ! En effet, si le discours de Christine de Pisan vise à préserver l'intégrité des femmes en tant que jeunes filles et jeunes femmes, il ne préconise pas vraiment une révolte par rapport à leur condition. Christine de Pisan encourage les femmes à se prendre en main afin de défendre et protéger leur honneur, les hommes n’en étant plus capables. Christine ne défend pas les femmes, mais leur honneur, la réalité de leurs capacités intellectuelles, de leur grandeur morale, de leur vertu. Jamais elle ne remet en cause la distribution des rôles des hommes et femmes dans la société. Il est donc délicat de la considérer comme féministe. Mais Christine de Pisan est surtout originale par le fait même qu'elle a pris la première la parole au nom des femmes, contre le flot de méchancetés que déversaient les écrivains de son temps, une position particulièrement inédite à l'époque, suffisamment provocatrice pour que nombre d'érudits l'aient aussitôt combattu.
En tous les cas, 550 ans avant le fameux "on ne naît pas femme, on le devient" de Simone de Beauvoir, Christine de Pisan attribue l'inégalité entre hommes et femmes non à la nature, mais à l'éducation et aux représentations d'elles-mêmes fournies aux femmes par le discours misogyne dominant.
Moi, Christine, qui ai pleuré
Onze ans en abbaye fermée,
Ou j'ai toujours demeuré depuis
Que Charles (c'est chose étrange !)
Le fils du roi, si j'ose rappeler ce souvenir,
S'enfuit de Paris, tout droit,
Par suite de la trahison là incluse :
Maintenant pour la première fois je me prends à rire.
L'an mil quatre cent vingt neuf
Recommença à luire le soleil ;
Il ramène le temps nouveau
Qu'on n'avait pas vu de l'oeil
Depuis longtemps ; dont plusieurs en deuil
Ont vécu. Je suis de ceux-là ;
Mais de rien je ne me chagrine plus,
Puisque maintenant je vois ce que je veux.
Qui vit donc chose advenir
Plus hors de toute atteinte,
Laquelle à noter et de laquelle se souvenir
Est bon en toute région :
C'est à savoir que France, de qui discours,
On faisait qu'à terre était renversée,
Soit par divine mission,
Du mal en si grand bien changée ?
Et cela par tel miracle vraiment
Que, si la chose n'était notoire
Et évidents le fait et la manière,
Il n'est homme qui pût le croire :
C'est une chose bien digne de mémoire
Que Dieu par une vierge tendre
Ait précisément voulu (c'est une chose vraie)
Sur la France si grande grâce étendre.
O ! Quel honneur à la couronne
De France se voit par divine preuve !
C'est par les grâces qu'il lui donne
Il paraît combien Dieu l'approuve
Et que plus de foi d'autre part il trouve
En la maison royale, dont je lis
Que jamais (ce n'est pas une chose nouvelle)
En la foi errèrent les fleurs de lis.
Toi, Jeanne, à une bonne heure née,
Béni soit celui qui te créa !
Pucelle de Dieu envoyée
En qui le Saint Esprit fit rayonner
Sa grande grâce ; et qui eus et as
Toute largesse en son haut don,
Jamais ta requête ne te refusa
Et il te donnera assez grande récompense...
Et sa belle vie, par ma foi !
Montre qu'elle est en la grâce de Dieu,
C'est pourquoi on ajoute plus de foi
A son fait ; car, quoi qu'elle fasse,
Toujours à Dieu devant la face,
Qu'elle invoque, sert et prie
En actions, en paroles ; en quelque endroit qu'elle aille,
Elle ne retarde pas ses dévotions.
Oh ! comme alors cela bien parut
Quand le siège était à Orléans,
Où en premier lieu sa force apparut !
Jamais miracle, ainsi que je pense,
Ne fut plus clair ; car Dieu aux siens
Vint tellement en aide, que les ennemis
Ne se défendirent pas plus que chiens morts.
Là furent pris ou à mort mis.
Hé ! quel honneur au féminin
Sexe ! Que Dieu l'aime il paraît bien,
Quand tout ce grand peuple misérable comme chiens
Par qui tout le royaume était déserté
Par une femme est ressuscité et a recouvré ses forces,
Ce que hommes n'eussent pas fait,
Et les traîtres ont été traités selon leur mérite,
A peine auparavant l'auraient-ils cru.
Une fillette de seize ans
(N'est-ce pas une chose au-dessus de la nature ?)
A qui les armes ne sont pesantes,
Mais il semble que son éducation
Ait été faite à cela, tant elle y est forte et dure ;
Et devant elle vont fuyant
Les ennemis, et nul n'y résiste.
Elle fait cela, maint yeux le voyant.
Et elle va d'eux débarrassant la France
En recouvrant châteaux et villes,
Jamais force ne fut si grande,
Qu'ils soient par centaines ou par milliers...
09:08 Publié dans art, coup de coeur, femmes, Histoire, litterature, poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 03 février 2011
Le 3 février 1851, une loi vote un crédit spécial pour subventionner les lavoirs
 Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.
Depuis les temps les plus reculés, laver le linge est une activité dévolue à la femme.
Une des plus ancienne description de lavage est sans doute extraite du chant VI de l'Odyssée d'Homère (traduction de Leconte de Lisle)
"[...] Et sa mère était assise au foyer avec ses servantes, filant la laine teinte de pourpre marine ; et son père sortait avec les rois illustres, pour se rendre au conseil où l'appelaient les nobles Phaiakiens. Et, s'arrêtant près de son cher père, elle lui dit :
- Cher père, ne me feras-tu point préparer un char large et élevé, afin que je porte au fleuve et que je lave nos beaux vêtements qui gisent salis ? Il te convient, en effet, à toi qui t'assieds au conseil parmi les premiers, de porter de beaux vêtements. Tu as cinq fils dans ta maison royale ; deux sont mariés, et trois sont encore des jeunes hommes florissants. Et ceux-ci veulent aller aux danses, couverts de vêtements propres et frais, et ces soins me sont réservés.
 Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :
Elle parla ainsi, n'osant nommer à son cher père ses noces fleuries ; mais il la comprit et il lui répondit :
- Je ne te refuserai, mon enfant, ni des mulets, ni autre chose. Va, et mes serviteurs te prépareront un char large et élevé propre à porter une charge.
Ayant ainsi parlé, il commanda aux serviteurs, et ils obéirent. Ils firent sortir un char rapide et ils le disposèrent, et ils mirent les mulets sous le joug et les lièrent au char. Et Nausikaa apporta de sa chambre ses belles robes, et elle les déposa dans le char. Et sa mère enfermait d'excellents mets dans une corbeille, et elle versa du vin dans une outre de peau de chèvre. La jeune vierge monta sur le char, et sa mère lui donna dans une fiole d'or une huile liquide, afin qu'elle se parfumât avec ses femmes. Et Nausikaa saisit le fouet et les belles rênes, et elle fouetta les mulets afin qu'ils courussent ; et ceux-ci, faisant un grand bruit, s'élancèrent, emportant les vêtements et Nausikaa, mais non pas seule, car les autres femmes allaient avec elle.
 Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."
Et quand elles furent parvenues au cours limpide du fleuve, là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souillées, elles délièrent les mulets du char, et elles les menèrent vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le char, les vêtements qu'elles plongèrent dans l'eau profonde, les foulant dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et, les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les étendirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait baignés. Et s'étant elles-mêmes baignées et parfumées d'huile luisante, elles prirent leur repas sur le bord du fleuve. Et les vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios."
Et c'est en rentrant au palais et qu'elles aperçurent Ulysse habillé seulement d'une branche chargée de feuilles ...
Mais ce travail n'est pas si paradisiaque ! Le métier de lavandière est un métier très pénible, la blanchisseuse est agenouillée toute la journée dans l'humidité, et l'hiver, il faut casser la glace du lavoir qui est gelé, battre le linge dans le froid et l'eau glacée et l'humidité ... Les lavandières ont souvent "l'onglée" aux doigts.
 Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...
Dès XIIème siècle, la lessive du gros linge est en usage une fois l'an, puis deux fois l'an, voire trois fois au XIXème siècle et dure deux ou trois jours. A côté de ces temps forts, il y a naturellement des lessives plus modestes, le fameux "jour de lessive" destiné aux vêtements de travail, aux sous-vêtement et aux bas de coton, aux tabliers, aux mouchoirs ...
La lessive est effectuée à partir d'un point d'eau, fontaine, mare, étang, cours d'eau. Sur les bords de la seine, comme sur les rives de toutes les rivières de France, on pouvait donc rencontrer des lavandières qui se servaient d’une planche à laver, d’une petite caisse pour s’agenouiller près de l’eau, d’un planche à frotter et d’un battoir qu'elles transportaient dans leur brouette lourdement chargée. Elles installaient leur selle (sorte de planche sur deux trétaux) et, à genoux, avec des gestes immuables, elles savonnaient, battaient, malaxaient, roulaient et essoraient leur linge sur les bords du fleuve.
« C’est ici, du matin au soir,
Que par la langue et le battoir
On lessive toute la Ville.
On parle haut, on tape fort,
Le battoir bat, la langue mord !
Pour être une laveuse habile,
Il faut prouver devant témoins
Que le battoir est très agile,
Que la langue ne l’est pas moins."
Achille Millien
A Paris, les rues des Lavandières (ou encore Lavandières Saint-Jacques) et des avandières Sainte Opportune datent du XIIIème siècle et doivent leur nom aux lavandières que le voisinage de la rivière avait attirées. Une rue des Blanchisseuses fut également ouverte, vers 1810, entre le quai de Billy et la rue de Chaillot.
La Taille de 1292 cite 43 lavandiers ou lavandières, parmi lesquels "Jehanne, lavendière de l'abbaie" de Sainte-Geneviève ; elle habitait la "rue du Moustier" qui est devenue la rue des Prêtres-Saint-Étienne du Mont. Cependant, à cette époque et dans la plupart des communautés, les religieux lavaient eux-mêmes leurs vêtements et leur linge. On faisait chauffer l'eau à la cuisine. Les objets blanchis étaient ensuite étendus soit dans le cloître, soit dans un séchoir spécial.
 Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.
Chargées de l'entretien du linge des familles aisées, les lavandières font partie du personnel habituel des "hôtels", tout comme les panetiers, les clercs de la paneterie des nappes, les clercs de la paneterie du commun, les charretiers de la paneterie des nappes, les "porte chapes" (ou maîtres traiteurs, du mot chape, couvercle qui sert à couvrir les plats afin de les maintenir chauds), les sommeliers, les gardes-chambre (ou chambellans), les portiers, les portefaix et les valets de la porte, les sommiers ou voituriers ... qui touchent des gages, reçoivent de l'avoine, des chandelles, du bois.
D'autres encore travaillent à la journée au service de particuliers, de maîtres de grandes maisons, de fermiers, de métayers, de notables, pour un maigre salaire en toutes saisons, sauf lorsque le fleuve était pris par les glaces. Une ordonnance du 30 janvier 1350 fixe à "un tournoi en toute saison le prix que pourront demander toutes manières de lavandières de chacune pièce de linge lavé." (source : "La vie privée d'autrefois: arts et métiers, modes, moeurs, usages des parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d'après des documents originaux ou inédits). Elles côtoient les ménagères de condition modeste qui viennent laver elles-mêmes leur linge à la rivière. Ces opérations sont décrites ICI, avec un poème bien sympathique, ICI, ICI ou encore LA, avec des photos anciennes...
Bien que jamais érigées en corporation régulière, les blanchisseuses ou lavandières "professionnelles" doivent se plier à partir du XVIIe siècle aux exigences d'une administration parisienne veillant à la bonne hygiène ! Très tôt, les lois et les décrets visant l’existence et l’implantation d’établissements insalubres dans Paris poussent les industries du blanchissage à quitter la capitale pour s’installer dans les communes voisines.
 Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.
Avec les progrès de l'hygiène, des locaux plus confortables et fonctionnels apparaissent, avec en particulier la construction de lavoirs. Choléra, variole et typhoïde ont marqué le XIXème siècle. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Les habitants qui viennent s’approvisionner en eau trouvent l’eau des puits et des rivières souillée par les savons et les saletés. L’édification de lavoirs s’impose. Par la loi du 3 Février 1851, l'Assemblée législative vote un crédit spécial de 600 000 francs pour subventionner, à hauteur de 30 %, la construction d’établissement modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits. Chaque projet est subventionné à hauteur de 20 000 francs. Malgré les sommes à trouver pour compléter la subvention, de nombreuses communes, même modestes, engagent les travaux. La construction est commandée par les municipalités sous le contrôle de l'administration départementale. Les travaux sont mis alors en adjudication sur rabais à la chandelle, d'où une certaine similitude de conception et de matériaux. Il y a au moins un lavoir par village ou hameau et l'on peut estimer l'importance du village au nombre de ses lavoirs. Certains possèdent même un dispositif pour chauffer des lessiveuses et produire de la cendre qui blanchit le linge ... Les lavoirs seront utilisés jusqu'à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons.
Lieu de convivialité, le lavoir est également un lieu de chant ; on y fredonne quelques airs à la mode et parfois on y va de ses commérages : "Au lavoir, on lave le linge, mais on salit les gens" dit-on !
A Paris et dans de nombreuses villes traversées par un fleuve, est-ce parce que les lavandières étaient réputées de mœurs légères et que les mauvais garçons se mêlaient souvent aux lessives que l'on décida de créer des endroits où les jeunes filles et les femmes honnêtes des classes populaires pourraient laver leur linge en toute tranquillité, les fameux bateaux-lavoirs ?
" Ô Lavandière "
Sachez qu'hier, de ma lucarne,
J'ai vu, j'ai couvert de clins d'yeux,
Une fille qui dans la Marne
Lavait des torchons radieux
Je pris un air incendiaire
Je m'adossais contre un pilier
Puis le lui dis " Ô Lavandière "
Blanchisseuse étant familier
La blanchisseuse gaie et tendre
Sourit et, dans la hameau noir
Au loin, sa mère cessa d'entendre
Le bruit vertueux du battoir.
Je m'arrête. L'idylle est douce
Mais ne veut pas, je vous le dis,
Qu'au delà du baiser on pousse
La peinture du paradis.
Victor Hugo
L'origine des bateaux-lavoirs remonterait au XVIIe siècle. Le 16 septembre 1623, un traité assure à un entrepreneur, Jean de la Grange, secrétaire du roi Louis XIII, divers droits à conditions qu'il poursuive l'aménagement de l'Ile Notre-Dame et de l'Ile aux vaches, dont celui de mette à perpétuité sur la Seine "des bateaux à laver les lessives, en telle quantité qu'il feroit avisé & en tel endroit qu'il jugerroit à propos; pourvû que ce fût sans empêchement de la navigation, ni que le bruit pût incommoder les maisons du Cloître Notre-Dame". (source : "traité de la police" de M.De la mare, volume 1 - page 100 de l'édition de 1722).
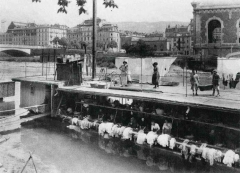 Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.
Mais c'est surtout au XIXème siècle que les bateaux-lavoirs se développent partout en France, un mouvement qu’accélère la loi du 3 février 1851. Un lavoir flottant établi à Paris même, la Sirène, propose déjà les appareils les plus perfectionnés de l’époque. Il a été détruit par les glaces durant les grands froids de 1830. Les lavoirs flottants sont pourvus de buanderies à partir de 1844 afin de lutter contre la forte concurrence des lavoirs publics et des grandes buanderies de banlieue qui ne cessent de se créer, véritables usines à laver qui mettent à disposition des laveuses eau chaude, essoreuses, séchoirs à air chaud et à air libre, réfectoire et même parfois salle de garde pour les enfants en bas âge. 25 à 30 mètres de long; au premier niveau se trouvent les postes des blanchisseuses et, au milieu, deux rangées de chaudières posées sur des briques. L’étage se partage entre l’habitation du patron et le séchoir.
 En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.
En 1852, il existe dans Paris 93 lavoirs et buanderies, principalement répartis dans les divers quartiers pauvres, comme le Lavoir Moderne Parisien dans le quartier de la Goutte d'Or; les bateaux-lavoirs stationnant sur le canal Saint-Martin sont au nombre de 17, ceux sur la Seine s'élèvent à 64 ( source : Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris en 1855 de Félix et Louis Lazare, page 111 et suivantes) Mais pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les quartiers éloignés, il est bien pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs sur une brouette … et bientôt le nombre des bateaux-lavoirs parisiens est en constante perte de vitesse. En 1880, il n'y a plus en Ile-de-France que 64 bateaux-lavoirs offrant 3800 places de laveuses. Vingt-trois de ces lavoirs flottants sont à Paris même, dont six sur le canal Saint-Martin et trente-cinq se répartissent en banlieue sur la Seine, la Marne et l’Oise. À la fin du XIXe siècle, la plupart de ces bateaux-lavoirs sont la propriété d’une seule famille en vertu d’un bail qui lui a été consenti, en 1892, par la Société du Canal Saint-Martin. Mais, les bateaux-lavoirs disparaissent inéluctablement dans la première moitié du XXe siècle.
Les 4 derniers bateaux-lavoirs sur la Seine disparaissent pendant la dernière guerre mondiale, sur ordre des allemands, pour faciliter la navigation : une vidéo de l'INA annonce cette décision ...
Au fait, vous souvenez-vous qu'une des insultes du capitaine Haddock est "Amiral de bateau-lavoir" ?
Emile Zola a décrit le travail des lavandières dans plusieurs de ses écrits :
"Un grand hangar, monté sur piliers de fonte, à plafond plat, dont les poutres sont apparentes. Fenêtres larges et claires. En entrant, à gauche, le bureau, où se tient la dame; petit cabinet vitré, avec tablette encombrée de registres et de papiers. Derrière les vitres, pains de savon, battoirs, brosses, bleu, etc. A gauche est le cuvier pour la lessive, un vaste chaudron de cuivre à ras de terre, avec un couvercle qui descend, grâce à une mécanique. A côté est l'essoreuse, des cylindres dans lesquels on met un paquet de linge, qui y sont pressés fortement, par une machine à vapeur. Le réservoir d¹eau chaude est là. la machine est au fond, elle fonctionne tout le jour, dans le bruit du lavoir; son volant ; on voit le pied rond et énorme de la cheminée, dans le coin. Enfin, un escalier conduit au séchoir, au-dessus du lavoir, une vaste salle fermée sur les deux côtés par des persiennes à petites lames ; on étend le linge sur des fils de laiton. A l'autre bout du lavoir, sont d'immenses réservoirs de zinc, ronds. Eau froide.
Le lavoir contient cent huit places. Voici maintenant de quoi se compose une place. On a, d¹un côté, une boite placée debout, dans laquelle la laveuse se met debout pour garantir un peu ses jupes. Devant elle, elle a une planche, qu'on appelle la batterie et sur laquelle elle bat le linge ; elle a à côté d'elle un baquet sur pied dans lequel elle met l'eau chaude, ou l'eau de lessive. Puis derrière, de l¹autre côté, la laveuse a un grand baquet fixé au sol, au-dessus duquel est un robinet d'eau froide, un robinet libre ; sur le baquet passe une planche étroite où l'on jette le linge; au-dessus; il y a deux barres, pour prendre le linge et l'égoutter. Cet appareil est établi pour rincer. La laveuse a encore un petit baquet sur pied pour placer le linge, et un seau dans lequel elle va chercher l'eau chaude et l'eau de lessive.
on a tout cela pour huit sous par jour. La ménagère paie un sou l'heure. L'eau de javel coûte deux sous le litre. Cette eau, vendue en grande quantité,est dans des jarres. Eau chaude et eau de lessive, un sou le seau. On emploie encore du bicarbonate - de la potasse pour couler. Le chlore est défendu."
Carnets d'enquêtes - La Goutte d'Or 1875
Sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche et suivit la rue Neuve-de-la-Goutte-d'Or. En passant devant la boutique de Mme Fauconnier, elle salua d'un petit signe de tête. Le lavoir était situé vers le milieu de la rue, à l'endroit où le pavé commençait à monter. Au-dessus d'un bâtiment plat, trois énormes réservoirs d'eau, des cylindres de zinc fortement boulonnés, montraient leurs rondeurs grises ; tandis que, derrière, s'élevait le séchoir, un deuxième étage très haut, clos de tous les côtés par des persiennes à lames minces, au travers desquelles passait le grand air, et qui laissaient voir des pièces de linge séchant sur des fils de laiton. A droite des réservoirs, le tuyau étroit de la machine à vapeur soufflait, d'une haleine rude et régulière, des jets de fumée blanche. Gervaise, sans retrousser ses jupes, en femme habituée aux flaques, s'engagea sous la porte, encombrée de jarres d'eau de javel. Elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir, une petite femme délicate, aux yeux malades, assise dans un cabinet vitré, avec des registres devant elle, des pains de savon sur des étagères, des boules de bleu dans des bocaux, des livres de bicarbonate de soude en paquets. Et, en passant, elle lui réclama son battoir et sa brosse, qu'elle lui avait donnés à garder, lors de son dernier savonnage. Puis, après avoir pris son numéro, elle entra. C'était un immense hangar, à plafond plat, à poutres apparentes, monté sur des piliers de fonte, fermé par de larges fenêtres claires. Un plein jour blafard passait librement dans la buée chaude suspendue comme un brouillard laiteux. Des fumées montaient de certains coins, s'étalant, noyant les fonds d'un voile bleuâtre. Il pleuvait une humidité lourde, chargée d'une odeur savonneuse, une odeur fade, moite, continue ; et, par moments, des souffles plus forts d'eau de javel dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l'allée centrale, il y avait des files de femmes, les bras nus jusqu'aux épaules, le cou nu, les jupes raccourcies montrant des bas de couleur et de gros souliers lacés. Elles tapaient furieusement, riaient, se renversaient pour crier un mot dans le vacarme, se penchaient au fond de leurs baquets, ordurières, brutales, dégingandées, trempées comme par une averse, les chairs rougies et fumantes. Autour d'elles, sous elles, coulait un grand ruissellement, les seaux d'eau chaude promenés et vidés d'un trait, les robinets d'eau froide ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égouttures des linges rincés, les mares où elles pataugeaient s'en allant par petits ruisseaux sur les dalles en pente. Et, au milieu des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette clameur d'orage s'étouffant sous le plafond mouillé, la machine à vapeur, à droite, toute blanche d'une rosée fine, haletait et ronflait sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage."
L'Assommoir
 A partir du XIXème siècle, la lessive se fait aussi "chez soi". En vue de ces lessives, on conserve la cendre de bois des cendriers et on la passe au tamis fin pour obtenir une poudre gris clair, fine et soyeuse au toucher. On chauffe de l'eau puis on la verse dans un cuvier chargé de linge recouvert de ces cendres, qui alors libèrent des sels de potasse qui traversent le linge. La première passe se fait avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, pour ne pas "cuire les taches". ("coulage à froid"). L'eau qui s'écoule est récupérée, remise à chauffer et on recommence ainsi de suite pendant des heures ("coulage à chaud"). Le linge est alors sorti brûlant du cuvier avec de longues pincettes de bois et brossé ("lessivage") puis et mis à égoutter sur des tréteaux. Ensuite, le linge est rincé à la rivière ou au lavoir ("retirage"). Suit le tordage (le linge est frappé et tordu) et le séchage. S´il fait beau il est posé sur l´herbe pour y être azuré ("la mise au pré") ...
A partir du XIXème siècle, la lessive se fait aussi "chez soi". En vue de ces lessives, on conserve la cendre de bois des cendriers et on la passe au tamis fin pour obtenir une poudre gris clair, fine et soyeuse au toucher. On chauffe de l'eau puis on la verse dans un cuvier chargé de linge recouvert de ces cendres, qui alors libèrent des sels de potasse qui traversent le linge. La première passe se fait avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, pour ne pas "cuire les taches". ("coulage à froid"). L'eau qui s'écoule est récupérée, remise à chauffer et on recommence ainsi de suite pendant des heures ("coulage à chaud"). Le linge est alors sorti brûlant du cuvier avec de longues pincettes de bois et brossé ("lessivage") puis et mis à égoutter sur des tréteaux. Ensuite, le linge est rincé à la rivière ou au lavoir ("retirage"). Suit le tordage (le linge est frappé et tordu) et le séchage. S´il fait beau il est posé sur l´herbe pour y être azuré ("la mise au pré") ...
 L'arrivée de l'eau courante dans les foyers achèvera l'histoire des lavoirs. L'"eau courante" dans les maisons se généralise vers 1950 dans les villes puis lentement dans les campagnes. On fait la lessive dans la buanderie où l'on ne craint pas de répandre de l'eau. Même si les machines à laver semi-automatiques existaient déjà depuis plus de 20 ans, elles étaient rares dans les familles et j'ai assisté dans mon enfance à ces séances de lavage, à peine modernisées ! On n'utilisait bien sûr plus de cuvier mais une lessiveuse "à champignon", la cendre était remplacée par du perborate acheté à la pharmacie. La lessiveuse était une grande marmite qui servait à faire bouillir le linge. Au fond se trouvait un double-fond, d'où remontait un tuyau avec, au bout, un pommeau. Après avoir été savonné sur la planche à laver, le linge était disposé dans la lessiveuse. On allumait le feu dans un petit poêle en dessous, et la chaleur faisant monter l'eau dans le tuyau et le pommeau qui arrosait le linge d'eau bouillante. L'eau redescendait en traversant le linge et retombait au fond pour remonter à nouveau ... ça sentait mauvais et il faisait une chaleur moite étouffante dans la buanderie. Ensuite ma mère laissait refroidir un peu la lessiveuse et une femme de ménage venait l'aider à la vider petit à petit dans un grand bac où le linge était rincé à l'eau froide. C'est ensuite toute la maison qui était mise à contribution pour essorer les grosses pièces que l'on prenait à chaque bout pour les tordre.Je me souviens toutefois d'une essoreuse électrique que mes parents avaient achetée à des américains d'un camp de l'OTAN ... Au milieu des années 60, le départ à la retraite de notre "lavandière" rendit nécessaire l'achat d'une machine à laver.
L'arrivée de l'eau courante dans les foyers achèvera l'histoire des lavoirs. L'"eau courante" dans les maisons se généralise vers 1950 dans les villes puis lentement dans les campagnes. On fait la lessive dans la buanderie où l'on ne craint pas de répandre de l'eau. Même si les machines à laver semi-automatiques existaient déjà depuis plus de 20 ans, elles étaient rares dans les familles et j'ai assisté dans mon enfance à ces séances de lavage, à peine modernisées ! On n'utilisait bien sûr plus de cuvier mais une lessiveuse "à champignon", la cendre était remplacée par du perborate acheté à la pharmacie. La lessiveuse était une grande marmite qui servait à faire bouillir le linge. Au fond se trouvait un double-fond, d'où remontait un tuyau avec, au bout, un pommeau. Après avoir été savonné sur la planche à laver, le linge était disposé dans la lessiveuse. On allumait le feu dans un petit poêle en dessous, et la chaleur faisant monter l'eau dans le tuyau et le pommeau qui arrosait le linge d'eau bouillante. L'eau redescendait en traversant le linge et retombait au fond pour remonter à nouveau ... ça sentait mauvais et il faisait une chaleur moite étouffante dans la buanderie. Ensuite ma mère laissait refroidir un peu la lessiveuse et une femme de ménage venait l'aider à la vider petit à petit dans un grand bac où le linge était rincé à l'eau froide. C'est ensuite toute la maison qui était mise à contribution pour essorer les grosses pièces que l'on prenait à chaque bout pour les tordre.Je me souviens toutefois d'une essoreuse électrique que mes parents avaient achetée à des américains d'un camp de l'OTAN ... Au milieu des années 60, le départ à la retraite de notre "lavandière" rendit nécessaire l'achat d'une machine à laver.
La deuxième partie du XXème siècle pensait en avoir fini avec les lavandières quand le fabricant de lave-linge Vedette se choisit la Mère Denis pour raviver un mythe forgé au cours des siècles autour de ce métier. Un petit chemin qui descend au lavoir, une brouette de linge, un battoir, une brosse et l'amour du travail bien fait.d eux bonnes grandes mains de lavandière et l'amour du travail bien fait ... Vedette mérite votre confiance, "C'est ben vrai ça!"
23:43 Publié dans art, femmes, Histoire, Hugo...mania, litterature, peinture, poèmes, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 12 janvier 2011
Lettre d'Eugène Delacroix à George Sand, 12 janvier 1861
Chère amie,
J’ai appris, je ne sais plus par qui, que vous étiez tout à fait bien et que vous alliez passer l’hiver je ne sais où pour vous remettre tout à fait. Tout ce que vous faites est bien, quoique je ne sois pas édifié sur le séjour des auberges pour remettre la santé. Le bon lit auquel on est habitué, dans le coin où le ciel nous a fait prendre racine, est comme le lait de la nourrice qui vous a mis au monde. Grâce au ciel, ma santé est très bonne et jusqu’ici je me vois dispensé, ainsi que je l’avais appréhendé après deux hivers passés au coin de mon feu, de courir les hasards et d’aller m’exposer aux aventures, pour me préserver de la fièvre. Depuis quatre mois je fais un métier qui m’a rendu cette santé que je croyais perdue. Je me lève le matin, je cours au travail hors de chez moi, je rentre le plus tard que je peux et je recommence le lendemain. Cette distraction continuelle et l’ardeur que je porte à une besogne de cheval de carrosse me font croire que je suis revenu à cet âge charmant où l’on court toujours et surtout chez les traîtresses qui nous [mot illisible] et nous charment. Rien ne me charme plus que la peinture et voilà que, par-dessus le marché, elle me donne une santé d’homme de trente ans. Elle est mon unique pensée et je n’intrigue que pour être tout à elle, c’est-à-dire que je m’enfonce dans mon travail comme Newton (qui mourut vierge) dans la fameuse recherche de la gravitation (je crois).
Mes pensées gravitent vers vous, chère et bonne et fidèle amie. Je dis que je n’intrigue pas et cependant je ne vous eusse peut-être pas écrit sans la rencontre que j’ai faite de Bertin, qui m’a conjuré de vous demander sur quoi il devait compter au sujet de la promesse que vous avez bien voulu lui faire de lui envoyer un roman. Il le désire vivement et me prie de vous le dire. Je sais que je m’expose à toutes les fureurs de notre ami Buloz, s’il vient à découvrir ma requête. Il me fit une scène à cette occasion cet été. Il me croit apparemment inféodé aux intérêts de la revue. Je le traitai comme je devais et il se calma. Dites-moi donc, si vous voulez, à moi, quelles sont vos intentions pour les Débats qui, je vous le répète, sont friands, je le crois sans peine, de ces pages qui ont plus de succès que jamais.
Je n’ai plus de place que pour vous dire que je vous aimerai toujours.
Eugène Delacroix
Après avoir été gravement malade de la fièvre typhoïde, George Sand est partie en convalescence à Tamaris (Var) de février à juin 1861. Après l’avoir déclinée, Sand finit par accepter la proposition de Bertin de publier à nouveau dans Le Journal des débats. Son roman La Famille de Germandre paraît dans le périodique du 7 au 29 août 1861. D’après les notes prises durant son séjour, elle écrit également Tamaris, publié en 1862, d’abord dans la Revue des Deux Mondes, puis en volume. En effet après avoir été brouillée avec François Buloz jusqu’en 1858, Sand se remet à publier plusieurs œuvres dans la Revue des Deux Mondes. Le directeur de la revue ne devait donc pas être enchanté par l’idée d’une collaboration de la romancière avec un autre périodique ...
Delacroix recopie l’intégralité de cette lettre dans son Journal, à la même date du 12 janvier 1861.
 En 1834, Eugène Delacroix reçoit commande d’un portrait de George SAND en costume d’homme pour la Revue des Deux Mondes à laquelle elle collabore. Ce sera le début d’une amitié amoureuse intense, qui durera près de 30 ans, nourrie par une correspondance qui durera du 16 novembre 1834 jusqu'à la mort du peintre le 13 août 1863, et qui livre certains de leurs secrets.
En 1834, Eugène Delacroix reçoit commande d’un portrait de George SAND en costume d’homme pour la Revue des Deux Mondes à laquelle elle collabore. Ce sera le début d’une amitié amoureuse intense, qui durera près de 30 ans, nourrie par une correspondance qui durera du 16 novembre 1834 jusqu'à la mort du peintre le 13 août 1863, et qui livre certains de leurs secrets.
George Sand conserva toute sa vie des goûts plutôt académiques. Sa rencontre avec Delacroix, le chef de l'école romantique, bouleversa son approche esthétique. Il lui fit découvrir son maître Géricault. Delacroix séjournait de temps en temps à Nohant et y avait un atelier à demeure.
Delacroix était très proche de Chopin et George Sand, dont il fit un tableau, sans doute au cours du printemps 1838, avant que leur liaison ne devienne officielle. Chopin a fait transporter un piano chez Delacroix pour que ce dernier puisse le peindre en compagnie de George Sand, lui au piano, elle dans la pénombre debout derrière lui, captivée par la musique de son amant. Chopin écrit : "Elle me regardait profondément dans les yeux pendant que je jouais." Le 5 septembre 1838, Delacroix écrit à son ami Pierret : "Autre commission que je réclame de ta bonté; ce serait, en te promenant, d'aller au coin de la rue Grange batelière et du boulevard, chez Pleyel, facteur de pianos, le prier de faire enlever chez moi, Delacroix, rue des Marais Saint-Germain 17 [actuellement rue Visconti], le piano que M. Chopin y a fait porter il y a deux mois environ."
Mais jamais Chopin, George Sand, pas plus que Delacroix, ne mentionnent cette œuvre dans leurs écrits. Ce tableau inachevé resta dans l'atelier de Delacroix jusqu'à sa mort en 1863. L'oeuvre passa ensuite dans la collection du peintre Constant Dutilleux, ami et exécuteur testamentaire. Après plusieurs changements de propriété, le portrait de George Sand est maintenant à l'Ordrupgaard Museum à Copenhague, celui de Chopin est maintenant au Louvre.
En janvier 1841, George Sand rend à Delacroix la monnaie de la pièce en traçant les portraits du peintre et du musicien dans ses Impressions et Souvenirs.
À la mort de Delacroix, en 1863, Sand qui possédait alors plus de vingt tableaux de l'artiste, décida de tout vendre. Elle ne conserva que le premier et dernier des présents que lui avait faits le peintre : La confession du Giaour et le Centaure
Sources :
http://www.correspondance-delacroix.fr/correspondances/bd...
06:38 Publié dans Histoire, litterature, peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |












