samedi, 08 janvier 2011
Il y a 50 ans, les français disent "oui" à l'indépendance de l'Algérie
Il y a 50 ans, le 8 janvier 1961 est organisé le premier référendum de la Ve République. Ont voté les électeurs de la métropole, de l'Algérie, mais aussi des DOM, des TOM et du Sahara français.
(cliquer ICI pour voir la vidéo des actualités françaises sur le site de l'INA ... après la pub ...)
En 1959, devant le refus de la «paix des braves», l'impossibilité d'une solution militaire qui rétablirait la sécurité et la poursuite des attentats, de Gaulle franchit une étape décisive en proposant une solution qui signifie implicitement le rejet de l'intégration, thème majeur des partisans de l'Algérie française.
 Dans une allocution radio-télévisée prononcée au palais de l'Elysée le 16 septembre 1959, il annonce sa décision de recourir à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit pour les populations d'Algérie de choisir librement leur destin par le suffrage et il propose trois solutions : la sécession, l'intégration ou l'association, promettant l'aide et la coopération de la France si la solution choisie est celle d'une Algérie indépendante associée à la France.
Dans une allocution radio-télévisée prononcée au palais de l'Elysée le 16 septembre 1959, il annonce sa décision de recourir à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit pour les populations d'Algérie de choisir librement leur destin par le suffrage et il propose trois solutions : la sécession, l'intégration ou l'association, promettant l'aide et la coopération de la France si la solution choisie est celle d'une Algérie indépendante associée à la France.
Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) créé par le FLN le 19 septembre 1958, et qui entend avoir le monopole des discussions avec la France pour se constituer en gouvernement légitime de l'Algérie, refuse dès 28 septembre et exige, préalablement à toute discussion, l'indépendance totale. De même refus des activistes de l'Algérie française qui s'estiment trahis par de Gaulle et tentent de déclencher en janvier 1960, un 13 mai à rebours, la semaine des barricades. En février 60 les mouvements activistes sont dissous, Soustelle quitte le gouvernement, et on assiste à des sanctions et mutations dans l'armée (Limogeage de Bigeard et de Godard, Gardes, chef du 5e bureau, inculpé avec Lagaillarde, Sapin-Lignières, Perez et Susini.
Cette période voit en effet émerger de façon croissante une mouvance ultra de plus en plus organisée, appuyée par l'armée. L'affrontement des 2 communautés devient de plus en plus évident, d'autant que la radicalisation croissante de l'opinion des Français d'Algérie ne laisse que peu de place à des réformes des bases de la vie des communautés sur lesquelles reposait l'espoir de construction d'une Algérie fraternelle. Au printemps de 1960, la position de Général de Gaulle est bien arrêtée : l'intégration est une chimère, les Algériens ne sont pas et ne seront jamais des Français. Il n'existe pas d'autre alternative que la sécession. Mais il veut que celle-ci se fasse dans un cadre qui sera mis en place par la France. Le 14 juin, il propose aux "dirigeants de l’insurrection" de négocier. Le GPRA accepte, et le 25 juin 1960, s’ouvrent les rencontres de Melun. Les discussions se soldent alors par un échec car les divergences entre les deux parties sont profondes. Ainsi la France exige-t-elle une trêve en préalable à toute discussion, ce que le FLN refuse.
 Contre les adversaires de sa politique, le Général déclare en Novembre 1960 qu'il est prêt à utiliser toutes les armes que lui fournit la Constitution, autrement dit le recours à l'article 16, le référendum ou la dissolution de l'Assemblée nationale si celle-ci s'opposait aux solutions retenues. Ce discours provoque la colère des colons qui manifestent en Algérie. Le GPRA demande un référendum sous contrôle de l'ONU
Contre les adversaires de sa politique, le Général déclare en Novembre 1960 qu'il est prêt à utiliser toutes les armes que lui fournit la Constitution, autrement dit le recours à l'article 16, le référendum ou la dissolution de l'Assemblée nationale si celle-ci s'opposait aux solutions retenues. Ce discours provoque la colère des colons qui manifestent en Algérie. Le GPRA demande un référendum sous contrôle de l'ONU
La question posée aux Français est : "Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination ?"
Les principales forces politiques sont partagées : la SFIO, le MRP et l'UNR sont pour; le PCF, le Parti Radical, le Regroupement national pour l'unité de la République de Jacques Soustelle et l'extrême droite sont contre; d'autres comme le PSU soutiennent l'autodétermination, mais s'opposent à la politique algérienne du général de Gaulle et au caractère plébiscitaire du référendum, certains préconisant le non, d’autres un vote blanc ou nul; le CNIP ne donne pas de consigne de vote ...
En décembre 60 certains dirigeants activistes de l’Algérie française, dont Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Susini, s’enfuient en Espagne et y rejoignent le général Salan. Des contacts en Algérie sont pris par l'intermédiaire du capitaine Pierre Sergent avec le général Jouhaud et le FAF clandestin pour préparer une nouvelle journée d'action lors de la visite du général de Gaulle en Algérie. Le putsch mené par Jouhaud et Dufour avorte tandis que des contre manifestations particulièrement massives pour l’indépendance de l’Algérie éclatent à Alger et à Oran puis dans le reste du pays. Ces manifestations, qui dureront plus d’une semaine, sont de véritables soulèvements populaires contre le colonialisme et la population affrontera directement les forces de l’ordre et les parachutistes, qui tirent sur la foule. Le bilan officiel est de 127 personnes tuées, dont 8 Européens, et 600 blessés. Véritables démonstrations de force, ces manifestations prouvent l’adhésion de la population à la lutte pour l’indépendance et son soutien au FLN qui a appelé au boycott du référendum. Le 20 décembre, les Nations unies reconnaissent à l'Algérie le droit à l'autodétermination.
L’avant-veille du scrutin, Charles de Gaulle apparaît à la télévision, s’adressant aux Français pour prôner le vote en faveur du OUI. L'Humanité du samedi 7 Janvier 1961 titre : "Demain, votez NON contre la guerre d'Algérie pour imposer la négociation pour la paix en Algérie"
 32 520 233 personnes prennent part au vote, dont 4 470 215 en Algérie. Les résultats sont proclamés par le Conseil Constitutionnel, 14 janvier 1961 : 17 447 669 (75% des votants soit 54% des inscrits) ont voté "oui". Pour l'Algérie seule, 1 749 969 ont voté "oui" (69,5 % des votants, mais seulement 40% des inscrits). le "Oui" l’emporte massivement, même si L'Humanité du lundi 9 Janvier 1961 titre : « Malgré l'appui des forces réactionnaires, De Gaulle perd en voix et en pourcentage par rapport au 28 Septembre 1958. Dans les villes algériennes les électeurs musulmans répondant à l'appel du G.P.R.A. ont boycotté en masse le scrutin » et encore le lendemain "« Le référendum a montré que l'immense majorité des français veut la paix. Et maintenant négociation immédiate pour le cessez-le-feu et les garanties de l'autodétermination avec les représentants du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne »
32 520 233 personnes prennent part au vote, dont 4 470 215 en Algérie. Les résultats sont proclamés par le Conseil Constitutionnel, 14 janvier 1961 : 17 447 669 (75% des votants soit 54% des inscrits) ont voté "oui". Pour l'Algérie seule, 1 749 969 ont voté "oui" (69,5 % des votants, mais seulement 40% des inscrits). le "Oui" l’emporte massivement, même si L'Humanité du lundi 9 Janvier 1961 titre : « Malgré l'appui des forces réactionnaires, De Gaulle perd en voix et en pourcentage par rapport au 28 Septembre 1958. Dans les villes algériennes les électeurs musulmans répondant à l'appel du G.P.R.A. ont boycotté en masse le scrutin » et encore le lendemain "« Le référendum a montré que l'immense majorité des français veut la paix. Et maintenant négociation immédiate pour le cessez-le-feu et les garanties de l'autodétermination avec les représentants du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne »
Le lendemain du scrutin, Challe donne sa démission de commandant en chef de Centre Europe et le 11 février Lagaillarde, réfugié en Espagne, fonde l'OAS (Organisation Armée secrète). Néanmoins, conforté par les résultats globaux du référendum, le général de Gaulle poursuit la politique engagée : de nouvelles négociations s’ouvrent avec le gouvernement provisoire de la République Algérienne à l’été 1961, tandis que le putsch raté d’avril 1961 va définitivement marginaliser les tenants les plus radicaux du maintien de l’Algérie française.
18:13 Publié dans Histoire, souvenirs | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 05 janvier 2011
Petite histoire des cartes de voeux
 Avec la coutume des étrennes est née celle des vœux. En effet, on en profitait pour s’échanger des paroles d’amitié, se souhaitant bonheur et prospérité pour le reste de l’année. Les plus rapides s’y prennent dès le début du mois de décembre, les retardataires attendront fin janvier, avec un gros pic entre le 20 décembre et le 10 janvier. La tradition de l’échange des vœux évolue mais perdure. Cartes électroniques ou traditionnelles se côtoient aujourd'hui.
Avec la coutume des étrennes est née celle des vœux. En effet, on en profitait pour s’échanger des paroles d’amitié, se souhaitant bonheur et prospérité pour le reste de l’année. Les plus rapides s’y prennent dès le début du mois de décembre, les retardataires attendront fin janvier, avec un gros pic entre le 20 décembre et le 10 janvier. La tradition de l’échange des vœux évolue mais perdure. Cartes électroniques ou traditionnelles se côtoient aujourd'hui.
La tradition des cartes de vœux est née en Extrême-Orient Les cartes de vœux envoyées pour cette occasion étaient autrefois en papier de riz, les artistes les plus talentueux y dessinaient et traçaient les souhaits de Bonne Année à la main, à l'aide d’encres précieuses et leur dimension était proportionnelle au rang du destinataire, pouvant atteindre pour un mandarin la taille d’un devant de cheminée !
En France, depuis le Moyen âge, on envoyait de petits présents en l'accompagnant parfois d'une lettre de vœux peinte à la main. Cette tradition était réservée aux classes aristocratiques qui pouvaient se procurer encre et papier. De façon tout à fait rituelle et formelle, on rendait visite, dans les quinze jours qui suivaient le 1er janvier, à son entourage proche, famille et amis, patron et collègues de travail, et même à des familles pauvres ou des malades dont on embellissait ces jours festifs par des dons et des marques d'amitié. Cependant comme ces visites étaient très contraignantes, il était courant de s'abstenir d'une visite. Au cours du 17e siècle, on pouvait louer les services d'un gentilhomme en livrée noire et épée au côté, loué pour l’occasion et chargé de présenter les compliments de leur mandataire. Vers la fin du règne du Louis XIV, le gentilhomme fut progressivement remplacé par la remise d'une carte de visite, en laissant, pour preuve de son passage, une carte de visite qui, si elle était cornée en haut à droite, cela indiquait que l’on s’était déplacé soi-même pour la déposer. C'est ainsi qu'apparut l'habitude de remettre au concierge du domicile de ses proches le 1er janvier une carte de visite sur laquelle on avait écrit une formule de voeux. Cette tradition fut abolie en France de 1791 à 1797, car assimilées à un gage de vanité et de frivolité, elle fut même sources de sévères condamnation sous la Convention, mais ni le calendrier républicain ni les fêtes instituées par la Convention n’eurent raison de cette tradition séculaire.
Parallèlement on prenait prétexte des voeux à souhaiter pour renouer des amitiés distendues, ou se rappeler au bon souvenir de connaissances éloignées géographiquement en envoyant nombre de lettres. Mais même à cette époque, on n'a pas toujours le temps d'écrire toutes ses lettres de vœux ...
Dès 1796, l'auteur autrichien Aloys Senefelder (1771-1834) invente la lithographie qui permet de reproduire des impressions en grande quantité. Grâce à cette découverte technique, on parvient désormais à tirer des centaines d'images identiques pour une diffusion importante. Les marchands se mettent donc à expédier des cartes imprimées à leurs clients, pour les remercier de leur fidélité. Les Anglais mettent eux aussi à profit cette technique pour la transmission de leurs vœux du Nouvel An à partir de 1840, après l'impression massive d'enveloppes aux motifs de Noël et de la parution du premier timbre-poste.
La première carte imprimée de Noël est lancée en Angleterre par Sir Henry Cole (1808-1882), qui se voyant trop occupé pour écrire à ses amis, demande à l'artiste John Calcott Horsley de lui concevoir une carte. Le premier exemplaire représente une famille heureuse levant un verre comme pour porter un toast au destinataire. Elles est imprimée en noir et blanc puis mise en couleur à la main et porte l'inscription "Merry Christmas and happy new year", il n'a plus qu'à ajouter son nom et celui de son destinataire. Selon les notions de tempérance de l'époque, Horsley est critiqué pour "corruption morale" des enfants. A noter que parmi les mille cartes originales imprimées pour Henry Cole, douze existent encore aujourd'hui dans des collections privées.
Initialement, ces cartes sont imprimées et vendues à l'époque pour un schilling, en plus des frais de poste de un penny, la carte n'étant évidemment pas à la portée des budgets les plus humbles. Mais le développement rapide des techniques d'impression va rendre ces cartes extrêmement populaire et à la mode, et cette tradition va se diversifier considérablement en s'appliquant à tous les types d'événements de la vie humaine. Les premiers modèles de cartes de vœux sont étonnamment complexes, avec des cartes en forme de drapeaux, des cloches, d'oiseaux, et des bougies. Certaines cartes peuvent même être pliées comme des cartes ou emboîtés comme des puzzles. Curieusement, ils représentent rarement l'hiver, la neige, les arbres de Noël, ni des thèmes religieux, mais plutôt des fleurs, des fées et d'autres reproductions qui rappellent au destinataire l'approche du printemps. Les représentations humoristiques ou sentimentales d'enfants et d'animaux sont aussi très populaires.
 En Amérique du Nord Louis Prang (1824-1909), un immigrant allemand, ouvre en 1860 un atelier de lithographie à Boston au Massachusetts. Dès 1873, il imprime des cartes de voeux pour le Nouvel An et commence à les vendre aux États-Unis l'année suivante. En 1885, il a d'ailleurs l'idée de représenter le Père-Noël (Santa Claus) dans un costume rouge, ce qui fait fureur auprès du public et officialise la couleur rouge pour désigner le jovial bonhomme à barbe blanche. Mais ses cartes sont chères, et sont rapidement imitées par des cartes de qualité moindre mais plus abordables, et finalement il est contraint à la faillite en 1890
En Amérique du Nord Louis Prang (1824-1909), un immigrant allemand, ouvre en 1860 un atelier de lithographie à Boston au Massachusetts. Dès 1873, il imprime des cartes de voeux pour le Nouvel An et commence à les vendre aux États-Unis l'année suivante. En 1885, il a d'ailleurs l'idée de représenter le Père-Noël (Santa Claus) dans un costume rouge, ce qui fait fureur auprès du public et officialise la couleur rouge pour désigner le jovial bonhomme à barbe blanche. Mais ses cartes sont chères, et sont rapidement imitées par des cartes de qualité moindre mais plus abordables, et finalement il est contraint à la faillite en 1890
Des multinationales telles que Hallmark, créée en 1910 par Joyce Clyde Hall (1891-1982), comprennent rapidement tout le profit à tirer d'une commercialisation des cartes de vœux. De même des associations caritatives telles l'Unicef : En 1949, Jitka Samkova, une petite Tchécoslovaque de 7 ans, fait en classe une peinture pour remercier cette nouvelle organisation d’avoir fourni des médicaments et du lait aux enfants de son village ravagé par la guerre. L’image, qu’elle a peinte sur un morceau de verre faute de papier, représente un groupe d’enfants en train de danser autour d’un "mât de fête" sous un grand soleil. Sa peinture est envoyée par son institutrice au bureau Unicef de Prague, qui la fait suivre à Vienne puis à New York où le dessin de Jitka inspire les équipes de l'Unicef pour la réalisation d'un projet de cartes de voeux. En octobre 1949, les toutes premières cartes de vœux de l’Unicef sont imprimées avec cette image, afin de collecter des fonds pour venir en aide aux enfants. Depuis, les cartes Unicef remportent un franc succès et à ce jour, le produit de la vente de plus de 4,7 milliards de cartes a secouru les enfants déshérités dans le monde entier.
Avec l'avènement d'Internet et les services de cartes en ligne, l'envoi de voeux prend maintenant un nouveau virage. On offre moins de cartes physiques, et les e-cartes ont pris le relais et permettent d'envoyer rapidement et sans délai postaux, des images originales. En moyenne, les Français achètent 14 cartes de voeux et fantaisie par an. C'est peu, au regard des habitudes des consommateurs anglais et américains, qui achètent respectivement 54 et 40 cartes par an.
Il n’empêche que le bonheur de décacheter une enveloppe ne s’épuise jamais et que rien ne remplacera la carte de voeux envoyée sous enveloppe que l'on place sur le manteau des cheminées ou sur les branches des sapins, ou encore que l'on garde précieusement entre les pages d’un livre.
Et n'oublions pas que "l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines", comme nous le rappelle avec justesse Francis Bacon. L'envoi d'une carte de voeux accompagnée d'un mot gentil participe tout simplement à l'ensemble des jolis gestes qui soudent les amitiés.
02:10 Publié dans Bavardage, coup de gueule, Histoire, traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
samedi, 01 janvier 2011
Vous prendrez bien une petite verveine ?
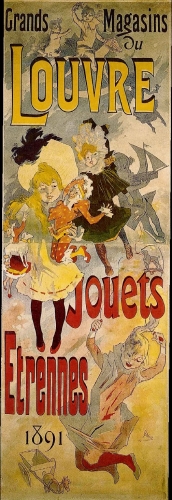 Depuis quelques jours, une partie de mes occupations est liée à ces étranges coutumes des étrennes et des cartes de vœux. Je prépare avec soin les enveloppes destinées à mes éboueurs et à mon jardinier, j'écris maintes cartes, envoyées par la poste ou, de façon plus moderne et aussi plus rapide, par internet.
Depuis quelques jours, une partie de mes occupations est liée à ces étranges coutumes des étrennes et des cartes de vœux. Je prépare avec soin les enveloppes destinées à mes éboueurs et à mon jardinier, j'écris maintes cartes, envoyées par la poste ou, de façon plus moderne et aussi plus rapide, par internet.
Mais voyons d'abord d’où vient la coutume des étrennes.
Un tour sur google m'apprend qu'un certain Jacob Spon, médecin et érudit lyonnais écrivit un petit livre qu'il intitula "De l’origine des étrennes" et qu'il offrit en 1674 comme étrennes à un conseiller du duc de Wurtemberg.
Cet homme était un érudit, un "curieux" comme on disait à cette époque. Un autre érudit de son époque, Charles César Baudelot de Dairval disait de lui "Lyon est tout plein d'habiles curieux, et quand ce ne seroit que M. Spon, il en vaut bien une douzaine d'autres", auquel il répondait : "Il est bien juste que je sois aussi un peu curieux, puisque je connois presque tous ceux de Lyon qui le sont ; et l'on sçait que cette maladie est contagieuse, quoy qu'elle ne soit pas mortelle". Bref, Jacob Spon avait étudié le grec ancien et le latin nécessaires à l'époque aux études de médecine et s'était passionné pour l'antiquité. Et en 1973, il s'était déjà fait remarquer par sa première publication, Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, qui l'avait installé dans le cercle de la République des Lettres.
Pour son petit livre sur les étrennes, c'est Symmachus qui a fourni à Spon ses informations. Symmachus est surtout connu pour être le champion du Sénat romain païen opposé aux mesures prises par les empereurs chrétiens contre la vieille religion d'État vers la fin du IVe siècle. De lui nous sont parvenus 9 livres d'Épîtres, ainsi que deux lettres tirées du dixième livre, publiées juste après sa mort par son fils, soit environ 900 lettres, la plupart d'un intérêt relatif ... C'est à partir des informations du Liber X, épître 28 que Spon raconte que l’usage des étrennes fut introduit sous les premiers rois de Rome.
Symmachus y rapporte en effet que Tatius Sabinus, contemporain et adversaire de Romulus, aurait reçu comme augure des branches de verveine (verbena) dans un bois consacré à Strenia, déesse sabine de la force et de l'endurance : "qui verbenas felicis arboris ex luco Streniae anni novi auspices primus accepit.” Un temple dédié à Strenia se dressait en effet au bout de la Via Sacra, près du Colisée, et était entouré d’un bois sacré à l’image de tous les temples dédiés à la guérison, les Asklépeïon.
Cette légende est cependant à prendre avec beaucoup de réserve car Symmachus ne cite pas ses sources. Et il est parfois considéré comme "un sot" par les historiens, comme Ferdinand Lot qui disait de lui : "Il a été considéré de son temps comme un fin lettré et révéré des païens, ses coreligionnaires, même des chrétiens. Saint Ambroise, Prudence n'osent s'égaler à son éloquence. Quand on lit ses œuvres, elles nous donnent l'impression que l'auteur était un honnête et digne homme, ami des belles-lettres, très poli dans les discussions, un homme de bonne société, mais d'une nullité intellectuelle affligeante. Il y a peu à tirer de sa correspondance." De quoi éveiller notre méfiance en effet ! Même si le "grand dictionnaire historique sur le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane" par Mgr Louis Morery, Prêtre et Docteur en Théologie, paru à Lyon à partir de 1674, reprend l'histoire écrite par Spon.
Ce qui est sûr, c'est que plus de 700 ans après Romulus et Tatius Sabinus, en 46 Av. J-C, quand Jules César établit le Calendrier Julien, le 1er janvier représente alors le jour du Nouvel An. Ce jour consacré à Janus est aussi la date d'élection des Consuls de Rome et on y échange des présents
La lecture d'Ovide nous indique en effet que la période du tout début de l'année est intimement liée à Janus, divinité aux deux visages regardant l'un l'année passée et l'autre la prochaine. Strenia, la déeese, strena,ae, l’étrenne, strenuus,a,um, fort, forte auraient, d’après de nombreux latinistes la même éthymologie ... Le mot "étrenne" vient-il donc bien de la légende rapportée par Symmachus, ou plus prosaïquement d'une association erronée entre Janus dieu des commencements, et Strenia-Salus, déesse de la santé et de la force, souvent évoqués ensemble ?
Et si le mot étrenne vient bien de Rome, il n’en va pas de même pour cette coutume sylvestre (tiens, encore une association avec le saint du jour ...) elle-même qui a toujours existé un peu partout. Sur nos vieux terroirs francais, ça n’est pas la verveine latine, mais le gui que les druides allaient cueillir pour l’an neuf !
Mais voyons ce qu'écrit Ovide dans son très long et magnifique poème Les Fastes, paru vers 15 ap. J.-C., portant sur le calendrier romain et les fêtes religieuses qui l'accompagnent. Ovide invoque Janus, qu'on représentait à deux visages, l'un devant et l'autre derrière, comme regardant l'année passée et la prochaine et donc patron du premier mois de l'année, en faveur des princes, du Sénat et du Peuple romain. Le premier janvier est marqué par l'ouverture des temples, par l'échange de voeux et de paroles de paix, par des sacrifices et des offrandes dans une atmosphère paisible et joyeuse, par une procession en vêtements blancs emmenant les nouveaux magistrats vers le mont Tarpée, où Janus avait un autel.
Germanicus, voici qu'il vient t'annoncer une année heureuse,
Janus, le premier dieu présent dans mon poème.
Janus aux deux visages, toi qui commences l'année au cours silencieux,
toi, le seul des dieux d'en haut à voir ton propre dos,
sois propice à nos princes dont le labeur apporte
la paix à la terre féconde et la paix à la mer.
Sois propice à tes sénateurs et au peuple de Quirinus,
et d'un signe de tête fais ouvrir les temples éclatants.
Un jour béni se lève : faites silence et recueillez-vous !
En ce beau jour, il faut prononcer des paroles de bonheur.
Que les oreilles soient exemptes de débats, et que d'emblée s'éloignent
les querelles insanes : diffère ton oeuvre, langue envieuse.
Vois-tu comment le ciel resplendit de feux parfumés,
et comment crépite le safran de Cilicie dans les foyers allumés ?
L'éclat de la flamme se reflète sur l'or des temples
et répand au sommet du sanctuaire sa lueur tremblante.
En vêtements sans taches, on se rend à la citadelle tarpéienne
et le peuple lui aussi porte la couleur qui s'accorde à sa fête.
Et en tête avancent les nouveaux faisceaux, la pourpre nouvelle brille
et, sur la chaise curule d'ivoire éclatant, siège un nouveau personnage.
De jeunes taureaux, ignorant les travaux et nourris d'herbages
dans les champs falisques, tendent leur cou au sacrificateur.
il ne peut rien apercevoir qui ne soit romain.
Salut, jour heureux, reviens-nous toujours meilleur,
digne d'être célébré par le peuple qui gouverne le monde !
Plus loin, Ovide tente d’expliquer pourquoi le premier janvier est le commencement de l’année :
"Allons, dis-moi pourquoi l'an neuf commence avec les frimas :
Ne devait-il pas de préférence débuter au printemps ?
Alors, tout fleurit, alors, c'est la saison nouvelle :
sur le sarment fécond le jeune bourgeon se gonfle,
et l'arbre se couvre de feuilles à peine formées ;
l'herbe aussi, sortie de la graine, pointe sa tige au ras du sol,
et les oiseaux de leurs concerts agrémentent la tiédeur de l'air,
tandis que les troupeaux jouent et s'ébattent dans les prairies.
Alors le soleil est doux ; l'hirondelle, oubliée, reparaît
et façonne son nid de boue à l'abri d'une haute poutre ;
alors le champ labouré souffre, la charrue le rend neuf.
C'est cette période qui méritait d'être appelée nouvel an".
Ma question avait été longue ; lui, sans beaucoup attendre,
concentra sa réponse dans ces deux vers :
"Le solstice d'hiver marque le premier jour du soleil nouveau
et le dernier de l'ancien : Phébus et l'an ont même commencement".
Après quoi, je m'étonnais du fait que ce premier jour
ne fût pas exempté de procès. Janus dit : "Apprends-en la cause !
J'ai confié à l'année naissante l'activité judiciaire, par crainte de voir
l'année tout entière dépourvue d'activité, à cause d'un tel auspice.
Pour la même raison, chacun s'adonne à ses activités propres,
ne faisant rien d'autre que témoigner de son travail habituel".
Si ce jour-là, les activités judiciaires et autres ne sont pas suspendues, c'est que le premier janvier est un jour faste, garantissant que l'année entière sera vouée à l'action ... A cette époque, il n'est donc pas question que le Jour de l'An soit férié !!!
Par ailleurs, l'échange ce jour-là de douceurs (datte, figue, miel) augure une année douce.
Aussitôt j'interviens : "Pourquoi, lorsque j'honore d'autres dieux,
dois-je commencer par t'offrir à toi, Janus, de l'encens et du vin ?"
"Pour que tu puisses, dit-il, grâce à moi, gardien des seuils,
accéder à ton gré auprès de tous les dieux".
"Mais pourquoi prononçons-nous des paroles joyeuses à tes Calendes,
et pourquoi faisons-nous cet échange de voeux ?"
Alors le dieu, appuyé sur le bâton qu'il tenait de la main droite, dit :
"D'habitude, les commencements comportent des présages.
À la première parole, vous tendez une oreille craintive
et c'est le premier oiseau entrevu que consulte l'augure.
Les temples des dieux sont ouverts, de même que leurs oreilles ;
nulle langue ne formule en vain des prières ; les paroles ont leur poids".
Janus en avait fini ; je ne gardai pas longtemps le silence,
et mes mots suivirent aussitôt ses dernières paroles :
"Que veulent dire la datte et la figue ridée", dis-je,
"et le miel qu'on offre, contenu dans une jarre blanche ?" Il dit :
"C'est pour le présage, pour que leur saveur s'attache aux choses
et que l'année achève son voyage en douceur comme il a commencé".
"Je vois pourquoi on offre des douceurs ; dis-moi aussi le pourquoi
de la pièce de monnaie, pour que rien ne m'échappe de ta fête".
Il rit et dit : "Combien tu es abusé sur les temps où tu vis,
si tu penses qu'il est plus doux de recevoir du miel qu'une obole !
Au temps où régnait Saturne, j'avais peine déjà à trouver quelqu'un
dont l'esprit n'appréciait pas les douceurs du profit.
Avec le temps grandit le désir de posséder, qui actuellement culmine ;
à peine est-il possible d'aller plus loin en cette voie.
Les richesses sont plus prisées maintenant que dans les premiers temps,
quand le peuple était pauvre, quand Rome était dans sa nouveauté,
quand une humble cabane accueillait Quirinus, le fils de Mars,
et quand les roseaux du fleuve lui servaient de petite couchette.
Jupiter tenait difficilement debout dans son temple étroit,
et en sa main droite, le foudre était d'argile.
On ornait le Capitole de feuillages, des gemmes aujourd'hui,
et le sénateur menait lui-même paître ses brebis ;
il n'était pas honteux de prendre un paisible repos sur une paillasse
ni de poser sous sa tête un coussin de foin.
Le préteur, sa charrue à peine posée, rendait la justice au peuple
et on pouvait vous faire grief de posséder une mince lame d'argent.
Mais lorsque la Fortune de ce lieu eut relevé la tête,
et que Rome du haut du front eut touché les demeures des dieux,
les richesses s'accrurent, de même qu'une furieuse envie de richesses ;
et, tout en possédant quantité de biens, on en réclama davantage.
On rivalisa pour gagner de quoi dépenser, et regagner sa dépense,
et cette alternance même alimenta les vices :
ainsi en va-t-il de ceux dont le ventre est gonflé par l'hydropisie,
plus ils ont bu d'eau, plus ils sont assoiffés.
Actuellement la valeur réside dans l'argent : le cens procure les honneurs ;
il procure aussi les amitiés ; le pauvre, où qu'il soit, reste sur le carreau.
Tu te demandes pourtant ce que peut valoir le présage d'une obole,
et pourquoi nous aimons tenir en mains de vieilles monnaies de bronze.
Jadis on offrait du bronze : maintenant, en or, le présage est meilleur
et l'antique monnaie, vaincue, a cédé le pas à la nouvelle.
Nous aussi, même si nous prisons les temples anciens, nous les aimons
quand ils sont dorés : cette majesté sied à un dieu.
Nous louons les temps révolus, mais nous vivons à notre époque :
de toute façon les deux coutumes méritent un égal respect".
Comme on peut le lire, ces douceurs ont été depuis toujours concurrencées par des pièces de monnaie. Après une évocation des temps anciens, où l'on vivait heureux dans la simplicité et la pauvreté, avant l'afflux des richesses et le règne de la cupidité, le dieu explique que, à cause de cette évolution, une pièce d'or est souvent préférée à une obole, mais que les deux coutumes sont défendables et qu'il faut vivre avec son temps ... Comme quoi la débauche de victuailles et de dépenses que nous voyons en cette période de l'année ne date pas d'hier !
Les présents habituel étaient des figues, des dattes et du miel. On envoyait ces douceurs à ses amis, pour leur témoigner qu'on leur souhaitait une vie douce et agréable. Les figues et les dattes étaient ordinairement couvertes d'une feuille d'or, ce qui n'était néanmoins que le présent des personnes les moins riches: Martial en parle ainsi dans ses Epigrammes :
Aurea porrigitur Jani car jota Calendis:
Sed tamen hoc munus pauperts ejfe folet.
On y joignait aussi quelque petite pièce d'argent.
Sous l'Empire d'Auguste, le peuple, les Chevaliers, et les Sénateurs lui présentaient des étrennes; et lorsqu'il était absent, ils les portaient dans le Capitole. L'argent de ces étrennes était employé à acheter des statues de quelques divinités, l'Empereur ne voulant pas utiliser à son profit particulier les libéralités de ses sujets.
"Omnes ordines in lacum Curti quotannis ex voto pro salute eius stipem jaciebant, item Kal. Jan. strenam in Capitolio etiam absenti, ex qua summa pretiosissima deorum simulacra mercatus vivatim dedicabat, ut Apollinem Sandaliarium et Jovem Tragoedum aliaque." "Chaque année, tous les ordres de l’État jetaient dans le gouffre de Curtius des pièces d’argent pour son salut. Aux calendes de janvier, lors même qu’il était absent, on lui portait des étrennes au Capitole. De cet argent il achetait les plus belles statues des dieux, et les faisait élever dans les divers quartiers de Rome, comme l’Apollon des Sandales, le Jupiter Tragédien et quelques autres".( Suétone, Auguste, chapitre 57)
Tibère désapprouva cette coutume, et fit un édit par lequel il défendait les étrennes, passé le premier jour de l'année, parce qu'auparavant le peuple s'occupait à ces cérémonies pendant huit jours.
"Cotidiana oscula edicto prohibuit, item strenarum commercium ne ultra Kal. Jan. exerceretur." "Il abolit par un édit l’usage de s’embrasser tous les jours, et défendit de prolonger l’échange des étrennes au-delà des calendes de janvier". (Suétone, Tibère, 34)
Mais Caligula fit savoir au peuple que lui accepterait les étrennes qu'on lui présenterait, contrairement à son prédécesseur tandis que Claude son successeur défendit qu'on l'importunât de ces présents ...
Les Grecs empruntèrent cet usage des Romains, mais ils n'avaient pas de mot pour qualifier ces étrennes. Mais les chrétiens s'élèvent contre cette coutume. Tertullien dans son livre de l'Idolâtrie en parle : "Mon âme, dit-il, a en horreur vos Sabbats, Nouvelles Lune et solennités. Comment pouvons-nous frequenter les fêtes Saturnales célébrer les Calendes de Januier, le solstice d'hiver, la fête des matrones, donner des présents ces jours-là, faire des étrennes, des jeux et banquets ..."
En 313, l'édit de Milan marque la reconnaissance quasi officielle du christianisme comme religion de l'Empire. Dès lors, encouragées par les faveurs du pouvoir, les troupes de choc de la nouvelle foi s'attaqueront avec zèle à la conversion des villes et des campagnes et à l'éradication des coutumes païennes ... ou plutôt, pure tartufferie, des fêtes chrétiennes remplaceront les joyeusetés idolâtres !
Pourtant dans les premiers siècles de l'Eglise, l'habitude d'envoyer des étrennes aux magistrats et aux Empereurs perdure. D'après Ferdinand Lot dans "La Fin du monde antique et les débuts du moyen âge" paru en 1951 (p.509), jusqu'en début du Vème siècle, l'aristocratie païenne fait servir, aux fins de sa propagande, l'habitude très ancienne d'offrir en cadeau, le jour de l'An, de vieilles pièces de monnaie (des "contorniates") représentant des empereurs païens restés populaires, ou Alexandre le Grand, le conquérant victorieux, par dérision contre le faible empereur chrétien. On en trouve même jusque sous le règne d'Anthémius (467-472), représentant l'empereur régnant avec des allusions politiques
Vers 515-520, saint Césaire (470-543), évêque d'Arles, fulmine dans un sermon contre les coutumes du jour de l'An : («... les uns ne revêtent que la peau d'un animal, d'autres en prennent la tête, d'autres se déguisent en femmes... ") et contre les pratiques de la fête des Morts du 22 février (« ... ils portent des mets et du vin sur les tombeaux des défunts... »). En 524, le concile d'Arles condamne les rites observés lors du jour de l'An. En 578, le concile d'Auxerre réitère l'interdiction de se déguiser en vaches et en cerfs à l'occasion des fêtes du jour de l'An. Le VIe concile oecuménique (7 novembre 680-16 septembre 681) qui met fin à la querelle monothélite condamne aussi ces fêtes.
En fait, ce sont plutôt les rites liés aux "saturnales" qui sont condamnés, cette succession non interrompue de réjouissances et de cérémonies qui commençait mi décembre, embrassait tout l'intervalle compris entre Noël et l'Epiphanie et qui s'est ensuite et progressivement étendue jusqu'au jour des cendres. Et l'église a toléré les étrennes à condition qu'elles ne soient plus que des marques d'amitié ou de soumission et que l'on s'abstienne des cérémonies païennes, comme d'offrir de la verveine ou certaines branches d'arbres (le gui ?), de mettre le jour des flambeaux allumés sur la table où l'on faisait des festins, de chanter et de danser dans les rues ...
A SUIVRE ... peut être ...
sources : http://www.france-pittoresque.com/traditions/58.htm et http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fastam/f1-plan.html
21:38 Publié dans Bavardage, Histoire, traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 29 décembre 2010
Le code du travail a 100 ans.
Le code du travail a eu 100 ans hier. Gérard Filoche était hier matin sur France-Info pour en parler
Gerard FILOCHE et le centenaire du Code du travail
envoyé par FranceInfo. - L'info internationale vidéo.
Le "Code du Travail et de la Prévoyance Sociale" a été initialisé par la loi du 28 décembre 1910 portant codification des lois ouvrières.
Pendant la première moitié du XIXe siècle un certain nombre de voix s’élèvent pour critiquer le code civil qui n’a rien prévu pour les ouvriers. On lui reproche surtout l’inégalité des cocontractants dans le contrat de louage de services. A partir de 1830 des libéraux en réclament la révision pour y inclure une législation du travail. Sous la Monarchie de juillet, les socialistes et le parti républicain et démocrate réclament des réformes en faveur des ouvriers. Sous le Second Empire, en 1866 un comité se fonde pour étudier et préparer la refonte du code civil. La question est reprise sous la Troisième République à partir des années 1880.
 La question de codification des lois ouvrières est posée pour la première fois en France devant le Parlement par le député socialiste Arthur Groussier, qui dépose le 14 avril 1896 une proposition de résolution chargeant la commission du travail de rassembler et réviser toutes les lois concernant la défense des intérêts des travailleurs et réglant leurs rapports avec leurs employeurs pour en faire un Code du travail.
La question de codification des lois ouvrières est posée pour la première fois en France devant le Parlement par le député socialiste Arthur Groussier, qui dépose le 14 avril 1896 une proposition de résolution chargeant la commission du travail de rassembler et réviser toutes les lois concernant la défense des intérêts des travailleurs et réglant leurs rapports avec leurs employeurs pour en faire un Code du travail.
Arthur Groussier reprend l’idée dans la législature suivante et dépose le 13 juin 1898, une proposition sur le code du travail où il a procédé lui-même à la codification.
La proposition Groussier réglemente la formation du contrat, les obligations qui en résultent, les indemnités qui doivent être allouées en cas de brusque rupture, la fixation et le mode de paiement des salaires. Elle proclame la limitation de la durée du travail effectif à huit heures par jour avec une seule exception : en cas de réparations ou travaux nécessités par un accident grave. Groussier écrivait dans l'exposé des motifs de sa proposition, que la diminution des heures de travail est le seul moyen, dans l'organisation sociale actuelle, d'amoindrir les misères et les souffrances du prolétariat. La proposition contient l'indication des mesures les plus essentielles pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Près de cent articles sont consacrés aux assurances du travail. Enfin, la proposition envisage la création de deux institutions nouvelles, celle des Chambres de travail qui établiront les statistiques relatives au travail, garantiront le bon fonctionnement de l'inspection et étudieront les questions concernant les rapports des travailleurs et de leurs employeurs, celle des Tribunaux du travail, composés de patrons et d'ouvriers, comme nos Conseils de prud'hommes actuels, mais qui n'auront pas seulement compétence pour trancher les litiges concernant les contrats de travail, mais régleront aussi les contestations ouvertes à la suite, soit d'un accident, soit d'une infraction aux dispositions sur l'hygiène et la sécurité du travailleur. En même temps qu'il comblait les lacunes de la législation sociale, Groussier s'efforçait de mettre en ordre les textes épars concernant les salariés et disséminés dans les nombreuses lois qui se sont succédé au cours du dix-neuvième siècle. "Chaque année, disait-il dans son exposé de motifs, de nouvelles lois viennent s'ajouter, contredisant quelquefois sans les abroger les textes existants. Les dispositions particulières au travail s'enchevêtrent dans des textes d'ordre différent concernant l'assistance, l'hygiène générale, la prévoyance, et ces lois le plus souvent n'intéressent qu'une profession, une catégorie de travailleurs. Aucune vue d'ensemble ne se dégage de leur examen.". Cette proposition n'est pas votée.
En 1900, pour remédier aux lenteurs de l’élaboration d’une législation du travail, le groupe socialiste de la Chambre propose la création d’un Ministère du travail et la mise à l’étude immédiate d’un code ouvrier, synthèse méthodique de toutes les lois votées. Le 26 mars 1901, le député Julien Goujon dépose un nouveau projet de loi codifiant les lois industrielles et ouvrières pour en faire un code du travail. En janvier 1903 le projet socialiste de code du travail est présenté à nouveau au Parlement par le député Victor Dejeante.
Le Ministre en charge du commerce et de l’industrie dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, Alexandre Millerand, à la suite d’une autre proposition par Charles Benoist invitant le gouvernement à préparer un code du travail, institue une commission extra-parlementaire, chargée de la codification des lois du travail, mais il interdit à la commission d’introduire dans la législation une seule disposition nouvelle : son mandat unique est de codifier les lois en vigueur. Elle va travailler et aboutir à un projet d’ensemble divisé en six livres, dont elle présente les cinq premiers en avril 1904. Arthur Groussier a très activement collaboré à la rédaction des deux premiers livres, avec un juriste, Paul Sumien.
 En février 1905, le gouvernement s’approprie, sans changement, le texte préparé par la commission extraparlementaire, et dépose sur le bureau de la chambre, un projet englobant les livres I à V. La chambre le vote le 15 avril 1905 sans discussion et après de courtes observations du ministre du commerce Fernand Dubief, et des députés Jean Jaurès et Charles Benoist, rapporteur de la loi. Le Sénat est saisi, mais limite son examen au 1er livre malgré le rapport d’ensemble qui lui a été présenté par le sénateur Paul Strauss le 6 mars 1906
En février 1905, le gouvernement s’approprie, sans changement, le texte préparé par la commission extraparlementaire, et dépose sur le bureau de la chambre, un projet englobant les livres I à V. La chambre le vote le 15 avril 1905 sans discussion et après de courtes observations du ministre du commerce Fernand Dubief, et des députés Jean Jaurès et Charles Benoist, rapporteur de la loi. Le Sénat est saisi, mais limite son examen au 1er livre malgré le rapport d’ensemble qui lui a été présenté par le sénateur Paul Strauss le 6 mars 1906
Le Sénat fait traîner son étude du texte transmis après le vote de la Chambre ; il disjoint les livres, fait des changements de détail et finalement vote le 7 juin 1910. La Chambre saisie à nouveau, conformément au rapport Groussier, pour accélérer le processus, vote le texte sénatorial qui devient la loi du 28 décembre 1910 qui sera complétée par un décret du 12 janvier 1911. Le livre I du code du travail rentre en vigueur le jour même de la publication du décret, soit le 18 janvier 1911. Ce livre contient 106 articles qui remplacent seize lois.
Seul le livre I est donc adopté ("Des conventions relatives au travail") par la loi du 28 décembre 1910, C’est un texte incomplet, promulgué hâtivement, qui ne change rien à la législation existante, mais qui constitue une "codification des lois ouvrières" dans lequel sont rassemblés tous les textes qui assurent la protection légale des travailleurs, ou qui leur garantissent tant le droit d'association, que la possibilité de faire juger leurs différends par une juridiction professionnelle. Certes, ce code n’a pas créé pour les travailleurs des droits nouveaux, mais ce rassemblement des textes a été fait avec méthode, afin de faire ressortir les insuffisances et les superfétations de la législation existante. Il constitue un document précis, dans lequel employeurs et travailleurs trouvent facilement la définition de leurs droits et devoirs.
Le Livre II traite de la réglementation du travail. C'est dans ce livre que se trouvent codifiées les lois sur la limitation des heures de travail et sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Il sera adopté en juin 1912
Le Livre III a trait aux Groupements professionnels, livre IV concerne la juridiction et la représentation professionnelles. Les livres IV et III seront adoptés successivement en 1924 et 1927, après avoir perdu entre temps la partie V relative à la "prévoyance sociale".
Le code du travail concerne les salariés sous contrat de travail de droit privé, les salariés de secteur public étant soumis à des statuts particuliers.
Sa première grande refonte a eu lieu en 1973.
Plus récemment le gouvernement a mené entre février 2005 et mai 2008 une réécriture du code, dans le but affiché de le simplifier et de supprimer des dispositions jugées "obsolètes", ce qui a abouti en 2008 ... à doubler le nombre d'articles ! De plus ce Code du travail, a été largement affaibli par la loi TEPA qui vide de sa substance toute référence à une durée légale du travail, et par la réduction des moyens de contrôles de l'inspection du travail.
Des "bruits" courent que, à la demande du Medef, le gouvernement pourrait instituer une nouvelle mission d'étude pour le début d"année prochaine, devant se prononcer sur une nouvelle "simplification"...
19:40 Publié dans chronique à gauche, Histoire, militance | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 01 juillet 2010
C’est un trait de caractère. Pierre ne saura jamais le prix de l’argent !!!
 Soldes d'été, c'est parti pour cinq semaines de "bonnes affaires" : vêtements, chaussures, déco ... c'est, parait-il, Simon Mannoury, fondateur du premier grand magasin parisien Le "Petit Saint-Thomas" qui en aurait eu le premier l'idée ... la nouveauté de ce magasin créé en 1830, en plus de sa surface, c'est l'entrée libre, un large assortiment de produits réunis en un même endroit, les prix fixes particulièrement attractifs et clairement affichés grâce à l'étiquetage systématique des articles, la possibilité de les échanger, l'usage de la "réclame", et même la vente par correspondance, franco de port, ce qui va asseoir sa notoriété au-delà de la capitale !!! Mais la multiplication de produits entraîne des invendus en fin de saison, d'où l'idée de les liquider grâce à une forte réduction de prix. En 1872, le Littré appellera "solde" cette "marchandise vendue au rabais".
Soldes d'été, c'est parti pour cinq semaines de "bonnes affaires" : vêtements, chaussures, déco ... c'est, parait-il, Simon Mannoury, fondateur du premier grand magasin parisien Le "Petit Saint-Thomas" qui en aurait eu le premier l'idée ... la nouveauté de ce magasin créé en 1830, en plus de sa surface, c'est l'entrée libre, un large assortiment de produits réunis en un même endroit, les prix fixes particulièrement attractifs et clairement affichés grâce à l'étiquetage systématique des articles, la possibilité de les échanger, l'usage de la "réclame", et même la vente par correspondance, franco de port, ce qui va asseoir sa notoriété au-delà de la capitale !!! Mais la multiplication de produits entraîne des invendus en fin de saison, d'où l'idée de les liquider grâce à une forte réduction de prix. En 1872, le Littré appellera "solde" cette "marchandise vendue au rabais".
Boucicault, qui a travaillé au "Petit Saint Thomas", va s’inspirer de ces nouvelles méthodes de vente lorsqu’il va s’associer en 1852 à Paul Videau pour créer le magasin Le "Bon Marché Videau", qui dix ans plus tard ne s’appellera plus que "Le Bon Marché". D'autres grands magasins suivront, "Le Printemps" en 1865, "les Galeries Lafayette" en 1895, et enfin "le Bazar de l'Hôtel de Ville" en 1904, suivi de la "Samaritaine" cette même année.
Avec le Bon Marché, une nouvelle histoire commence : celle des grands magasins que Zola décrit dans son "Bonheur des dames" ... Bon Marché "le magasin de la famille", comme disait la réclame! Mais auparavant, me direz-vous, comment faisaient les bonnes ménagères ? c'est ce que raconte le Petit Pierre d'Anatole France :
"[...] J’étais sur le point de vous dire que dans la troisième année de mon âge, dix-huitième et dernière du règne de Louis-Philippe premier, roi des Français, mon plus grand plaisir était la promenade. On ne m’envoyait pas au bois comme le petit Chaperon Rouge. J’étais moins agreste, hélas ! Né et nourri dans le cœur de Paris, sur le beau quai Malaquais, j’ignorais les plaisirs des champs. Mais la ville a bien son charme aussi ; ma chère maman me conduisait par la main le long des rues aux bruits sans nombre, pleines de couleurs vives, et tout égayées du mouvement des passants ; et, quand elle avait quelque emplette à faire, elle me menait avec elle dans les magasins. Nous n’étions pas riches ; elle ne faisait pas grande dépense ; mais les magasins où elle fréquentait me semblaient d’une étendue et d’une magnificence impossibles à surpasser. Le Bon Marché, le Louvre, le Printemps, les Galeries n’existaient pas encore. Les plus vastes établissements de ce genre, dans les dernières années de la royauté constitutionnelle, n’avaient qu’une clientèle de quartier. Ma mère, qui était du faubourg Saint-Germain, allait aux Deux-Magots et au Petit Saint-Thomas.
De ces deux magasins, situés l’un rue de Seine, l’autre rue du Bac, ce dernier seul subsiste encore, mais tellement agrandi et si différent, avec les mufles de lions qui horrifient sa façade, de ce qu’il était dans sa nouveauté gracile, que je ne le reconnais plus. Les Deux-Magots ont disparu et peut-être suis-je le seul au monde à me rappeler la grande peinture à l’huile qui y servait d’enseigne et représentait une jeune Chinoise entre deux de ses compatriotes. Sentant déjà avec vivacité la beauté des femmes, je trouvais cette jeune Chinoise charmante avec ses cheveux relevés par un grand peigne et ses accroche-cœurs sur les tempes. Mais des deux galants, de leur maintien, de leur regard, de leurs gestes, de leurs intentions, je ne saurais rien dire. J’ignorais tout de l’art de séduire.
Ce magasin me paraissait immense et rempli de trésors. C’est là, peut-être, que j’ai pris le goût des arts somptueux qui est devenu très fort en moi et ne m’a jamais quitté. La vue des étoffes, des tapis, des broderies, des plumes, des fleurs, me jetait dans une sorte d’extase, et j’admirais de toute mon âme les messieurs affables et les gracieuses demoiselles qui offraient en souriant ces merveilles aux clients indécis. Quand un commis, pour servir ma mère, mesurait une étoffe sur un mètre fixé horizontalement à une tige de cuivre qui descendait du plafond, j’estimais son sort magnifique et sa destinée glorieuse.
 J’admirais aussi M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui m’essayait des vestes et des culottes courtes. J’eusse préféré qu’il me fît un pantalon et une redingote comme en portaient les messieurs ; et ce désir devint très ardent un peu plus tard, quand je lus un conte de Bouilly sur un malheureux petit garçon recueilli par un savant bienfaisant et respectable qui l’employait comme secrétaire et l’habillait de ses vieux habits. Ce conte du bon Bouilly me fit faire une grande folie que je dirai une autre fois. Plein d’estime pour les arts et métiers, j’admirais M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui n’était pas admirable, car il taillait ses étoffes tout de travers. Pour dire vrai, dans les habits de sa façon, j’avais l’air d’un singe.
J’admirais aussi M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui m’essayait des vestes et des culottes courtes. J’eusse préféré qu’il me fît un pantalon et une redingote comme en portaient les messieurs ; et ce désir devint très ardent un peu plus tard, quand je lus un conte de Bouilly sur un malheureux petit garçon recueilli par un savant bienfaisant et respectable qui l’employait comme secrétaire et l’habillait de ses vieux habits. Ce conte du bon Bouilly me fit faire une grande folie que je dirai une autre fois. Plein d’estime pour les arts et métiers, j’admirais M. Augris, le tailleur de la rue du Bac, qui n’était pas admirable, car il taillait ses étoffes tout de travers. Pour dire vrai, dans les habits de sa façon, j’avais l’air d’un singe.
Ma chère maman achetait elle-même, en bonne ménagère, l’épicerie chez Courcelles, rue Bonaparte, le café chez Corcelet, au Palais-Royal, et le chocolat chez Debeauve et Gallais, rue des Saints-Pères. Soit qu’il donnât libéralement ses pruneaux à goûter, soit qu’il fît briller au soleil les cristaux d’un pain de sucre, soit que, d’un geste élégant et hardi, il tînt renversé un pot de gelée de groseilles pour en éprouver la consistance, M. Courcelles me charmait par ses grâces persuasives et ses démonstrations péremptoires. J’en voulais presque à ma chère maman d’accueillir avec un air de doute et d’incrédulité les affirmations toujours illustrées d’exemples que lui faisait cet éloquent épicier. J’ai su depuis que le scepticisme de ma chère maman était fondé.
Je vois encore la boutique de Corcelet[i], à l’enseigne du "Gourmand", petite et basse, avec son inscription en lettres d’or sur fond rouge. Elle exhalait un délicieux arôme de café et l’on y voyait une peinture déjà vieille à cette époque, qui représentait un gourmand, habillé à la mode de mon grand-père. Il était assis devant une table couverte de bouteilles, chargée d’un pâté monstrueux et ornée d’un ananas décoratif. Je puis dire, grâce à des clartés qui me sont venues beaucoup plus tard, que c’était un portrait de Grimod de la Reynière peint par Boilly. J’entrais avec respect dans cette maison qui me semblait d’un autre âge et me faisait remonter jusqu’au Directoire. L’employé de Corcelet pesait et servait en silence. Sa simplicité, qui contrastait avec les façons emphatiques de M. Courcelles, faisait impression sur moi, et il se peut qu’un vieux garçon épicier m’ait enseigné des premiers le goût et la mesure.
 Je ne sortais jamais de chez Corcelet sans avoir pris un grain de café que je mâchais en chemin. Je me disais que c’était très bon et m’en croyais à demi. Je sentais intérieurement que c’était exécrable, mais n’étais pas encore capable de tirer au jour les vérités enfouies au dedans de moi-même. Si plaisant que me fût le magasin de Corcelet, à l’enseigne du "Gourmand", celui de Debeauve et Gallais[ii], fournisseurs des rois de France, m’agréait davantage et me charmait plus que tout autre. Il me semblait si beau que je ne m’estimais pas digne d’y entrer sans mes habits du dimanche, et j’examinais sur le seuil la toilette de ma chère maman pour m’assurer qu’elle était suffisamment élégante. Eh ! bien, je n’avais pas le goût si mauvais ! La chocolaterie Debeauve et Gallais, fournisseurs des rois de France, existe encore, et le décor n’en a pas beaucoup changé[iii]. Je puis donc en parler en toute connaissance et non sur des souvenirs infidèles. Elle a très bon air ; sa décoration date des premières années de la Restauration, alors que le style ne s’était pas encore trop alourdi ; elle est dans le caractère de Percier et Fontaine. Je songe, avec tristesse, en voyant ces motifs un peu secs, mais fins, mais purs et bien ordonnés, combien le goût a décliné en France depuis un siècle. Que nous sommes loin aujourd’hui de cet art décoratif de l’Empire, pourtant bien inférieur au Louis XVI et au Directoire ! Il faut louer dans ce vieux magasin l’enseigne en lettres bien proportionnées, bien carrées ; les fenêtres cintrées et leur imposte en éventail, le fond du magasin arrondi comme un petit temple, et le comptoir en hémicycle qui suit la forme de la salle. Je ne sais si je rêve ; mais je crois y avoir vu des trumeaux avec des Renommées qui pouvaient aussi bien célébrer Arcole et Lodi que la crème de cacao et les chocolats pralinés. Enfin tout cela relève d’un style, offre un caractère, présente une signification. Que fait-on à cette heure ? Il y a toujours des artistes de génie, mais les arts décoratifs sont tombés dans une ignominieuse décadence. Le style Troisième République fait regretter le Napoléon III, qui faisait regretter le Louis-Philippe, qui faisait regretter le Charles X, qui faisait regretter l’Empire, qui faisait regretter le Directoire, qui faisait regretter le Louis XVI. Le sens des lignes et des proportions est entièrement perdu. Aussi vois-je venir avec joie l’art nouveau, moins certes pour ce qu’il crée, que pour ce qu’il détruit.
Je ne sortais jamais de chez Corcelet sans avoir pris un grain de café que je mâchais en chemin. Je me disais que c’était très bon et m’en croyais à demi. Je sentais intérieurement que c’était exécrable, mais n’étais pas encore capable de tirer au jour les vérités enfouies au dedans de moi-même. Si plaisant que me fût le magasin de Corcelet, à l’enseigne du "Gourmand", celui de Debeauve et Gallais[ii], fournisseurs des rois de France, m’agréait davantage et me charmait plus que tout autre. Il me semblait si beau que je ne m’estimais pas digne d’y entrer sans mes habits du dimanche, et j’examinais sur le seuil la toilette de ma chère maman pour m’assurer qu’elle était suffisamment élégante. Eh ! bien, je n’avais pas le goût si mauvais ! La chocolaterie Debeauve et Gallais, fournisseurs des rois de France, existe encore, et le décor n’en a pas beaucoup changé[iii]. Je puis donc en parler en toute connaissance et non sur des souvenirs infidèles. Elle a très bon air ; sa décoration date des premières années de la Restauration, alors que le style ne s’était pas encore trop alourdi ; elle est dans le caractère de Percier et Fontaine. Je songe, avec tristesse, en voyant ces motifs un peu secs, mais fins, mais purs et bien ordonnés, combien le goût a décliné en France depuis un siècle. Que nous sommes loin aujourd’hui de cet art décoratif de l’Empire, pourtant bien inférieur au Louis XVI et au Directoire ! Il faut louer dans ce vieux magasin l’enseigne en lettres bien proportionnées, bien carrées ; les fenêtres cintrées et leur imposte en éventail, le fond du magasin arrondi comme un petit temple, et le comptoir en hémicycle qui suit la forme de la salle. Je ne sais si je rêve ; mais je crois y avoir vu des trumeaux avec des Renommées qui pouvaient aussi bien célébrer Arcole et Lodi que la crème de cacao et les chocolats pralinés. Enfin tout cela relève d’un style, offre un caractère, présente une signification. Que fait-on à cette heure ? Il y a toujours des artistes de génie, mais les arts décoratifs sont tombés dans une ignominieuse décadence. Le style Troisième République fait regretter le Napoléon III, qui faisait regretter le Louis-Philippe, qui faisait regretter le Charles X, qui faisait regretter l’Empire, qui faisait regretter le Directoire, qui faisait regretter le Louis XVI. Le sens des lignes et des proportions est entièrement perdu. Aussi vois-je venir avec joie l’art nouveau, moins certes pour ce qu’il crée, que pour ce qu’il détruit.
 Ai-je besoin de dire que, à trois ou quatre ans, je ne raisonnais pas sur la décoration ? Mais, en pénétrant dans la maison Debeauve et Gallais, je croyais entrer dans un palais de fées. Ce qui ajoutait à mon illusion c’était d’y voir de belles demoiselles en robe noire, et les cheveux tout brillants, assises derrière le comptoir en hémicycle avec une gracieuse solennité. Au milieu d’elles se tenait, douce et grave, une dame âgée qui écrivait dans des registres sur un grand pupitre et maniait des pièces de monnaie et des billets de banque. Il va bientôt paraître que je n’acquis point une suffisante intelligence des opérations qu’effectuait cette dame vénérable. A ses côtés, les jeunes filles brunes ou blondes s’occupaient, les unes à recouvrir les tablettes de chocolat d’une mince feuille de métal clair comme l’argent, les autres à envelopper deux par deux ces mêmes tablettes dans du papier blanc à vignettes et à fermer ces enveloppes avec de la cire qu’elles chauffaient à la flamme d’une petite lampe en fer-blanc. Elles accomplissaient ces tâches très adroitement et avec une célérité qui ressemblait à de l’allégresse. Je pense aujourd’hui qu’elles ne travaillaient point ainsi pour leur plaisir. Alors je pouvais m’y tromper, enclin comme j’étais à prendre tous les travaux pour des amusements. Il est certain du moins que c’était une joie des yeux que de voir courir les doigts fuselés de ces jeunes filles.
Ai-je besoin de dire que, à trois ou quatre ans, je ne raisonnais pas sur la décoration ? Mais, en pénétrant dans la maison Debeauve et Gallais, je croyais entrer dans un palais de fées. Ce qui ajoutait à mon illusion c’était d’y voir de belles demoiselles en robe noire, et les cheveux tout brillants, assises derrière le comptoir en hémicycle avec une gracieuse solennité. Au milieu d’elles se tenait, douce et grave, une dame âgée qui écrivait dans des registres sur un grand pupitre et maniait des pièces de monnaie et des billets de banque. Il va bientôt paraître que je n’acquis point une suffisante intelligence des opérations qu’effectuait cette dame vénérable. A ses côtés, les jeunes filles brunes ou blondes s’occupaient, les unes à recouvrir les tablettes de chocolat d’une mince feuille de métal clair comme l’argent, les autres à envelopper deux par deux ces mêmes tablettes dans du papier blanc à vignettes et à fermer ces enveloppes avec de la cire qu’elles chauffaient à la flamme d’une petite lampe en fer-blanc. Elles accomplissaient ces tâches très adroitement et avec une célérité qui ressemblait à de l’allégresse. Je pense aujourd’hui qu’elles ne travaillaient point ainsi pour leur plaisir. Alors je pouvais m’y tromper, enclin comme j’étais à prendre tous les travaux pour des amusements. Il est certain du moins que c’était une joie des yeux que de voir courir les doigts fuselés de ces jeunes filles.
Quand maman avait fait son emplette, la matrone qui présidait cette assemblée de vierges sages prenait dans une coupe de cristal placée à son côté une pastille de chocolat qu’elle m’offrait avec un pâle sourire. Et ce présent solennel me faisait aimer et admirer plus que tout le reste la maison de MM. Debeauve et Gallais, fournisseurs des rois de France.
Ayant du goût pour les magasins, il était bien naturel que, rentré à la maison, j’essayasse dans mes jeux l’imitation des scènes que j’avais observées pendant que ma mère faisait ses emplettes. Aussi étais-je, au logis, pour moi seul et à l’insu de tout le monde, tour à tour, tailleur, épicier, commis de nouveautés et même, sans plus d’embarras, marchande de modes et chocolatière. Or, un soir, dans le petit cabinet tendu de boutons de roses où se tenait ma mère, sa broderie à la main, je m’appliquai avec plus de soin que de coutume à contrefaire les belles demoiselles de la maison Debeauve et Gallais. M’étant procuré des morceaux de chocolat en aussi grande quantité que possible, des bouts de papier, et même des lambeaux de ces feuilles métalliques que j’appelais emphatiquement du papier d’argent, le tout à vrai dire fort défraîchi, je m’installai dans ma petite chaise, don de ma tante Chausson, devant un tabouret garni de molesquine, et cela représentait à mes yeux l’élégant hémicycle du magasin de la rue des Saints-Pères. Enfant unique, habitué à jouer seul et toujours enfoncé dans quelque rêverie, vivant beaucoup enfin dans le monde des songes, il ne me fut pas difficile d’imaginer le magasin absent, ses lambris, ses vitrines, ses trumeaux ornés de Renommées et même les acheteurs qui affluaient, femmes, enfants, vieillards, tant je possédais le don d’évoquer à mon gré les scènes et les personnes. Je n’eus point de peine à devenir à moi seul les demoiselles, toutes les demoiselles chocolatières et la dame respectable qui tenait les registres et disposait de l’argent. Mon pouvoir magique était sans bornes et dépassait tout ce que j’ai lu depuis, dans l’Ane d’Or, des sorcières de Thessalie. Je changeais à mon gré de nature : j’étais capable de revêtir les figures les plus étranges et les plus extraordinaires, de devenir, par enchantement, roi, dragon, diable, fée… que dis-je ? de me changer en une armée, en un fleuve, en une forêt, en une montagne. Aussi ce que je tentais ce soir-là était pur badinage et ne souffrait pas la moindre difficulté. Donc, j’enveloppai, je cachetai, je servis la clientèle innombrable, femmes, enfants, vieillards. Pénétré de mon importance (dois-je l’avouer ?) je parlais fort sèchement à mes compagnes imaginaires, pressant leurs lenteurs et relevant sans bienveillance leurs méprises. Mais, quand il s’agit de faire la dame âgée et respectable, préposée à la caisse, je me trouvai soudain embarrassé. En cette conjoncture, je sortis du magasin et allai demander à ma chère maman un éclaircissement sur le point qui restait obscur pour moi. J’avais bien vu la dame âgée ouvrir son tiroir et remuer des pièces d’or et d’argent ; mais je ne me faisais pas une idée suffisamment exacte des opérations qu’elle effectuait. Agenouillé aux pieds de ma chère maman qui, dans sa bergère, brodait un mouchoir, je lui demandai :
— Maman, dans les magasins, est-ce celui qui vend ou celui qui achète, qui donne de l’argent ?
Maman me regarda avec une surprise qui lui arrondit les yeux et lui fit remonter les sourcils, et sourit sans me répondre. Puis elle demeura pensive. Mon père entra, en ce moment, dans la chambre :
— Mon ami, lui dit-elle, sais-tu ce que Pierrot vient de me demander ?… Tu ne le devinerais jamais… Il m’a demandé si c’est celui qui vend ou celui qui achète, qui donne de l’argent.
— Oh ! le petit nigaud ! fit mon père.
Ma mère reprit d’un ton sérieux, avec une sorte d’inquiétude sur le visage :
— Mon ami, ce n’est pas seulement une bêtise d’enfant ; c’est un trait de caractère. Pierre ne saura jamais le prix de l’argent.
Ma bonne mère avait reconnu mon génie et deviné ma destinée : elle prophétisait. Je ne devais jamais connaître le prix de l’argent. Tel j’étais à trois ans ou trois ans et demi dans le cabinet tapissé de boutons de roses, tel je restai jusqu’à la vieillesse, qui m’est légère, comme elle l’est à toutes les âmes exemptes d’avarice et d’orgueil. Non, maman, je n’ai jamais connu le prix de l’argent. Je ne le connais pas encore, ou plutôt je le connais trop bien. Je sais que l’argent est cause de tous les maux qui désolent nos sociétés si cruelles et dont nous sommes si fiers. Ce petit garçon que j’étais, qui, dans ses jeux, ignorait lequel doit payer du vendeur ou de l’acheteur, me fait songer tout à coup au fabricant de pipes que nous montre William Morris dans son beau conte prophétique, ce sculpteur ingénu qui, dans la cité future, fait des pipes d’une beauté non pareille parce qu’il les fait avec amour, et qu’il les donne et ne les vend pas.
[i] « …C'est un spectacle touchant que celui d'un riche magasin de comestibles au mois de février. Dans la boutique des Chevet et Corcelet, on voit se presser la dinde appétissante, le pâté de foies de canards, celui de Périgueux, de Chartres ou de Strasbourg,, la terrine de Nérac , la hure de Troyes, la truffe de Périgord, les produits nutritifs de la France entière…» ( Dictionnaire de cuisine et d'économie ménagère par Burnet - 1836 )
[ii] En 1825, Brillat-Savarin écrivit dans sa "Physiologie du goût": "les chocolats de M. Debauve doivent leur suprématie à un bon choix de matériaux, à une volonté ferme que rien d'inférieur ne sorte de sa manufacture et au coup d'œil du maître qui embrasse tous les détails de la fabrication".
[iii] En 1800, Sulpice Debauve, pharmacien du feu Roi Louis XVI, ouvre avec son neveu, Antoine Gallais, une chocolaterie tout près de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Sa réputation en fit le fournisseur attitré des Rois Louis XVIII, puis Charles X et Louis-Philippe. Cette boutique a été réalisée à la fin du 19ème siècle en pur style Louis XVI gris et or, est un écrin soigneusement préservé dans lequel les bonbons de Debauve et Gallais, plus ancienne chocolaterie parisienne, sont admirablement présentés.
20:31 Publié dans Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |
dimanche, 27 juin 2010
Bordeaux, Juin 1940 ...
Pour la troisième fois, pendant quelques jours, Bordeaux devient "capitale" française ...
 Depuis Mai, l’invasion de la Belgique et l’avancée éclair de l’armée allemande, nombre de véhicules de toutes sortes, de toutes tailles, camionnettes, voitures avec ou sans remorques, charrettes à bras, venues de Belgique, du Luxembourg, de Lorraine, du Nord et de la région parisienne, surchargées de valises, de cartons, de baluchons mal ficelés surmontés de matelas fixés tant bien que mal pour protéger des mitraillages, fuient sur les chemins de l’exode, traversent l’unique pont de Bordeaux, déferlent sur les quais ... Au cours des semaines leur nombre augmente sans cesse
Depuis Mai, l’invasion de la Belgique et l’avancée éclair de l’armée allemande, nombre de véhicules de toutes sortes, de toutes tailles, camionnettes, voitures avec ou sans remorques, charrettes à bras, venues de Belgique, du Luxembourg, de Lorraine, du Nord et de la région parisienne, surchargées de valises, de cartons, de baluchons mal ficelés surmontés de matelas fixés tant bien que mal pour protéger des mitraillages, fuient sur les chemins de l’exode, traversent l’unique pont de Bordeaux, déferlent sur les quais ... Au cours des semaines leur nombre augmente sans cesse
La population bordelaise assiste à un raz-de-marée humain de près de 1,5 million d’hommes, de femmes et d’enfants qui va tenter de trouver refuge dans la région. . La place des Quinconces, l'une des plus vastes du port de la lune, est noire de monde. Les réfugiés vivent dans la rue ... mais l'arrivée des réfugiés se concentre surtout dans deux lieux précis : À la gare Saint-Jean, tout d'abord, où s'entassent des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, effondrés sur leurs ballots. Des étudiants de Bordeaux sont mobilisés pour leur distribuer des repas froids; place Pey-Berland, ensuite, point de ralliement des réfugiés équipés de voitures et en partance pour l'Espagne, le Portugal ou le sud de la France, transformée en gare routière.
 Le "port de la lune" subit lui aussi les conséquences du conflit. De nombreux navires se rendant vers les ports de Bretagne et de la Manche sont détournés vers Bordeaux au fur et à mesure que les villes du Nord sont prises par les Allemands. L’embouchure de la Gironde reçoit dans un désordre général des dizaines de navires venus de toute la France. Bien sûr, l’intégralité des importations militaires est orientée vers Bordeaux. Le trafic passe de 65 000 t par semaine à 184 000 t pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Mais cette joyeuse pagaille n’est que de courte durée car, bientôt, tout doit repartir. Casablanca, qui est proche de Bordeaux et a depuis longtemps des liens privilégiés avec elle, reçoit l’essentiel des navires en fuite. Les produits militaires sont réexpédiés vers les colonies nord-africaines ou l’Angleterre pour ne pas tomber entre les mains des Allemands. Les navires se trouvant dans le port de Bordeaux sont chargés de matériel aéronautique, comme le San Diego, de métaux, en particulier les Casamance ou le Sloga. Le contre-amiral Barnouin, qui sait que la Gironde nécessite des dragages fréquents, expédie la puissante drague Pierre Lefort à Casablanca, dans l'espoir de gêner l’exploitation économique du port par les nazis.
Le "port de la lune" subit lui aussi les conséquences du conflit. De nombreux navires se rendant vers les ports de Bretagne et de la Manche sont détournés vers Bordeaux au fur et à mesure que les villes du Nord sont prises par les Allemands. L’embouchure de la Gironde reçoit dans un désordre général des dizaines de navires venus de toute la France. Bien sûr, l’intégralité des importations militaires est orientée vers Bordeaux. Le trafic passe de 65 000 t par semaine à 184 000 t pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Mais cette joyeuse pagaille n’est que de courte durée car, bientôt, tout doit repartir. Casablanca, qui est proche de Bordeaux et a depuis longtemps des liens privilégiés avec elle, reçoit l’essentiel des navires en fuite. Les produits militaires sont réexpédiés vers les colonies nord-africaines ou l’Angleterre pour ne pas tomber entre les mains des Allemands. Les navires se trouvant dans le port de Bordeaux sont chargés de matériel aéronautique, comme le San Diego, de métaux, en particulier les Casamance ou le Sloga. Le contre-amiral Barnouin, qui sait que la Gironde nécessite des dragages fréquents, expédie la puissante drague Pierre Lefort à Casablanca, dans l'espoir de gêner l’exploitation économique du port par les nazis.
L’eau lourde (oxyde de deutérium) et le radium utilisés pour les expériences menées sur la fission de l'uranium et la réaction en chaîne, dans les laboratoires du collège de France, qui avaient été transportés en Gironde, sont envoyés en Angleterre. Le 18 juin Frédéric Joliot ayant décidé de rester en France, ses collègues Kowarski et Halban emmènent avec eux vingt-six bidons contenant le stock mondial d'eau lourde, soit cent quatre vingt cinq kilos, prêté en mars 1940 à la France de préférence à l'Allemagne par la Norvège, un mois avant son invasion par les troupes nazies. Ils sot munis d'un ordre de mission antidaté du ministre de l'Armement démissionnaire, Raoul Dautry, spécifiant "qu'ils sont chargés de poursuivre en Angleterre les recherches entreprises au Collège de France et sur lesquelles sera observé un secret absolu ". A Paris, les Allemands furieux convoquent Joliot-Curie. Trois bateaux avaient quitté Bordeaux ce jour-là. Deux ont été coulés par la Luftwaffe. Halban et Kowalski étaient sur le troisième. Avec beaucoup de sang froid, Joliot donne le nom d’un des bâtiments qui ont disparu. Les Allemands sont rassurés. Jusqu'à la fin de la guerre, ils ignoreront que l’eau lourde est à la disposition de l’effort de guerre allié ainsi que les deux ingénieurs français qui l’on emportée.
C’est aussi de Bordeaux que part une partie des réserves de la Banque de France, qui y a transféré son siège social. Des devises, de l’or, des titres et valeurs sont chargés sur quatre bâtiments qui partent pour le Maroc et le Canada. Les derniers navires quitteront Bordeaux le 24 juin, alors que l’armistice a déjà été signé à Compiègne. De même le personnel de la radio d'Etat est transféré de Paris à Bordeaux le 10 juin 1940.
A Bordeaux se replie aussi une partie de l'industrie : en 1938, l'expansion hitlérienne et les Accords de Munich avaient conduit le gouvernement français à inviter les industriels à créer des usines loin des zones présumées des futurs combats. La Société anonyme des automobiles Peugeot (SAAP), avait opté pour des usines en région bordelaise : une 18 quai de Queyrie dans une fabrique de conserves de fruits abandonnée depuis 7 ans, pour la fabrication des pièces du moteur Gnome-Rhone 14M, une 84 rue du Médoc au Bouscat dans les ateliers de réparation d'une de ses succursales pour la fabrication d'outillages, et la dernière à Mérignac, le château de Beauséjour à Arlac, destinée aux ateliers de carrosserie et de fonderie sur les 22 hectares du site, dans le but de fabriquer des trains d'atterrissage, une partie de cellules d'avions Amiot et des compresseurs Gnome-Rhône, mais aussi avec l'arrière pensée d'installer une usine d'automobiles après la guerre ... Peugeot crée même une école d'apprentissage au Bouscat. En juin 1940, les usines Peugeot de la région bordelaise sont opérationnelles, et 4 000 salariés de Sochaux ainsi qu’une partie des archives sont évacués sur Bordeaux, à la demande du gouvernement. L'école Flornoy, dans le quartier Saint Augustin, accueille quelques uns de ces réfugiés. Le bombardement de Bordeaux de Juin 1940 par les avions allemands fera rentrer chez eux la plupart des Franc-Comtois. Pendant l'occupation, les troupes allemandes organiseront à Beauséjour un atelier de réparation des automobiles, en particulier celles récupérées sur les chemins de l'exode; mais un groupe de résistance "Peugeot" sabotera les machines-outils.
En quelques semaines, la population bordelaise est multipliée par deux, passant de 300 000 à 700 000 habitants. Une telle foule n'est plus contrôlable ... Le Ministre de l'intérieur Georges Mandel prend un arrêté obligeant les réfugiés de Belgique, de Hollande et du Luxembourg entrés en France depuis le 10 mai, à se présenter aux autorités, sous peine d'internement. Le 28 mai, le préfet demande aux non-Français (Belges et Luxembourgeois surtout) de se replier sur la Haute-Garonne, l'Hérault ou la Côte d'Or. Le 6 juin, le maire Adrien Marquet prend la décision de rationner l'eau. Le 10 juin, les réfugiés sont sommés de quitter Bordeaux et un périmètre de 20 kilomètres autour de Bordeaux avant le 13 juin, dernier délai ! Il s'agit de faire de la place pour le Gouvernement français qui a quitté Paris ...
Le préfet Bodeman ordonne que tous les navires quittant le port et à destination soit de l’Afrique du Nord, soit de l’Angleterre, soit des colonies, emmènent autant de passagers étrangers que possible. Cela diminue les interminables files d’attente devant les consulats des pays neutres (Etats-Unis, Espagne, Portugal) et de Grande-Bretagne, lesquels, de toute manière, ne délivrent les visas qu’au compte-gouttes. L’évacuation des ressortissants étrangers, mêlés aux civils français partant pour l’Afrique du Nord, dure ainsi jusqu’à ce que la Gironde et ses ports deviennent impraticables.
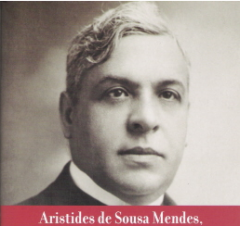 Le consul portugais à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, homme de grande culture et de grande sensibilité, est au fait de la situation des réfugiés étrangers qui ont, pour la plupart, déjà fui le régime nazi quand il s’est installé dans leur pays natal. Confronté à une demande massive, il essaie chaque fois d'obtenir de son premier ministre l'autorisation de délivrance de visas, et se heurte à des refus systématiques, car Salazar, qui a peur de voir arriver chez lui trop de personnes jugées indésirables, a commis la fameuse circulaire numéro quatorze, du 11 novembre 1939, qui permet de trier les réfugiés et interdit aux consuls de délivrer des visas sans un accord préalable du ministère. ... mi juin, Sousa Mendes décide de délivrer, sans aucun critère et sans aucune limite, des visas, des faux passeports à tous ceux qui en font la demande. "Je déclare que je donnerai, gratuitement, un visa à quiconque le réclamera. Je désire être du côté de Dieu contre l’homme, plutôt que de servir l’homme, contre Dieu." La nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi la population cosmopolite des réfugiés. L'espoir renaît. Entre le 17 et 21 juin il sauve ainsi plus de 30 000 personnes en mettant sa signature et son tampon sur des documents de toutes natures. Le 22 juin, Aristides de Sousa Mendes continue de délivrer les précieux sésames depuis Bayonne où il se réfugie, puis à Hendaye où il tient une sorte de permanence administrative à la terrasse des cafés. Le 23 juin, Salazar décrète que les visas émis par le consul général du Portugal à Bordeaux sont nuls et sans effet. Fin juin, les autorités allemandes et espagnoles félicitent Salazar pour sa décision de maintien de l'ordre et pour avoir mis un terme aux agissements de son consul général à Bordeaux. Salazar ordonne l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Aristides de Sousa Mendes quatre jours avant son retour au Portugal, le 4 juillet 1940. Ce même jour, il informe les autorités anglaises qu'il a mis fin aux dysfonctionnements qui se sont produits à Bordeaux et à Bayonne et que le consul a été relevé de ses fonctions. Aristides de Sousa Mendes prend alors la tête d’une colonne de réfugiés et se dirige vers la frontière espagnole. Il parvient à faire passer la frontière espagnole à tous les réfugiés, qui parviendront ainsi au Portugal. Rentré au Portugal le 8 juillet, Sousa Mendes se voit privé de nombreux droits : exercice de la profession, permis de conduire. Il survit alors grâce à la solidarité de la communauté juive de Lisbonne. Il mourra dans la misère le 3 avril 1954. Yad Vashem le fera Juste parmi les Nations.
Le consul portugais à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, homme de grande culture et de grande sensibilité, est au fait de la situation des réfugiés étrangers qui ont, pour la plupart, déjà fui le régime nazi quand il s’est installé dans leur pays natal. Confronté à une demande massive, il essaie chaque fois d'obtenir de son premier ministre l'autorisation de délivrance de visas, et se heurte à des refus systématiques, car Salazar, qui a peur de voir arriver chez lui trop de personnes jugées indésirables, a commis la fameuse circulaire numéro quatorze, du 11 novembre 1939, qui permet de trier les réfugiés et interdit aux consuls de délivrer des visas sans un accord préalable du ministère. ... mi juin, Sousa Mendes décide de délivrer, sans aucun critère et sans aucune limite, des visas, des faux passeports à tous ceux qui en font la demande. "Je déclare que je donnerai, gratuitement, un visa à quiconque le réclamera. Je désire être du côté de Dieu contre l’homme, plutôt que de servir l’homme, contre Dieu." La nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi la population cosmopolite des réfugiés. L'espoir renaît. Entre le 17 et 21 juin il sauve ainsi plus de 30 000 personnes en mettant sa signature et son tampon sur des documents de toutes natures. Le 22 juin, Aristides de Sousa Mendes continue de délivrer les précieux sésames depuis Bayonne où il se réfugie, puis à Hendaye où il tient une sorte de permanence administrative à la terrasse des cafés. Le 23 juin, Salazar décrète que les visas émis par le consul général du Portugal à Bordeaux sont nuls et sans effet. Fin juin, les autorités allemandes et espagnoles félicitent Salazar pour sa décision de maintien de l'ordre et pour avoir mis un terme aux agissements de son consul général à Bordeaux. Salazar ordonne l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Aristides de Sousa Mendes quatre jours avant son retour au Portugal, le 4 juillet 1940. Ce même jour, il informe les autorités anglaises qu'il a mis fin aux dysfonctionnements qui se sont produits à Bordeaux et à Bayonne et que le consul a été relevé de ses fonctions. Aristides de Sousa Mendes prend alors la tête d’une colonne de réfugiés et se dirige vers la frontière espagnole. Il parvient à faire passer la frontière espagnole à tous les réfugiés, qui parviendront ainsi au Portugal. Rentré au Portugal le 8 juillet, Sousa Mendes se voit privé de nombreux droits : exercice de la profession, permis de conduire. Il survit alors grâce à la solidarité de la communauté juive de Lisbonne. Il mourra dans la misère le 3 avril 1954. Yad Vashem le fera Juste parmi les Nations.
À partir du 14 juin, le gouvernement français et tout l'appareil d'État, soit plus d'un millier de fonctionnaires, se replient à leur tour en Gironde. Le président de la République, Albert Lebrun, s’installe dans l’hôtel de préfecture et le président du Conseil, Paul Reynaud, également ministre des Affaires étrangères, de la Défense nationale et de la Guerre, dans l’hôtel du commandant de la XVIIIe région militaire, deux bâtiments situés rue Vital-Carles.
 Etrange théâtre, ce 16 juin 1940, que la ville de Bordeaux, devenue la capitale improvisée d'une France déjà largement envahie par les troupes hitlériennes : trois conseils de ministres en vingt-quatre heures, présidés par deux chefs de gouvernement successifs, Paul Reynaud et le maréchal Pétain, l'un à bout de résistance, l'autre usé par l'âge et décidé à arrêter les combats. Un monde s'écroule au milieu d'un immense exode et d'un chaos indescriptible. Une république se meurt dans une indifférence quasi générale. Le 17 juin, Paul Reynaud démissionne, aussitôt remplacé par le maréchal Pétain, le "vainqueur de Verdun", qui invite le jour même, depuis le studio de la radio Bordeaux-Lafayette, les Français "à cesser le combat". Il demande l'armistice à l’Allemagne, signant la défaite de la France, la fin de la IIIe République et s’engageant dans la politique de collaboration avec l'occupant. Jusqu'au 29 juin, date du départ du gouvernement pour Vichy, Bordeaux est bien la capitale de la défaite. Le 27 juin, son maire, Adrien Marquet, devient le ministre de l'Intérieur de Philippe Pétain ...
Etrange théâtre, ce 16 juin 1940, que la ville de Bordeaux, devenue la capitale improvisée d'une France déjà largement envahie par les troupes hitlériennes : trois conseils de ministres en vingt-quatre heures, présidés par deux chefs de gouvernement successifs, Paul Reynaud et le maréchal Pétain, l'un à bout de résistance, l'autre usé par l'âge et décidé à arrêter les combats. Un monde s'écroule au milieu d'un immense exode et d'un chaos indescriptible. Une république se meurt dans une indifférence quasi générale. Le 17 juin, Paul Reynaud démissionne, aussitôt remplacé par le maréchal Pétain, le "vainqueur de Verdun", qui invite le jour même, depuis le studio de la radio Bordeaux-Lafayette, les Français "à cesser le combat". Il demande l'armistice à l’Allemagne, signant la défaite de la France, la fin de la IIIe République et s’engageant dans la politique de collaboration avec l'occupant. Jusqu'au 29 juin, date du départ du gouvernement pour Vichy, Bordeaux est bien la capitale de la défaite. Le 27 juin, son maire, Adrien Marquet, devient le ministre de l'Intérieur de Philippe Pétain ...
Mais ce même 17 juin à Bordeaux, le général de Gaulle n’accepte pas de déposer les armes. En désaccord avec Pétain, il choisit de désobéir ! Il quitte la France et s'envole de Mérignac pour Londres, "emportant avec lui l'honneur de la France" comme l’écrivait sir Winston Churchill. Il y prononcera le lendemain sur les ondes de la BBC "radio Londres" le fameux Appel du 18 juin 1940 ... Le 23 juin, sera voté, à la demande du maréchal Pétain, un décret rétrogradant le général de Gaulle au rang de colonel et le mettant à la retraite d’office par mesure disciplinaire.
 A peine arrivé à Bordeaux, le Gouvernement français envisage de s'installer à Alger. Le Conseil des ministres du 18 juin décide que le président Lebrun, accompagné d'une partie des ministres et des présidents des deux chambres, doit s'embarquer à Port-Vendres, tandis que le paquebot Massilia sera mis à la disposition des parlementaires au départ de Bordeaux. Sous l'influence de Laval, la décision n'est pas exécutée et le 20 juin 1940, 27 parlementaires seulement - dont Édouard Daladier, Georges Mandel arrêté le 17 juin et accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat puis relaché, Jean Zay, Pierre Mendès France – appareillent du Verdon à bord du Massilia pour Casablanca, sous les insultes de l’équipage.
A peine arrivé à Bordeaux, le Gouvernement français envisage de s'installer à Alger. Le Conseil des ministres du 18 juin décide que le président Lebrun, accompagné d'une partie des ministres et des présidents des deux chambres, doit s'embarquer à Port-Vendres, tandis que le paquebot Massilia sera mis à la disposition des parlementaires au départ de Bordeaux. Sous l'influence de Laval, la décision n'est pas exécutée et le 20 juin 1940, 27 parlementaires seulement - dont Édouard Daladier, Georges Mandel arrêté le 17 juin et accusé d’avoir fomenté un coup d’Etat puis relaché, Jean Zay, Pierre Mendès France – appareillent du Verdon à bord du Massilia pour Casablanca, sous les insultes de l’équipage.
 Dans la nuit du 19 au 20 juin, aux alentours de minuit, douze bombardiers Heinkels He-111 du IV Fliegerkorps, basé à Dinard, font leur apparition au dessus de Bordeaux, larguant au hasard 61 bombes (88 au total dans l’agglomération), causant de nombreux dégâts matériels et humains : 185 blessés et 68 morts, dont certains, dans le quartier Saint Michel, noyés par la rupture de canalisations. Dans la nuit du 14 au 15 juin, des avions allemands avaient bien survolé Bordeaux, mais nul n’avait imaginé un bombardement !!!
Dans la nuit du 19 au 20 juin, aux alentours de minuit, douze bombardiers Heinkels He-111 du IV Fliegerkorps, basé à Dinard, font leur apparition au dessus de Bordeaux, larguant au hasard 61 bombes (88 au total dans l’agglomération), causant de nombreux dégâts matériels et humains : 185 blessés et 68 morts, dont certains, dans le quartier Saint Michel, noyés par la rupture de canalisations. Dans la nuit du 14 au 15 juin, des avions allemands avaient bien survolé Bordeaux, mais nul n’avait imaginé un bombardement !!!
Le 22 juin 1940, alors que le gouvernement français est toujours installé à Bordeaux, la France signe l'Armistice. Le IIIe Reich met en place toute une série de mesures pour limiter la circulation des personnes et instaure la ligne de démarcation.
 Le 10 juin 1940, Georges Mandel, ministre de l’Intérieur et ancien député de la Gironde, avait ordonné l’évacuation vers le sud de la population des prisons du Cherche-Midi et de la Santé. 1 865 détenus sont d'abord transférés à Bordeaux au Fort du Hâ ; 306 viennent du Cherche-Midi, 1 559 de la Santé. La plupart sont en attente de jugement devant les tribunaux militaires de Paris, déserteurs, insoumis, militaires détenus pour motifs de droit commun et politiques ... Le 21 juin 1940, au terme d’un exode éprouvant d’une dizaine de jours, 1020 des 1865 détenus parviennent au camp de Gurs, dans les Pyrénées Atlantiques. En route, des prisonniers épuisés ont été abattus, d'autres ont réussi à s'évader. Parmi eux, Henri Chamberlin dit Henri Lafont, qui deviendra chef de la gestapo à Paris, au 93 rue Lauriston
Le 10 juin 1940, Georges Mandel, ministre de l’Intérieur et ancien député de la Gironde, avait ordonné l’évacuation vers le sud de la population des prisons du Cherche-Midi et de la Santé. 1 865 détenus sont d'abord transférés à Bordeaux au Fort du Hâ ; 306 viennent du Cherche-Midi, 1 559 de la Santé. La plupart sont en attente de jugement devant les tribunaux militaires de Paris, déserteurs, insoumis, militaires détenus pour motifs de droit commun et politiques ... Le 21 juin 1940, au terme d’un exode éprouvant d’une dizaine de jours, 1020 des 1865 détenus parviennent au camp de Gurs, dans les Pyrénées Atlantiques. En route, des prisonniers épuisés ont été abattus, d'autres ont réussi à s'évader. Parmi eux, Henri Chamberlin dit Henri Lafont, qui deviendra chef de la gestapo à Paris, au 93 rue Lauriston
C'est à la prison militaire de Bordeaux, la caserne Boudet, à l’angle de la rue de Pessac et de la rue des Treuils, que sont remis, le 20 juin, dix hommes de ce convoi, condamnés à mort pour trahison par le 3e Tribunal militaire de Paris et dont la grâce a été refusée quelques jours plus tôt par le président de la République Albert Lebrun : Jean Amourelle (33 ans, espionnage), Jacques Ferréa (espionnage), Léon Lebeau (34 ans, sabotage), Maurice Lebeau (17 ans, sabotage), Charles Masson (44 ans, trahison), Marcel Rambaud (23 ans, sabotage), Roger Rambaud (17 ans, sabotage), René Spieth (24 ans, espionnage), Raymond Verdaguer (28 ans, espionnage) et Otto Weil (29 ans, espionnage).
Jean Amourelle, secrétaire sténographe au Sénat et membre du Parti socialiste (SFIO), a été convaincu d'espionnage pour avoir reçu 400 000 francs des agents nazis en échange des délibérations secrètes de la commission des affaires militaires du Sénat pour financer un journal qu’il avait le projet de fonder, "La Carmagnole". Roger Rambaud travaille comme ajusteur aux usines d’aviation Farman, à Boulogne-Billancourt. Son frère aîné est militaire au 503e régiment de chars de combat à Versailles tandis que Léon Lebeau appartient au 3e régiment de génie. Ils sont tous trois communistes et ont été reconnus coupables de sabotage d'avions de guerre. Roger Rambaud a sectionné, sur les conseils de son frère et de Léon Lebeau, des fils de laiton dans le but de favoriser l'explosion en vol des appareils. Tous les quatre sont "remis au commissaire du Gouvernement pour être conduit sur le terrain d’exécution".
Le frère de Léon Lebeau, Maurice Lebeau, condamné à mort lui aussi pour "complicité de destruction ou détérioration volontaire d’appareils de navigation aérienne ou toute installation susceptible d’être employée pour la Défense Nationale", voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité par décision présidentielle du 18 juin 1940. Le 23 juin, il est transféré à la prison du Fort du Hâ. Les cinq autres condamnés - Jacques Ferréa, Charles Masson, René Spieth, Raymond Verdaguer et Otto Weil - doivent rejoindre les autres prisonniers au camp de Gurs et seront finalement libérés par les autorités allemandes en gare d’Orthez, pendant leur transfert.
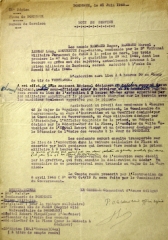 Jean Amourelle, les frères Rambeau et Léon Lebeau sont exécutés le samedi 22 juin, à 5 heures 45, sur le champ de tir de Verthamon, qui jouxte les vignes du célèbre château Haut-Brion, à Pessac. La veille, le commandant de la place d’armes de Bordeaux a donné ses instructions concernant l’exécution, qui doit avoir lieu à 4 heures 30 du matin. Le 181e régiment régional est chargé de la besogne. Le peloton d’exécution se compose "d’un adjudant, un sous-officier armé du révolver [chargé de donner le coup de grâce] et 24 hommes (12 sergents et 12 caporaux)". La note précise aussi : "Assisteront au réveil des condamnés à 3 heures 45 le major de garnison ou son représentant, le commissaire du gouvernement, un juge d’instruction et un greffier désignés par le commissaire du gouvernement, un juge militaire désigné par l’état-major, l’officier comptable de la prison, un médecin désigné par le médecin-chef de la place, l’aumônier du culte catholique de l’hôpital Robert Picqué et un défenseur désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Bordeaux. Les condamnés seront ensuite transportés sur le lieu de l’exécution dans la voiture cellulaire de la place et escortés par huit gendarmes qui devront être rendus à la prison militaire à 3 heures 45." Sans doute craint-on que des communistes fomentent une action pour délivrer leurs camarades emprisonnés puisque la note précise encore : "Le service d’ordre sera assuré par un demi peloton de gardes mobiles qui devra être pour 3 heures 45 au stand de Verthamon.". Un procès-verbal confirme que l’exécution a bien eu lieu à 5 heures 45. Mais Roger Rambaud, exécuté au même âge que Guy Môquet, et ses compagnons ont été oubliés par l'histoire, vraisemblablement parce qu'ils sont tombés sous des balles républicaines et non allemandes..
Jean Amourelle, les frères Rambeau et Léon Lebeau sont exécutés le samedi 22 juin, à 5 heures 45, sur le champ de tir de Verthamon, qui jouxte les vignes du célèbre château Haut-Brion, à Pessac. La veille, le commandant de la place d’armes de Bordeaux a donné ses instructions concernant l’exécution, qui doit avoir lieu à 4 heures 30 du matin. Le 181e régiment régional est chargé de la besogne. Le peloton d’exécution se compose "d’un adjudant, un sous-officier armé du révolver [chargé de donner le coup de grâce] et 24 hommes (12 sergents et 12 caporaux)". La note précise aussi : "Assisteront au réveil des condamnés à 3 heures 45 le major de garnison ou son représentant, le commissaire du gouvernement, un juge d’instruction et un greffier désignés par le commissaire du gouvernement, un juge militaire désigné par l’état-major, l’officier comptable de la prison, un médecin désigné par le médecin-chef de la place, l’aumônier du culte catholique de l’hôpital Robert Picqué et un défenseur désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Bordeaux. Les condamnés seront ensuite transportés sur le lieu de l’exécution dans la voiture cellulaire de la place et escortés par huit gendarmes qui devront être rendus à la prison militaire à 3 heures 45." Sans doute craint-on que des communistes fomentent une action pour délivrer leurs camarades emprisonnés puisque la note précise encore : "Le service d’ordre sera assuré par un demi peloton de gardes mobiles qui devra être pour 3 heures 45 au stand de Verthamon.". Un procès-verbal confirme que l’exécution a bien eu lieu à 5 heures 45. Mais Roger Rambaud, exécuté au même âge que Guy Môquet, et ses compagnons ont été oubliés par l'histoire, vraisemblablement parce qu'ils sont tombés sous des balles républicaines et non allemandes..
 Selon les clauses de l’armistice du 22 juin 1940, la France est coupée en deux par une ligne de démarcation. Pour des impératifs économiques et stratégiques, le littoral atlantique est englobé dans la zone occupée. Ainsi, les Allemands mettent la main sur Bordeaux et son port qui seront occupés le 1er juillet. Le 29 juin 1940, le gouvernement français quitte la ville pour s’installer trois jours plus tard à Vichy, choisie comme capitale de la zone dite "libre". Le 10 juillet, la Chambre des députés et le Sénat y sont réunis en congrès. Ils confèrent les fonctions de chef de l’Etat Français au maréchal Philippe Pétain ainsi que les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs. Pierre Laval est nommé vice-président du Conseil. L’Etat Français, régime autoritaire et paternaliste, dont la devise est "Travail, Famille, Patrie", le programme la "Révolution Nationale", le symbole la "Francisque" et l’hymne "Maréchal, nous voilà !" remplace la Troisième République.
Selon les clauses de l’armistice du 22 juin 1940, la France est coupée en deux par une ligne de démarcation. Pour des impératifs économiques et stratégiques, le littoral atlantique est englobé dans la zone occupée. Ainsi, les Allemands mettent la main sur Bordeaux et son port qui seront occupés le 1er juillet. Le 29 juin 1940, le gouvernement français quitte la ville pour s’installer trois jours plus tard à Vichy, choisie comme capitale de la zone dite "libre". Le 10 juillet, la Chambre des députés et le Sénat y sont réunis en congrès. Ils confèrent les fonctions de chef de l’Etat Français au maréchal Philippe Pétain ainsi que les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs. Pierre Laval est nommé vice-président du Conseil. L’Etat Français, régime autoritaire et paternaliste, dont la devise est "Travail, Famille, Patrie", le programme la "Révolution Nationale", le symbole la "Francisque" et l’hymne "Maréchal, nous voilà !" remplace la Troisième République.
Sources et images :
http://bertrandfavreau.net/bordeaux-juin1940.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_port_de_Bordeaux...
http://www.ajpn.org/commune-1940-33063.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/06/10/sur-les-r...
http://www.editions-perrin.fr/_docs/9782262029647.pdf
http://sousamendes.org/Bordeaux-dans-la-tourmente.html
http://perso.numericable.fr/arts-et-l/arts-loisirs-arlac/...
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/spip.php?article643
http://www.sudouest.fr//2010/06/22/opposes-a-la-guerre-fu...
http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/des-hommes/ces-qua...
http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/actualites/les-fus...
http://www.arkheia-revue.org/Pessac-ces-quatre-fusilles-d...
http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/varia/le-sabotage-...
22:36 Publié dans Bordeaux, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 26 mai 2010
Charles VII et la naissance de l'état moderne
 J'aime les éphémérides, ils sont quelques fois pour moi le point de départ d'un article pour mon blog. Je me dis "tiens, qu'est-il arrivé un 15 mars, ou un 25 juin", et une date m'accroche, je pars dans des recherches historiques ou scientifiques ... j'aime bien le blog "il y a un siècle", et son très jeune frère "il y a trois siècles". L'auteur nous conte des événements d'il y a un siècle de manière vivante et souvent amusante, inventant les situations, mais en respectant le contexte historique, si bien qu'on pourrait croire qu'ils se sont passés réellement . Je n'ai pas ce talent de conteur, mes posts sont plus factuels mais, ne me prenant évidemment pas pour une historienne, je suis plutôt chroniqueuse et "compilateure" de tout ce que je trouve sur internet, en essayant tout de même de trier le vrai du faux dans la mesure de mes moyens ... je savoure ainsi la (re)découverte de notre histoire, y vagabonde parfois tellement que je dépasse allègrement la date en question, ce qui m'oblige à remettre à plus tard l'édition de ma note ...
J'aime les éphémérides, ils sont quelques fois pour moi le point de départ d'un article pour mon blog. Je me dis "tiens, qu'est-il arrivé un 15 mars, ou un 25 juin", et une date m'accroche, je pars dans des recherches historiques ou scientifiques ... j'aime bien le blog "il y a un siècle", et son très jeune frère "il y a trois siècles". L'auteur nous conte des événements d'il y a un siècle de manière vivante et souvent amusante, inventant les situations, mais en respectant le contexte historique, si bien qu'on pourrait croire qu'ils se sont passés réellement . Je n'ai pas ce talent de conteur, mes posts sont plus factuels mais, ne me prenant évidemment pas pour une historienne, je suis plutôt chroniqueuse et "compilateure" de tout ce que je trouve sur internet, en essayant tout de même de trier le vrai du faux dans la mesure de mes moyens ... je savoure ainsi la (re)découverte de notre histoire, y vagabonde parfois tellement que je dépasse allègrement la date en question, ce qui m'oblige à remettre à plus tard l'édition de ma note ...
Le Moyen Age est ma période préférée, sans doute parce que je peux coupler ces recherches avec celles concernant un autre de mes hobbys, l'enluminure. Cette fois ci, le hasard m'a fait (re)découvrir combien notre organisation politique et économique devait à cette période.
 Onzième des douze enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et troisième à porter ce prénom, Charles devient dauphin à la suite de la mort prématurée de ses deux frères aînés, Louis de France en 1413 et Jean, duc de Touraine, mort en 1417. En 1418, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l'héritier de la couronne doit quitter Paris, aux mains des Bourguignons, et se réfugie à Bourges où il prend le titre de régent, suite à la démence du souverain.
Onzième des douze enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et troisième à porter ce prénom, Charles devient dauphin à la suite de la mort prématurée de ses deux frères aînés, Louis de France en 1413 et Jean, duc de Touraine, mort en 1417. En 1418, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l'héritier de la couronne doit quitter Paris, aux mains des Bourguignons, et se réfugie à Bourges où il prend le titre de régent, suite à la démence du souverain.
Henri V d'Angleterre, profitant de la folie du roi Charles VI de France et de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, relance la guerre de Cent Ans, remporte la bataille d'Azincourt en 1415, s'empare de la Normandie et installe son gouvernement au château de Rouen le 19 janvier 1419. À cette date, seul le Mont-Saint-Michel tient bon ! Les Anglais peuvent prendre Paris en 1419. Il s'allie alors avec le jeune duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui avait à venger le meurtre de son père Jean sans Peur par les partisans du dauphin à Montereau (10 septembre 1419) et avec la reine Isabeau de Bavière, et il obtient la couronne de France au traité de Troyes en 1420, à condition d'épouser Catherine de Valois, fille du roi de France, avec en dot l'Aquitaine et la Normandie, héritage d'Aliénor d'Aquitaine et de Guillaume le Conquérant confisqué petit à petit par la monarchie capétienne. Charles VI conserve néanmoins le titre de roi et son fils gouverne en qualité de régent les États qui lui restent.
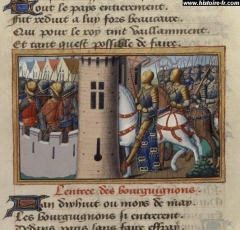


Cependant Paris est toujours occupé par les Anglais. Les notables se concertent pour mettre fin à la domination étrangère et ouvrent clandestinement les portes au connétable de Richemond qui reprend possession de la ville en 1436. Les Anglais sont alors inexorablement et progressivement repoussés. En 1453, ils ne contrôlent plus sur le continent que Calais, et les droits d'Henri VI sur le trône de France sont révoqués, Charles VII est donc rétabli sur le trône. Mais pour pouvoir bouter définitivement les Anglais hors de France, le roi doit disposer d'une armée mais pour cela il a besoin d'argent !
L'impôt et l'armée régulière ...
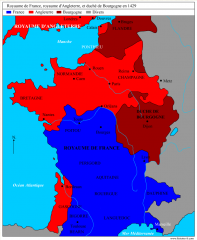 Déjà les "Etats" de 1435 ont admis que l'ancienne pratique "le roi vit du sien" n'est plus entièrement applicable en France face à la poussée des dépenses. Les revenus fournis par le domaine royal ne permettent plus au roi d'assumer les dépenses du royaume. Les Etats décident d'attribuer au roi les rentrées fiscales d'un impôt de consommation perçu sur les marchandises mises en vente : les aides. Parallèlement, la décision d'affranchir les clercs du paiement de cet impôt augmente les libertés, franchises et privilèges ceux-ci et renforce la cohésion de l'"ordre" du clergé. Les Etats de 1435 se plaignent par ailleurs des gens de guerre qui "continuellement s'arment et poursuivent les armes", ces "gens de guerre" étant souvent confondus avec l'"ordre" de la noblesse.
Déjà les "Etats" de 1435 ont admis que l'ancienne pratique "le roi vit du sien" n'est plus entièrement applicable en France face à la poussée des dépenses. Les revenus fournis par le domaine royal ne permettent plus au roi d'assumer les dépenses du royaume. Les Etats décident d'attribuer au roi les rentrées fiscales d'un impôt de consommation perçu sur les marchandises mises en vente : les aides. Parallèlement, la décision d'affranchir les clercs du paiement de cet impôt augmente les libertés, franchises et privilèges ceux-ci et renforce la cohésion de l'"ordre" du clergé. Les Etats de 1435 se plaignent par ailleurs des gens de guerre qui "continuellement s'arment et poursuivent les armes", ces "gens de guerre" étant souvent confondus avec l'"ordre" de la noblesse.
Car pour faire la guerre, le roi est obligé de faire appel à ses vassaux pour réunir l'Ost (coutume féodale du ban). Mais les vassaux ne sont tenus à répondre à l'appel que pendant 40 jours. Au delà, le roi doit recruter des compagnies de mercenaires. Lors des périodes de paix ou de trêve, ces mercenaires sans emploi se regroupent en bandes et vivent de pillages et de rançons. C'est ce qui s'était passé au début de la guerre de Cent Ans, après les victoires de Charles V et Du Guesclin, et se passe de nouveau après le traité d'Arras de 1435. Certaines de ces bandes, qui peuvent compter plusieurs milliers de membres, sont appelées les Écorcheurs. Elles sont souvent menées par des chefs qui ont servi Charles VII. Parmi les Écorcheurs les plus célèbres, on peut citer La Hire, Antoine de Chabannes, Jean Poton de Xaintrailles ou Rodrigue de Villandrando. Ces bandes mettent à mal les campagnes françaises, pillant, violant, brûlant et tuant et, selon les chroniques du temps, commettant des "abominations telles que les Sarrasins ne font pas aux Chrétiens".
Charles VII décide donc de poursuivre l'offensive avec une armée régulière, permettant d'assurer un engagement de longue durée aux anciens mercenaires. Il obtient progressivement des états de la langue d'Oïl puis d'Oc la possibilité de reconduire les "aides" sans réunir les états annuellement : c'est l'instauration de la permanence de l'impôt prélevé dans chaque famille du royaume.
Le 2 novembre 1439, les "Etats", réunis à Orléans, l'autorisent à lever régulièrement, chaque année, l'impôt pour la "taille des lances" (on parlera plus tard de la "taille" tout simplement). Le clergé et la noblesse en sont dispensés. Tirant parti de ces ressources financières régulières, le roi va pouvoir remplacer les mercenaires par une armée régulière. Dans ses Vigiles de Charles VII (écrites en 1439) Martial d'Auvergne écrit: "L'an mil quatre cent trente neuf / Le feu roi si fit les gens d'armes / Vêtir et habiller de neuf, / Car lors étoient en pauvres termes. / Les uns avoient habits usés / Allant par pièces et lambeaux / Et les autres tout déchirés / Ayant bon besoin de nouveau. / Si les monta et artilla, / Le feu roi selon son désir, / Et grandement les rhabilla / Car en cela prenoit plaisir."
Désormais nul ne peut être capitaine de gens d'armes sans avoir été nommé par le roi. Tous ceux qui étaient atteints par ces mesures, princes et seigneurs qui y voient, non sans raison, un risque pour leurs privilèges féodaux, chefs de bandes, ... cherchent aussitôt à en empêcher l'exécution, et dès lors "se machina une praguerie". Ce mouvement, appelé Praguerie parce qu'il coïncidait avec une manifestation analogue en Bohême, réunit plusieurs seigneurs de haut rang, comme le duc Charles I° de Bourbon, le comte de Dunois, le duc Jean II d'Alençon, le grand chambellan et ancien "favori" Georges de La Trémoïlle, et les capitaines de routiers, comme Antoine de Chabannes, etc. Il entraîna même le dauphin Louis, alors âgé de seize ans, dont l'ambition précoce commençaient à s'éveiller. Il est rapidement maté par le Connétable de Richemont.
 Par une ordonnance en date du 26 mai 1445, à Louppy-le-Châtel (près de Bar-le-Duc), le roi Charles VII crée les Compagnies de l'ordonnance ou compagnies d'ordonnance. Cette nouvelle formation militaire, constituée avec les éléments les plus présentables des bandes d'écorcheurs, devient la première armée permanente à la disposition du roi de France. Chaque compagnie est commandée par un capitaine nommé par le roi et comprend cent lances garnies, une lance garnie comprenant six hommes : un homme d'armes en armure, trois archers, un coutilier et un page. Cent lances forment une compagnie. Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. En 1448, Charles VII crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé de la taille d'où son nom de "franc-archer". Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. À l'image de l'Angleterre, la France se constitue ainsi une infanterie d'environ 8 000 francs-archers.
Par une ordonnance en date du 26 mai 1445, à Louppy-le-Châtel (près de Bar-le-Duc), le roi Charles VII crée les Compagnies de l'ordonnance ou compagnies d'ordonnance. Cette nouvelle formation militaire, constituée avec les éléments les plus présentables des bandes d'écorcheurs, devient la première armée permanente à la disposition du roi de France. Chaque compagnie est commandée par un capitaine nommé par le roi et comprend cent lances garnies, une lance garnie comprenant six hommes : un homme d'armes en armure, trois archers, un coutilier et un page. Cent lances forment une compagnie. Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. En 1448, Charles VII crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé de la taille d'où son nom de "franc-archer". Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. À l'image de l'Angleterre, la France se constitue ainsi une infanterie d'environ 8 000 francs-archers.

La genèse de l'état moderne ...
Les Etats de 1439 et l'ordonnance du 26 mai 1445 jouent donc un rôle important dans la création de la France monarchique : ils définissent rigoureusement le droit de lever des armées et l'attribuent exclusivement au roi. Le droit de guerre ou de paix et le pouvoir de négocier avec les puissances étrangères deviennent un des attributs essentiels de la souveraineté en France. Après le droit de justice acquis sous les capétiens, avec la Curia regis , haute juridiction royale dérivée du conseil des vassaux, et les officiers royaux -baillis et sénéchaux - chargés de rendre et de contrôler la justice et créés par Philippe Auguste, après le monopole de battre la monnaie depuis Philippe de Valois par une ordonnance du 16 janvier 1346 déclarant "A nous et à notre majesté royale appartient seulement pour le tout, en notre royaume, le métier, le fait, la provision, et toute l'ordonnance de monnaie, et de faire monnoyer telles monnaie, et donner tel cours, pour tel prix, comme il nous plaît et comme bon nous semble" , confirmée par l'ordonnance du 20 mars 1381 "A nous seul, et pour le tout, de notre droit royal, par tout notre royaume, appartient de faire telles monnaies, comme il nous plaît, et de leur donner prix", c'est l'ensemble des droits régaliens qui sont ainsi clairement définis dans le royaume : Le souverain est seul justicier, seul homme de guerre, seul monnayeur ...
La cristallisation de la souveraineté nationale en la personne du Roi de France va s'accompagner, au cours du XVème et XVIème siècle, du développement des organisations permettant l'exercice de cette souveraineté, ancêtres de nos Services Publics ... L'administration centrale et territoriale se spécialise, se professionnalise et se hiérarchise. A la fin du Moyen Age, il existe un milieu d'officiers, distinct des seigneurs et des notables urbains, qui compose ces administrations : La Chancellerie, responsable de l'administration écrite, de la diplomatie, La Trésorerie, la cour des comptes qui contrôle la bonne gestion des comptes fiscaux et le parlement : C'est parmi les parlementaires que l'on remarque un milieu social autonome. En même temps se met en place une administration territoriale : Baillis, Sénéchaux, Receveur et Elus ... Les officiers prennent de plus en plus de pouvoir ; la carrière administrative est prometteuse.
 Sur le plan juridique, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser. Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans le 125ème article de l'ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts : "nous, voulant abréger les procès et litiges d'entre nos sujets et les relever de mise et dépends, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se pourra, et ôter toutes manières de variations et contrariétés, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous pays de notre royaume soient rédigés et mis en écrits (...) prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu'ils n'allèguent, ne proposent autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrété comme dit est"
Sur le plan juridique, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser. Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans le 125ème article de l'ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts : "nous, voulant abréger les procès et litiges d'entre nos sujets et les relever de mise et dépends, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se pourra, et ôter toutes manières de variations et contrariétés, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous pays de notre royaume soient rédigés et mis en écrits (...) prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu'ils n'allèguent, ne proposent autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrété comme dit est"
Mais cette ordonnance est mal conçue : le projet de rédaction de chaque bailliage doit en effet être renvoyé au roi, lequel doit consulter le Parlement avant promulgation. L'expérience montre que le Parlement, débordé de réclamations, ne peut faire face. Charles VIII de France repensera donc le système dans l'ordonnance de Moulin du 2 septembre 1497 : dans chacun des bailliages, ce sont désormais des commissaires délégués, issus du Parlement, qui rédigent le projet élaboré par le bailli assisté des notables. En conséquence les coutumes d'application géographique restreinte disparaissent, et les différences entre coutumes, désormais aisément identifiables, se trouvent mises en pleine lumière. Dans un souci d'harmonisation, la monarchie décide donc la "réformation" des coutumes. Ce travail juridique permet au roi d'évincer progressivement le droit romain, et de le remplacer par un droit royal français.
 La crise du Grand Schisme d'Occident (1378-1417) est également favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle de 1431, fournit l'occasion d'assurer cette autorité. Auparavant les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes. Charles VII fait examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publie, amendés, en une "Pragmatique Sanction de Bourges", ordonnance promulguée le 7 juillet 1438 avec l'accord du clergé. Elle donne son autonomie à l'Eglise de France face à la papauté et à la curie romaine. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France et surtout comme "première personne ecclésiastique du royaume". Son texte réserve à l'Église gallicane (c'est-à-dire française) tout ce qui relève de l'administration en laissant au pape ce qui relève de la foi. On peut admettre que cette "Pragmatique sanction" marque une étape importante dans le passage de la "Respublica christiana" - état de droit canon transcendant les divers Etats temporels, de droit civil et purement humain - à une conception moins exclusivement religieuse du monde, début d'un processus de laïcisation ... Ces idées que le "Prince" doit pouvoir disposer d'une force propre et de compétences militaires et que l'état laïc doit contrôler l'Église, Machiavel les théorisera quelques dizaines d'années plus tard dans "Le Prince" ...
La crise du Grand Schisme d'Occident (1378-1417) est également favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle de 1431, fournit l'occasion d'assurer cette autorité. Auparavant les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes. Charles VII fait examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publie, amendés, en une "Pragmatique Sanction de Bourges", ordonnance promulguée le 7 juillet 1438 avec l'accord du clergé. Elle donne son autonomie à l'Eglise de France face à la papauté et à la curie romaine. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France et surtout comme "première personne ecclésiastique du royaume". Son texte réserve à l'Église gallicane (c'est-à-dire française) tout ce qui relève de l'administration en laissant au pape ce qui relève de la foi. On peut admettre que cette "Pragmatique sanction" marque une étape importante dans le passage de la "Respublica christiana" - état de droit canon transcendant les divers Etats temporels, de droit civil et purement humain - à une conception moins exclusivement religieuse du monde, début d'un processus de laïcisation ... Ces idées que le "Prince" doit pouvoir disposer d'une force propre et de compétences militaires et que l'état laïc doit contrôler l'Église, Machiavel les théorisera quelques dizaines d'années plus tard dans "Le Prince" ...
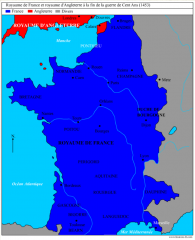 Son fils Louis XI transformera ce pays dépeuplé en un État de grande puissance. Il crée les parlements de Bordeaux et de Dijon, il encourage le commerce et facilite l'accès de la France aux négociants étrangers, il améliore les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres), il favorise l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondent, à Tours, les premières manufactures de soieries. Mais surtout il posera les bases d'une unité territoriale et administrative aux dépends des pouvoirs locaux. En 1482, Louis XI parvient à récupérer la Picardie et la Bourgogne par le traité d'Arras. Par le jeu d'héritages, dont celui de René Ier d'Anjou, il entre en possession du Maine et de la Provence. L'unité du pays est rétablie, les frontières ne sont pas tout à fait celles de la France actuelle mais elles s'en rapprochent. En 1483, pour la première fois, la représentation des trois ordres est organisée pour l'ensemble du royaume et les Etats de langue d'Oïl et ceux de langue d'Oc forment les Etats Généraux. Plus tard, la progression du français dans les élites sociales puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 instituant le français comme la langue des documents administratifs, montreront que les conseils du roi ont compris que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume.
Son fils Louis XI transformera ce pays dépeuplé en un État de grande puissance. Il crée les parlements de Bordeaux et de Dijon, il encourage le commerce et facilite l'accès de la France aux négociants étrangers, il améliore les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres), il favorise l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondent, à Tours, les premières manufactures de soieries. Mais surtout il posera les bases d'une unité territoriale et administrative aux dépends des pouvoirs locaux. En 1482, Louis XI parvient à récupérer la Picardie et la Bourgogne par le traité d'Arras. Par le jeu d'héritages, dont celui de René Ier d'Anjou, il entre en possession du Maine et de la Provence. L'unité du pays est rétablie, les frontières ne sont pas tout à fait celles de la France actuelle mais elles s'en rapprochent. En 1483, pour la première fois, la représentation des trois ordres est organisée pour l'ensemble du royaume et les Etats de langue d'Oïl et ceux de langue d'Oc forment les Etats Généraux. Plus tard, la progression du français dans les élites sociales puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 instituant le français comme la langue des documents administratifs, montreront que les conseils du roi ont compris que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume.
00:32 Publié dans enluminures, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 21 mai 2010
21 Mai 1910 : le prix du champagne !
 Il y a 100 ans, pour avoir effectué un vol d'une quarantaine de minutes entre Calais et le Royaume-Uni le 21 Mai 1910, le français Jacques de Lesseps gagne le prix de 12 500 francs-or (ce qui ferait aujourd'hui un peu moins de 40 000 €) créé le 15 novembre 1906 par André Ruinart de Brimont, pour récompenser une traversée de la Manche par « un appareil plus lourd que l'air, se mouvant par les seuls moyens de propulsion du bord ». Ce prix est complété par la prime de 100 £ offerte par le Daily Mail pour le second vol au dessus de la Manche.
Il y a 100 ans, pour avoir effectué un vol d'une quarantaine de minutes entre Calais et le Royaume-Uni le 21 Mai 1910, le français Jacques de Lesseps gagne le prix de 12 500 francs-or (ce qui ferait aujourd'hui un peu moins de 40 000 €) créé le 15 novembre 1906 par André Ruinart de Brimont, pour récompenser une traversée de la Manche par « un appareil plus lourd que l'air, se mouvant par les seuls moyens de propulsion du bord ». Ce prix est complété par la prime de 100 £ offerte par le Daily Mail pour le second vol au dessus de la Manche.
Louis Blériot pouvait bien entendu remporter également ce trophée lors de sa traversée de juillet 1909 mais il avait alors choisit de concourir exclusivement pour le prix du Daily Mail dont le montant était plus important encore.
Fils de l'illustre ingénieur Ferdinand de Lesseps, auquel on doit le percement du canal de Suez, Jacques de Lesseps est né à Paris, le 5 juillet 1883. Avec ses frères Bertrand, Paul et Robert, il se passionne pour l'aviation et décide d'apprendre à piloter au lendemain de l'inoubliable exploit de Blériot joignant le 25 juillet 1909 la France et l'Angleterre.
Pour former ses clients, Blériot a installé en hâte à Buc (Yvelines) une école de pilotage avant de monter des écoles plus importantes et mieux dotées en matériel à Issy-les-Moulineaux, Pau et Étampes. Certains de ses clients portent des noms célèbres, d'autres noms, inconnus, vont bientôt le devenir par leurs exploits. Jacques de Lesseps est le plus assidu de la petite école de pilotage, installée sur le champ de manoeuvres d'Issy-les-Moulineaux, sur un monoplan que Louis Blériot mettait à la disposition de quelques fanas.
Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l'aviation un brevet de pilote. Personne n'osant faire passer un examen à ces pionniers et pour éviter tous débats, il est décidé d'attribuer ces premiers brevets par ordre alphabétique, empêchant ainsi toute espèce de prééminence entre les 16 premiers brevetés. Le N°1 échoit ainsi à Louis Blériot et le dernier à Wilbur Wright. Deux numéros « bis » (5 et 10) et pas de numéro 13 ... La réglementation du brevet de pilote entre en vigueur le 1er janvier 1910 et Jacques de Lesseps l'obtient dès le 6 janvier 1910 avec le N° 26, après quelques séances d'entraînement en réalisant un vol de 1 h 50 sans toucher le sol. À Issy, Jacques de Lesseps se perfectionne par un entraînement assidu et il participe aux nombreuses compétitions et conférences sur le développement de l'aviation un peu partout dans le monde.

Après l'exploit de Louis Blériot d'avoir franchi la Manche, restait un prix en compétition offert par la marque de champagne Ruinart à celui qui traverserait le détroit un samedi ou un dimanche. Comme Louis Blériot 10 mois auparavant, Jacques de Lesseps décolle du lieu dit Les Baraques, près de Calais, le 21 mai 1910 en début d'après midi, à bord de son Blériot XI à moteur Gnome-et-Rhône de 50 cv, baptisé « Scarabée ». Quelques jours auparavant, son départ est retardé à cause du décès du roi Edouard VII d'Angleterre. À 15 h 50, l'appareil s'envole, prend de la hauteur, à 400 ou 500 mètres d'altitude, puis pique vers le large escorté par le contre-torpilleur Escopette. Trois-quarts d'heure après, il se pose sans encombre à proximité de la ferme de Wonston Court, à Sainte Margaret Bay, au Nord-Est de Douvres. Il est le second aviateur qui ait réussi la traversée de la Manche !

Jacques de Lesseps aurait souhaité rentrer en France avec son avion, mais la brume s'étant épaissie, il doit renoncer à ce projet et rejoint Calais le soir en steamer, où un banquet lui est offert. Le capitaine de frégate Prat, commandant la station des sous-marins de Calais, qui allait trouver la mort le 26 mai dans les flancs du "Pluviôse", prend la parole au dessert. Mais Jacques de Lesseps ne recevra pas autant d'honneurs que son prédécesseur Louis Blériot, la France ayant décrété un deuil national en mémoire des vingt-sept victimes du naufrage.
La traversée de la Manche ayant été réalisée à deux reprises, la Maison de Champagne Ruinart offre alors immédiatement un nouveau Prix pour le pilote qui réalisera le 1er aller-retour entre la France et l'Angleterre. Il sera remportée dans les jours qui suivirent, le 2 juin 1910, par l'anglais Charles Stewart Rolls, créateur de la célèbre firme automobile du même nom. " Les exploits des aviateurs se suivent et se surpassent, et l'on doit vraisemblablement s'attendre, après leurs derniers triomphes, à la prochaine réalisation de tous les rêves d'Icare. C'est pourquoi, si l'on admire toujours, on ne s'étonne presque plus" écrit la presse.
Héros, Jacques de Lesseps devait l'être également pendant la Première Guerre mondiale. Chef d'escadrille, il sert sur le front comme pilote de bombardier et de reconnaissance aérienne. Il effectue 95 missions de bombardement et défend Paris contre les Zeppelins allemands. Il est cité quatre fois à l'ordre du jour de l'armée française et est fait chevalier de la Légion d'honneur. La France lui décernera aussi la Croix de Guerre et le gouvernement américain lui attribuera la Distinguished Service Cross.
La paix revenue, il part au Canada, où il devient directeur technique de la compagnie aérienne Française-Canadienne (CAFC), qui se spécialise dans la rédaction de cartes géographiques à partir de photos aériennes. En 1926 et 1927, il est chargé par Honoré Mercier, ministre des Terres et Forêts du Québec, de réaliser un relevé cartographique de la Gaspésie depuis les airs. Cette technique s'avère beaucoup plus efficace que les relevés topographiques, difficiles à effectuer dans une région comme la Gaspésie. Pour photographier plus de 80 000 kilomètres carrés de territoire, il utilise 2 hydravions Schreck FBA et installe une hydrobase principale à Gaspé et une hydrobase secondaire à Val-Brillant, sur les rives du lac Matapédia.
Le travail est risqué, il n'y a pas de cabine de pilotage, il n'y a pas les instruments de navigation ni les cartes d'aujourd'hui et le photographe devait accomplir son travail dans des conditions souvent périlleuses, en vent, avec un gros appareil dont le négatif est de 8 pouces par 10 pouces ... S'envolant le 18 octobre 1927, par un après-midi brumeux, de Gaspé à destination de Québec avec son mécanicien Théodore Chichenko, Jacques de Lesseps ne parvient pas à destination. Le pilote et son copilote ont péri au large de Baie-des-Sables. À partir du 20 octobre, d'importants débris de l'avion, sauf le moteur, sont retrouvés sur le rivage et en mer, surtout entre Baie-des-Sables et Sainte-Félicité, 50 kilomètres en aval. Le corps de Jacques de Lesseps est trouvé le 5 décembre, à Port-au-Port, à Terre-Neuve. Celui de Chichenko n'a jamais été revu. Selon ses volontés, de Lesseps a été inhumé à Gaspé le 14 décembre 1927. En 1932, on lui érige un monument dans cette ville.
23:27 Publié dans espace, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 19 mai 2010
Balades dans Paris : la rue Volta
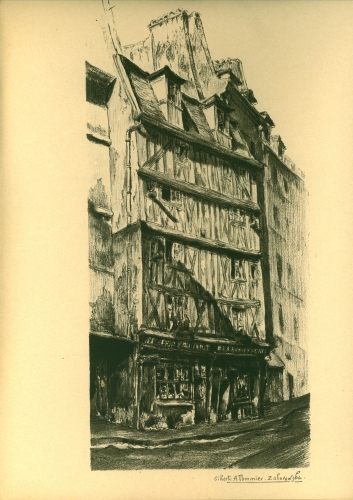 Poursuite de ma promenade dans le Marais, au fil des lithographies de Gilberte A. Pomier-Zaborowska.
Poursuite de ma promenade dans le Marais, au fil des lithographies de Gilberte A. Pomier-Zaborowska.
L'une d'elle concerne une vieille maison de la rue Volta, situé au numéro 3, presque à l'angle de la rue au Maire, point de départ donc de ma balade d'aujourd'hui.
La rue Volta est une rue située dans le quartier du Marais dans le 3e arrondissement de Paris. Elle résulte de la fusion en 1851, de trois rues, sous le nom du physicien italien Alessandro Volta : la rue Frépillon, la rue de la Croix et la rue du Pont-aux-Biches. Elle part de la rue au Maire, qui existait au XIIIème siècle. La rue Frépillon (1269) allait de la rue au Maire à la rue Phélippeaux (Réaumur). La rue de la Croix, du XIVème siècle, allait de la rue Phélippeaux à la rue du Vertbois, et la rue du Pont-aux-Biches (1520) allait de la rue du Vertbois à la rue Notre-Dame-de-Nazareth.
On a longtemps pensé que la maison du n°3, d'allure médiévale, était la plus vieille maison de Paris. En effet, une date repeinte sur la maison faisait remonter cette origine à 1242, et la légende dit que "le garde des chasses de Saint-Louis l'aimait habiter". Il a fallu attendre 1979 pour qu'une historienne dissipe cette légende. Cette maison a été en fait édifiée en 1644 par un bourgeois parisien. C'est une maison en pan de bois ou "en colombage" et à margelle de pierre. La construction de ce type de maisons était en effet interdite au 17ème siècle, mais l'interdiction semble avoir été inopérante. En fait sauf nouvelle surprise, la plus ancienne maison de Paris se trouve non loin de là, celle de Nicolas Flamel au 51 rue de Montmorency (1407).
 Le n°5 possède une porte et des ferrures assez intéressantes.
Le n°5 possède une porte et des ferrures assez intéressantes.
Au n°16, une maison du XVIIème siècle était à l'enseigne du Lion d'Or. Dans le cabaret du rez-de-chaussée de cette maison aurait été préparée l'insurrection du 5 juin 1832, tentative des Républicains de renverser la monarchie de Juillet immortalisée par Victor Hugo dans les Misérables.
Au n°37, on trouve le Théâtre du Marais, dont je reparlerai une autre fois ...
Mais tout d'abord un peu d'histoire ... Avant 1851, une partie de la rue s'appelait "rue Frépillon", du nom d'un village aux confins de la vallée de Montmorency et de la Vallée de l'Oise. On trouve trace de plusieurs seigneurs de Frépillon, et peut être l'un d'eux possédait-il un Hôtel particulier à Paris ? C'est cette explication qu'avance l'abbé Lebeuf en 1755: "Il est assez probable que la rue de Frépillon, à Paris, attenait à l'hôtel qu'habitaient en hiver les suzerains du village".
Selon Jean-Aymar Piganiol de la Force dans Description de la ville de Paris et de ses environs, paru en 1742, "La rue Frepillon avoit nom anciennement, selon Sauval, la rue Ferpillon ou Ferpeillon, et en 1269, vicus Ferpillonis. Elle aboutit à la rue Au-Maire & à celle de la Croix".(pdf ici)
En 1822, J.B De Saint Victor, dans son "tableau historique et pittoresque de Paris depuis les gaulois jusqu'à nos jours" reprend ces explications : "Elle fait la continuation de la rue de la Croix, et aboutit au cul-de-sac de Rome et à la rue au Maire. Elle doit son nom à celui d'une famille qui demeuroit dans cette rue au treizième siècle. Dans un acte de 1269 , elle est nommée vicus Ferpillonis; rue Ferpillon en 1282 ; vicus Ferpillionis dans le terrier de Saint-Martin-des-Champs, de 1300. Depuis ce temps ce nom a été altéré par le peuple ou par les copistes , et l'on a écrit Ferpeillon, Serpillon, Frepillon, Fripilon , etc.
En tous les cas, entre 1256 et 1278, les seigneurs de Frépillon se dessaisissent de leurs propriétés au profit des abbesses de l'abbaye de Maubuisson, dont nous avons vu qu'elles avaient une maison de ville dans la rue des Barres ... est-ce à cette époque qu'ils auraient eux aussi emménagé dans la capitale ?
Le site de l'Association pour la promotion de l'histoire et du patrimoine de la vallée de Montmorency, où se situe cette commune d'environ 2 300 habitants, nous raconte l'histoire de cette rue de Paris, que je retranscris ici :
"Cette voie doit être située dans l'environnement géographique et historique de l'abbaye de Saint-Martin des Champs : "L'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, où, depuis 1798, est établi le Conservatoire des Arts et Métiers, présente encore quelques restes remarquables de l'architecture du Moyen-Âge, échappés, comme par miracle, à toutes les causes de destruction qui ont privé Paris d'un si grand nombre de ses antiques monuments.
L'origine de ce monastère est imparfaitement connue. On sait seulement que, des le commencement du VIIIe siècle, il existait, près des murs de Paris, et probablement sur l'emplacement du Conservatoire, une église dédiée à saint Martin. Elle est qualifiée de basilique dans une charte de Childebert III, datée de l'année 710. Mais ce mot de basilique s'appliquait alors indifféremment à tous les édifices religieux. C'était dans le Moyen-Âge une opinion accréditée, et la pieuse tradition s'est conservée jusqu'à nos jours, que cette église avait été élevée au lieu même où, selon la légende, saint Martin guérit miraculeusement un lépreux, en lui donnant un baiser (...)
Le prieur Hugues, ou Eudes, qui administra le couvent vers le commencement du XIIe siècle, perfectionna ou refit l'enceinte fortifiée. Il enveloppa l'enclos, qui contenait environ quatorze arpents, d'un fossé et d'une muraille crénelée et flanquée de tours. En 1282, une chaussée nouvelle, qui devint la rue Frépillon, entama l'enclos du côté de l'Est, et l'on construisit alors un mur en pierre de taille pour le fermer" (Audiganne, P. Bailly, Eugène Carissan, Paris dans sa splendeur : Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Histoire de Paris. Environs de Paris, Paris, Charpentier, 1861 pages 40 à 42)
Avec le développement du Paris intra muros, le quartier change considérablement de physionomie au XIVe siècle, mais l'abbaye résiste, et la rue Frépillon également :
"Bientôt, une pléthore nouvelle se faisant sentir, les remparts de la Ville furent encore une fois reculés, les portes Saint-Martin et Saint-Denis se trouvèrent reportées en 1356, sous Charles V, à peu près à leur emplacement actuel.
A cette époque l'abbaye était limitée par les rues Saint-Martin à l'ouest, du Gaillard Bois au nord, de la Croix, Frépillon, du Puits de Rome à l'est, et la rue Aumaire au sud".(Amédée Gabillon, Le quartier des Arts et Métiers : conférence historique faite le 20 mai 1911, Paris, 1911, P. Collemant , pp. 22-23)
En 1712, le rempart crénelé apparaît inutile aux religieux : ils l'abattent pour élever à la place des maisons de location.
En mars 1848, trois ans avant sa disparition, la rue Frépillon se signale par la fondation au numéro 24, d'un Club de la Montagne, sous la présidence d'un certain abbé Constant. Voici comment un chroniqueur, manifestement orienté, le présente, dans un ouvrage consacré aux nombreux clubs qui foisonnent à Paris à cette époque :
" Réunion de bas-bleus crottés, de fous socialistes et de démocrates de ruisseau qui siégeaient dans la salle enfumée d'un marchand de vin, devant des tables couvertes de nappes maculées, entre des pots de vin bleu et des pipes culottées. Dans la salle du club de la rue Frépillon, les cinq sens étaient à la fois également blessés : on y buvait du vin détestable et de l'eau-de-vie frelatée, on y respirait les odeurs les plus nauséabondes. Il fallait, une fois qu'on était entré dans ce lupanar démocratique et social, se résigner à entendre des théories et des déclamations contre la société qui auraient trouvé des contradicteurs au bagne de Brest. Les assistants, à quelques rares exceptions près, étaient couverts des ces haillons sordides, qui ne sont pas la livrée de la pauvreté honnête et laborieuse, mais bien celle de la débauche ignoble.
Nous avons entendu le citoyen abbé Constant prononcer dans son club ces atroces paroles : "Nous ferons bouillir le sang des aristocrates dans les chaudières de la Révolution et nous en ferons du boudin pour rassasier tes prolétaires affamés."
Ce citoyen Constant a été condamné, le 11 mai 1841, à huit mois de prison et 300 fr. d'amende, pour outrage à la morale publique et atteinte à la propriété ; le 8 février 1847, à un an de prison et 1,000 fr. d'amende pour délits semblables" (Alphonse Lucas, Les clubs et les clubistes : histoire complète critique et anecdotique des clubs et des comités électoraux fondés à Paris depuis la révolution de 1848 : déclarations de principes, règlements, motions et publications des sociétés populaires, Paris, E. Dentu, 1851, page 183)
Un an plus tard, la rue Frépillon s'illustre lors de la manifestation du 13 juin 1849, qui est la dernière "journée révolutionnaire" de la IIe République. Il s'agit, à l'origine, d'une manifestation de protestation contre la politique menée par le gouvernement à Rome, organisée par l'extrême gauche de l'Assemblée Nationale autour de Ledru-Rollin, à savoir "la Montagne", qui compte alors 124 députés. Des barricades sont élevées dans un certain nombre de rues de Paris, dont la rue Frépillon. Une charge de grenadiers enlève la barricade en faisant trois morts parmi les insurgés. L'affaire est relatée à l'Assemblée nationale lors de sa séance du 10 juillet :
"Le Citoyen Sautayra : Dans la rue Frépillon, une barricade avait été élevée derrière le Conservatoire des arts et métiers. Le général Cornemuse la fait attaquer par une compagnie de grenadiers du 21e de ligne. Son commandant, le capitaine Bayard, sans s'inquiéter d'un feu très vif de mousqueterie dirigé contre lui des maisons voisines, lance sa troupe au pas de course, et enlève la barricade, où trois insurgés sont tués. Les autres prennent la fuite.
Je ne puis trop louer l'élan que la compagnie de grenadiers a montré à cette attaque. Le capitaine Bayard mérite aussi les plus grands éloges. Car non seulement il a réussi, mais, par la promptitude de son mouvement, il a su ménager le sang de ses soldats, dont pas un n'a été atteint. »
Permettez-moi de vous faire remarquer une chose, nous l'avons malheureusement vue l'année dernière : c'est que, lorsqu'une barricade est attaquée, il faut verser beaucoup de sang avant d'arriver de l'autre côté...
Citoyen Baraguey d'Hilliers : Lorsqu'elle est défendue !
Le Citoyen Sautayra : Lorsqu'elle est défendue, bien entendu. C'est un lapsus, et je remercie l'honorable général de son observation.
Je ne comprends pas comment on a pu supposer qu'une barricade avait été vaillamment défendue, surtout défendue par les fenêtres des maisons voisines, lorsque pas un des assaillants n'a été atteint, tandis que trois de ceux qui la défendaient ont été tués. Vous le savez, ceux qui sont derrière les barricades ont bien plus d'avantage pour se défendre, que ceux qui sont devant". (Compte rendu des séances de l'Assemblée nationale 1848-1849, séance du 10 juillet 1849, p. 572.)
La rue Frépillon disparaît en 1851 lors des grands travaux du Baron Haussmann : en fusionnant avec les rues de la Croix et du Pont-aux-Biches, elle donne lieu à la rue Volta, du nom du physicien italien Alessandro Volta. Toutefois, jusqu'à une date indéterminée, subsistera un passage Frépillon, donnant dans cette rue. Il s'agit, en fait, de l'ancien passage de la Marmite, qui doit son nom à l'enseigne d'un petit restaurant pour les ouvriers du quartier. Ce passage Frépillon est signalé dans le roman policier d'Emile Gaboriau, Monsieur Lecoq (1861), dans lequel le personnage principal personnage est poursuivi par les gardes et leur échappe de justesse : "Au passage Frépillon, son salut ne tint qu'à un fil".
 Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'ancienne rue de la Croix, mais divers plans du XVIIIème siècle montrent que cette rue longeait le couvent des religieuses du Tiers ordre de saint François dites "Filles de Sainte Elisabeth", qui avaient reçu quelques donations dans ce quartier, près du couvent des Pères de Nazareth, qui étaient du même ordre, et qui furent reconnues par Louis XIII par des lettres-patentes en 1614. Elles ont été établies rue du Temple en 1616 par Marie de Médicis. Celle-ci posa la première pierre de leur église, dédiée à Sainte Elisabeth de Hongrie, et de leur monastère le 14 avril 1628. Les religieuses, qui logeaient alors rue Neuve-Saint-Laurent, dans un hospice prété par les Pères de Nazareth, s'y installèrent en 1630. Les travaux de l'église furent réalisés par l'architecte Louis Noblet jusqu'en 1631, puis par Michel Villedo de 1643 à 1646. Elle fut consacrée le 14 juillet 1646 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. En 1792, l'église est transformée en entrepôt de fourrage sous la Révolution. Elle est rendue au culte en 1802 avec le Concordat. Le monastère servait alors de pensionnat de jeunes filles qui portaient alors un uniforme noir et payaient 500 livres de pension
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'ancienne rue de la Croix, mais divers plans du XVIIIème siècle montrent que cette rue longeait le couvent des religieuses du Tiers ordre de saint François dites "Filles de Sainte Elisabeth", qui avaient reçu quelques donations dans ce quartier, près du couvent des Pères de Nazareth, qui étaient du même ordre, et qui furent reconnues par Louis XIII par des lettres-patentes en 1614. Elles ont été établies rue du Temple en 1616 par Marie de Médicis. Celle-ci posa la première pierre de leur église, dédiée à Sainte Elisabeth de Hongrie, et de leur monastère le 14 avril 1628. Les religieuses, qui logeaient alors rue Neuve-Saint-Laurent, dans un hospice prété par les Pères de Nazareth, s'y installèrent en 1630. Les travaux de l'église furent réalisés par l'architecte Louis Noblet jusqu'en 1631, puis par Michel Villedo de 1643 à 1646. Elle fut consacrée le 14 juillet 1646 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. En 1792, l'église est transformée en entrepôt de fourrage sous la Révolution. Elle est rendue au culte en 1802 avec le Concordat. Le monastère servait alors de pensionnat de jeunes filles qui portaient alors un uniforme noir et payaient 500 livres de pension
Quand à l'ancienne rue du Pont aux Biche, elle doit son nom à un pont sur l'égout qui longeait autrefois la rue Notre-Dame de Nazareth, sans doute l'égout Saint-Martin à ciel ouvert jusqu'en en 1605, et peut être à une enseigne représentant des biches. En effet les égouts sont longtemps à ciel ouvert. Les premiers égouts à fossés ouverts apparaissent au XIVe siècle. Rive droite, le grand égout suit un ancien cours de la Seine, au pied des collines au nord de la ville, cours emprunté un temps par "Ru de Ménilmontant" qui reçoit plusieurs ruisseaux descendants des buttes de Belleville et de Ménilmontant ainsi que les eaux de plusieurs égouts distribués dans les différents quartiers. Il se jette dans la Seine à hauteur du Pont de l'Alma. D'autres égouts descendent également vers la Seine, drainant sa rive nord. Dès 1720, on commencera de paver et voûter la partie du grand égout découvert, et en 1737, commenceront les travaux définitifs pour canaliser et finalement de couvrir l'égout tout entier.
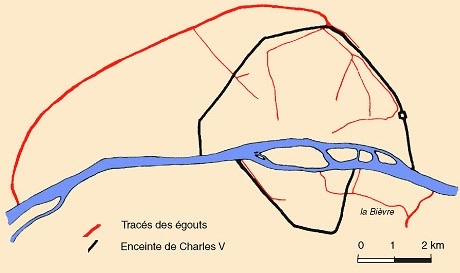
 Une ordonnance du 9 août 1698 nous apprend que des chiffonniers vivaient là, avec jusqu'à 300 chiens, dont les divagations et les aboiements gênent jour et nuit les habitants. En effet, en plus de leur activité de collecte de chiffons et débris divers, les chiffonniers sont souvent aussi écorcheurs de chevaux, de chats et de chiens, avec la graisse desquels ils fabriquent du suif destiné aux "chandeliers - ciriers - huiliers", ou encore du noir animal (ou charbon d'os) utilisé comme engrais ou comme pigment noir. Ils infligent donc aussi au quartier des puanteurs que l'ordonnance qualifie d'"excessives". Une ordonnance du 10 juin 1701 tente vainement de réglementer l'activité des chiffonniers qui sont désormais autorisés à n'avoir qu'un seul chien ! Ordonnance jamais appliquée, puisqu'une sentence du 18 juillet 1727 les condamne car "ils amassent les cuirs des bêtes qu'ils égorgent sans la précaution de les saler, en sorte qu'en peu de jours, les vers s'y mettent, gagnent les maisons voisines et causent des incommodités inexprimables" (source : Essai sur l'ordure en milieu urbain à l'époque pré-industrielle par Pierre-Denis Boudriot)
Une ordonnance du 9 août 1698 nous apprend que des chiffonniers vivaient là, avec jusqu'à 300 chiens, dont les divagations et les aboiements gênent jour et nuit les habitants. En effet, en plus de leur activité de collecte de chiffons et débris divers, les chiffonniers sont souvent aussi écorcheurs de chevaux, de chats et de chiens, avec la graisse desquels ils fabriquent du suif destiné aux "chandeliers - ciriers - huiliers", ou encore du noir animal (ou charbon d'os) utilisé comme engrais ou comme pigment noir. Ils infligent donc aussi au quartier des puanteurs que l'ordonnance qualifie d'"excessives". Une ordonnance du 10 juin 1701 tente vainement de réglementer l'activité des chiffonniers qui sont désormais autorisés à n'avoir qu'un seul chien ! Ordonnance jamais appliquée, puisqu'une sentence du 18 juillet 1727 les condamne car "ils amassent les cuirs des bêtes qu'ils égorgent sans la précaution de les saler, en sorte qu'en peu de jours, les vers s'y mettent, gagnent les maisons voisines et causent des incommodités inexprimables" (source : Essai sur l'ordure en milieu urbain à l'époque pré-industrielle par Pierre-Denis Boudriot)
Plus tard ces "biffins" se regrouperont dans la "zone", no man's land inconstructible, de 300 mètres de large qui entoure Paris au-delà des fortifications de Thiers laissées à l'abandon. C'est à cette zone que Eugène Atget, photographe infatigable de Paris, s'est intéressé à la zone au tournant du XXème siècle.
Le ..atalagueille
J'achepte vieur fer : vieur drapeaur
Aussi la mesnagere sage
En ramassant petis lambeaur
Fait tout servir a son mesnage.
Cris de Paris, vers 1500.
01:03 Publié dans balade, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 14 mai 2010
Balades dans Paris : la Rue des Barres et la rue du Grenier sur l'eau
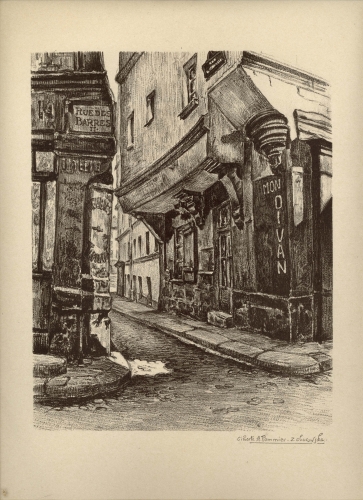 Commençons notre balade par l'un des endroits les plus romantiques du Marais et de Paris, les rues des Barres et Grenier sur l'eau !
Commençons notre balade par l'un des endroits les plus romantiques du Marais et de Paris, les rues des Barres et Grenier sur l'eau !
Pourquoi les "Barres" ? Une des premières possessions du Temple dans la capitale fut un moulin situé sous le Grand-Pont, avec une maison au-dessus, que légua à l'Ordre des Templiers une noble dame nommée Genta ou La Gente, moyennant trente livres versés chaque année au chapitre de Notre Dame. L'acte qui constate cet accord ne porte pas de date, mais il parait avoir été rédigé avant 1170, plutôt e 1137 ou 1147. Un peu plus tard, les Templiers possédaient également trois moulins, appelés "moulins des Barres"ou encore "moulins de Grève, "moulins assis sous Saint-Gervais", sur lesquels ils prélevaient les droits de mouture et droits de fournage.
En 1252, les templiers possédaient aussi une grange aux Barres", on en voit mention dès 1233, "granchia Templi de Barris, in censiva Templi". C'est peut-être une dépendance pour les arrivages par la rivière. En 1293, "en la rivière de Seine, au quay du Temple", un accord est passé entre le prévôt de la marchandise de l'eau et les échevins de la ville de Paris d'une part, et les chevaliers du Temple, pour leurs moulins au Pont de Grève. Ils s'engageaient à faire un pont de bois avec autant d'arches qu'il serait jugé nécessaire, et de payer 6 deniers chaque année au parloir aux Bourgeois
 Mais pourquoi ce nom de "barres" ? Ce nom donné à la rue et aux moulins, et peut être aussi aux terrains alentour, pourrait venir de l'enceinte du XIème siècle. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Marquis de Rochegude, dans un ouvrage "Promenades dans toutes les Rues de Paris (origines des rues, maisons historiques ou curieuses, anciens et nouveaux hôtels, enseignes), paru en 1910 Il écrit que le nom vient de ce que des barres étaient placées autrefois sur le sentier jusqu'à sa descente à la Seine par les officiers des Aides (ou "Aydes") et de la gabelle, sans doute pour empêcher les fraudeurs de passer inaperçus.
Mais pourquoi ce nom de "barres" ? Ce nom donné à la rue et aux moulins, et peut être aussi aux terrains alentour, pourrait venir de l'enceinte du XIème siècle. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Marquis de Rochegude, dans un ouvrage "Promenades dans toutes les Rues de Paris (origines des rues, maisons historiques ou curieuses, anciens et nouveaux hôtels, enseignes), paru en 1910 Il écrit que le nom vient de ce que des barres étaient placées autrefois sur le sentier jusqu'à sa descente à la Seine par les officiers des Aides (ou "Aydes") et de la gabelle, sans doute pour empêcher les fraudeurs de passer inaperçus.
 La rue des Barres, qui relie aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville à la rue François Miron, est donc l'ancienne ruelle aux Moulins des Barres, qui descendait d'une petite butte vers les berges verdoyantes de la Seine, vers des moulins situés sur la rivière à cet endroit qu'on appelait donc "les Barres", et elle date de 1250. Cette petite éminence, qu'on appelait anciennement monceau (moncellum), surplombait les marécages, ce qui avait permis aux pêcheurs, mariniers de l'époque gallo-romaine de venir s'installer ici. Dès le IIe siècle, une nécropole avait été construite sur le versant nord du monticule, puis au VIe siècle, les chrétiens, sur le même emplacement, avaient construit une chapelle funéraire dédiée aux martyrs Gervais et Protais, d'où le nom de "monceau Saint Gervais" qui sera donné vers 1680 à tout le quartier. Ce lieu était à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste.
La rue des Barres, qui relie aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville à la rue François Miron, est donc l'ancienne ruelle aux Moulins des Barres, qui descendait d'une petite butte vers les berges verdoyantes de la Seine, vers des moulins situés sur la rivière à cet endroit qu'on appelait donc "les Barres", et elle date de 1250. Cette petite éminence, qu'on appelait anciennement monceau (moncellum), surplombait les marécages, ce qui avait permis aux pêcheurs, mariniers de l'époque gallo-romaine de venir s'installer ici. Dès le IIe siècle, une nécropole avait été construite sur le versant nord du monticule, puis au VIe siècle, les chrétiens, sur le même emplacement, avaient construit une chapelle funéraire dédiée aux martyrs Gervais et Protais, d'où le nom de "monceau Saint Gervais" qui sera donné vers 1680 à tout le quartier. Ce lieu était à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste.
En 1293, la ruelle aux Moulins des Barres devient ruelle des Moulins du Temple. En 1362, on lui donne, dans un titre passé sous le règne de Charles V; la dénomination de rue qui va de la Seine à la porte Baudet et, en 1386, de rue du Chevet de Saint-Gervais, et parfois rue des Barres. Au XVIe siècle, c'était la rue Malivaux; du nom des moulins de Malivaux, placés sur la rivière, en face de cette rue. Mais ce n'était qu'une la partie de la rue qui portait ce nom, celle du côté de la rue Saint Antoine (maintenant rue François-Miron dans cette partie) était confondue avec la rue du Pourtour, alors appelée rue du Cimetière Saint Gervais. Enfin, au XVIIe siècle, dans toute sa longueur, c'était de nouveau la rue des Barres.
Une décision ministérielle, en date du 13 thermidor an VI, signée François de Neufchâteau, fixe la largeur de cette voie publique à 8 m. En vertu d'une ordonnance royale du 19 mai 1838, sa moindre largeur devait être portée à 10 m. Seules quelques maisons ont été "alignées".
 L'Hôtel des Barres fut bâti vers 1269. En 1362, les moines de Saint-Maur l'achetèrent ainsi que les moulins à eau des Barres, qui en dépendaient. Il prit le nom d'Hôtel de Saint-Maur.
L'Hôtel des Barres fut bâti vers 1269. En 1362, les moines de Saint-Maur l'achetèrent ainsi que les moulins à eau des Barres, qui en dépendaient. Il prit le nom d'Hôtel de Saint-Maur.
Cet hôtel fut habité plus tard par Louis de Boisredon, écuyer et amant d'Isabeau de Bavière. Celle-ci distribuait à ses "admirateurs" tout ce que ceux-ci exigeaient, et Louis de Boisredon avait les dents longues ! Cette aventure se termina par un drame : en 1417, le comte d'Armagnac, excédé des bavardages de la Cour et de la ville, révéla au roi Charles VI la conduite de la reine. Après avoir fait appeler le dauphin qui confirma les dires du connétable, le souverain donna l'ordre à Tanneguy Duchâtel, prévôt de Paris, de se saisir du capitaine. Ce dernier fut condamné à mort. On l'enferma dans un sac de cuir sur lequel étaient inscrits ces mots : "Laissez passer la justice du Roi". Le tout fut jeté dans la Seine. Quant à Isabeau, elle ne put échapper à la relégation. Le couvent de Marmoutiers lui servit de résidence surveillée
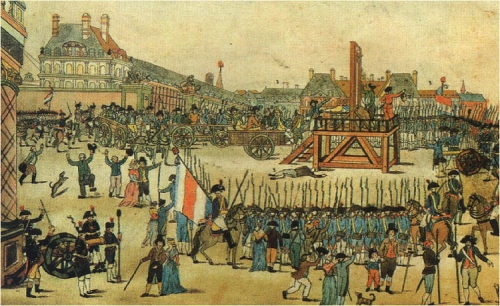 Cet Hôtel devint par la suite propriété des seigneurs de Charni, qui lui donnèrent leur nom (à ne pas confondre cependant avec le Grand et le Petit Hôtel de Charny, dans la rue Beautreillis). On y avait établi, vers la fin du XVIIIème siècle, le bureau de l'administration des aides, avant qu'il ne soit transféré rue de Choiseul juste avant la révilution Dans cet Hôtel de Charni siégeait, en 1793, le Comité civil de la Section de la Commune. C'est là que, le 10 thermidor, à 2heures du matin, Augustin de Robespierre dit Le Jeune, qui venait de se jeter d'une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, fut transporté sanglant. Il y fut pansé, puis transféré au Comité de Salut public, d'où on le conduisit à l'échafaud, le 28 juillet 1794, avec son frère Maximilien, et plusieurs membres de la convention et de la commune mis hors la loi. Cette habitation servit ensuite à la justice de paix de l'arrondissement, et devint plus tard une propriété particulière portant le n°4 La plus grande partie de cet hôtel a été démolie pour livrer passage à la rue du Pont-Louis-Philippe.
Cet Hôtel devint par la suite propriété des seigneurs de Charni, qui lui donnèrent leur nom (à ne pas confondre cependant avec le Grand et le Petit Hôtel de Charny, dans la rue Beautreillis). On y avait établi, vers la fin du XVIIIème siècle, le bureau de l'administration des aides, avant qu'il ne soit transféré rue de Choiseul juste avant la révilution Dans cet Hôtel de Charni siégeait, en 1793, le Comité civil de la Section de la Commune. C'est là que, le 10 thermidor, à 2heures du matin, Augustin de Robespierre dit Le Jeune, qui venait de se jeter d'une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, fut transporté sanglant. Il y fut pansé, puis transféré au Comité de Salut public, d'où on le conduisit à l'échafaud, le 28 juillet 1794, avec son frère Maximilien, et plusieurs membres de la convention et de la commune mis hors la loi. Cette habitation servit ensuite à la justice de paix de l'arrondissement, et devint plus tard une propriété particulière portant le n°4 La plus grande partie de cet hôtel a été démolie pour livrer passage à la rue du Pont-Louis-Philippe.
 Au n° 12 de la rue des Barres, à l'angle de la rue du Grenier sur l'eau, en face du chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, on trouve une des rares maisons à colombages de Paris. Il s'agit de l'ancienne maison de ville de l'Abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, fondée par la reine Blanche de Castille (mère de Saint-Louis) en 1242. L'édifice actuel a été bâti vers 1540. Les religieuses, les Jeunes Filles de la Croix, s'y étaient établies dès 1664, bien qu'elles n'y fussent propriétaires qu'en vertu de lettres-patentes signées en juillet 1778. Ces dames, avaient pour mission de s'occuper de l'instruction religieuse des jeunes filles. Cette communauté, supprimée en 1790, devint propriété nationale et fut vendue le 16 vendémiaire an IV. Sur la façade qui donne du côté de la rue du Grenier-sur-l'eau, on peut admirer l'encorbellement monté sur des consoles massives. De telles avancées sur rue ont presque partout disparu (on en trouve aussi dans la rue des arbalétriers qui est situé à la limite du 4e arrondissement mais côté 3e). Elles étaient la règle au Moyen Âge car elles permettaient une utilisation intensive de l'espace urbain et de plus elles protégeaient de la pluie.
Au n° 12 de la rue des Barres, à l'angle de la rue du Grenier sur l'eau, en face du chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, on trouve une des rares maisons à colombages de Paris. Il s'agit de l'ancienne maison de ville de l'Abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, fondée par la reine Blanche de Castille (mère de Saint-Louis) en 1242. L'édifice actuel a été bâti vers 1540. Les religieuses, les Jeunes Filles de la Croix, s'y étaient établies dès 1664, bien qu'elles n'y fussent propriétaires qu'en vertu de lettres-patentes signées en juillet 1778. Ces dames, avaient pour mission de s'occuper de l'instruction religieuse des jeunes filles. Cette communauté, supprimée en 1790, devint propriété nationale et fut vendue le 16 vendémiaire an IV. Sur la façade qui donne du côté de la rue du Grenier-sur-l'eau, on peut admirer l'encorbellement monté sur des consoles massives. De telles avancées sur rue ont presque partout disparu (on en trouve aussi dans la rue des arbalétriers qui est situé à la limite du 4e arrondissement mais côté 3e). Elles étaient la règle au Moyen Âge car elles permettaient une utilisation intensive de l'espace urbain et de plus elles protégeaient de la pluie.
C'est cette maison que l'on peut voir sur la lithographie de Gilberte A. Pomier-Zaborowska. Comme durant une partie du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle, les façades de cette maison à pans de bois avaient été plâtrées afin de leur donner un aspect plus luxueux et moderne, et au rez-de-chaussée, elle abritait apparemment une boutique, ou plus sûrement un estaminet. La ville de Paris acheta le bâtiment en 1972. il a été restauré, les colombages ont été remis à nu, et elle accueille aujourd'hui la MIJE (Maison Internationale de la Jeunesse et des Etudiants). On y trouve des lits à prix défiant toute concurrence !!!
Au n° 15, on aperçoit à travers les grilles, un jardin sur l'emplacement de l'ancien charnier de Saint-Gervais., qui a été fermé en 1765. L'ancienne chapelle de la Communion, désaffectée a été occupée un temps par une maison de confiserie. C'est dans cette chapelle que fut sans doute enterré Philippe de Champaigne. D'une fenêtre de la confiserie on avait vue sur l'église et les charniers. L'architecte Albert Laprade restaura cet endroit entre 1943 et 1945, en y installant un jardin. Malheureusement, ce jardin n'est pas accessible, on peut juste photographier à travers les grilles.
 Au n°17, le motif central des balcons en fer forgé de toutes les fenêtres du premier étage rappelle l'orme de la place Saint-Gervais, mentionné pour la première fois en 1235, à l'occasion d'une vente et cité dans Le dit des rues de Paris, de Guillot vers 1310 : "Saint-Gervais et puis l'ourmetiau", preuve de son existence dès cette époque. En 1314, on le signale comme lieu de supplice : Philippe et Gauthier d'Aunay, accusés d'avoir entretenu des relations amoureuses avec les belles-filles de Philippe le Bel, furent suppliciés sous ses branches. Mais surtout l'Orme de Saint Gervais et Saint Protais était un lieu où venaient s'asseoir les juges "pédanés", qu'on appelait aussi "juges de dessous l'orme" les juges des seigneurs y tenaient leur juridiction et les vassaux venaient payer leurs créances "le jour de saint Rémy et à la saint Martin d'hiver". C'était aussi un lieu de réunion traditionnel des corporations, celle des Francs-Maçons, mais également les autres, les corporations pénitentielles ... Il y a tout lieu de penser que l'orme fut remplacé plusieurs fois. En 1787, Jaillot, historien de Paris, écrit d'ailleurs : "En face de l'église est un orme qu'on renouvelle de tems en tems." En effet, les estampes et manuscrits du XVIIè siècle ou du du XVIIIè siècle, il n'a guère plus de 7 à 8 mètres de haut et est toujours représente sur le parvis de l'église d'un muret de pierre.
Au n°17, le motif central des balcons en fer forgé de toutes les fenêtres du premier étage rappelle l'orme de la place Saint-Gervais, mentionné pour la première fois en 1235, à l'occasion d'une vente et cité dans Le dit des rues de Paris, de Guillot vers 1310 : "Saint-Gervais et puis l'ourmetiau", preuve de son existence dès cette époque. En 1314, on le signale comme lieu de supplice : Philippe et Gauthier d'Aunay, accusés d'avoir entretenu des relations amoureuses avec les belles-filles de Philippe le Bel, furent suppliciés sous ses branches. Mais surtout l'Orme de Saint Gervais et Saint Protais était un lieu où venaient s'asseoir les juges "pédanés", qu'on appelait aussi "juges de dessous l'orme" les juges des seigneurs y tenaient leur juridiction et les vassaux venaient payer leurs créances "le jour de saint Rémy et à la saint Martin d'hiver". C'était aussi un lieu de réunion traditionnel des corporations, celle des Francs-Maçons, mais également les autres, les corporations pénitentielles ... Il y a tout lieu de penser que l'orme fut remplacé plusieurs fois. En 1787, Jaillot, historien de Paris, écrit d'ailleurs : "En face de l'église est un orme qu'on renouvelle de tems en tems." En effet, les estampes et manuscrits du XVIIè siècle ou du du XVIIIè siècle, il n'a guère plus de 7 à 8 mètres de haut et est toujours représente sur le parvis de l'église d'un muret de pierre.
 Vers la fin du XVIIIe siècle, certains critiques demandèrent la mise à mort de cet arbre légendaire qui cachait la vue du portail. L'orage de 1789 allait essayer, lui aussi, de renverser l'orme légendaire. Le 1er ventôse an II (19 février 1794), la section de la Maison commune demanda sa mise à mort et "décida que cet emblème de la superstition serait abattu, que son tronc servirait à confectionner des affûts de canon et ses branches brûlées pour en faire du salpêtre". On ne sait pas quand la place Saint-Gervais perdit son orme. Certains prétendent qu'il fut abattu en 1811 ; Victor Hugo le cite, dans Les Misérables, comme étant encore debout en 1832. Il est possible cependant qu'il ait subsisté jusqu'en 1837. Quoi qu'il en soit, en 1847, le curé de la paroisse demande que les rangées de platanes qui se meurent autour de la place soient remplacées par un orme. Le souvenir de l'arbre légendaire fut conservé non seulement dans les appuis de fenêtre et dans les plaques de cheminées, mais aussi dans une enseigne provenant de la rue du Temple, aujourd'hui au Musée Carnavalet. Depuis l'orme de Saint-Gervais se dresse à nouveau : Le 10 mars 1914, un jeune plant de quinze ans, provenant des pépinières du Val-d'Aulnay-en-Châtenay fut fiché en terre devant la vieille église. L'orme actuel a, lui, été planté en 1936. Avant la Révolution, Pierre. Sue, "chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville", oncle d'Eugène Sue, aurait habité cette maison du n°17 ?
Vers la fin du XVIIIe siècle, certains critiques demandèrent la mise à mort de cet arbre légendaire qui cachait la vue du portail. L'orage de 1789 allait essayer, lui aussi, de renverser l'orme légendaire. Le 1er ventôse an II (19 février 1794), la section de la Maison commune demanda sa mise à mort et "décida que cet emblème de la superstition serait abattu, que son tronc servirait à confectionner des affûts de canon et ses branches brûlées pour en faire du salpêtre". On ne sait pas quand la place Saint-Gervais perdit son orme. Certains prétendent qu'il fut abattu en 1811 ; Victor Hugo le cite, dans Les Misérables, comme étant encore debout en 1832. Il est possible cependant qu'il ait subsisté jusqu'en 1837. Quoi qu'il en soit, en 1847, le curé de la paroisse demande que les rangées de platanes qui se meurent autour de la place soient remplacées par un orme. Le souvenir de l'arbre légendaire fut conservé non seulement dans les appuis de fenêtre et dans les plaques de cheminées, mais aussi dans une enseigne provenant de la rue du Temple, aujourd'hui au Musée Carnavalet. Depuis l'orme de Saint-Gervais se dresse à nouveau : Le 10 mars 1914, un jeune plant de quinze ans, provenant des pépinières du Val-d'Aulnay-en-Châtenay fut fiché en terre devant la vieille église. L'orme actuel a, lui, été planté en 1936. Avant la Révolution, Pierre. Sue, "chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville", oncle d'Eugène Sue, aurait habité cette maison du n°17 ?
Perpendiculaire à la rue des Barres, voilà la rue du Grenier sur l'eau. Rien à voir avec une grange ou un hangar ... c'est ruelle du XIIIème siècle qui doit son nom à son voisinage de la rivière et à un personnage nommé Garnier ou Guernier, bourgeois de Paris qui fit quelques donations au Temple en 1241 et qui y habitait. Ce nom propre est devenu ensuite par corruption Grenier. En 1257, elle s'appelait rue André-sur-l'Eau. On la trouve aussi désignée sous les noms de Garnier sur l'Yaue et Guernier sur l'Eau. En 1391, elle figurait dans les comptes relevés de la taille sous le nom de Garnier-sur-l'Eau, et deux contribuables y étaient signalés, Jacob de Marcilli pour une maison "qui fust aux Nonneardierre, depuis aux moines de Prully, depuis à Jacques Lenoble, tenant à la maison du coin de ladicte rue de vers Seine", et Raulin Petit "d'austre part de ladicte rue, maison à apentis." En1833, la rue a été coupée en deux par la rue du Pont-Louis-Philippe.
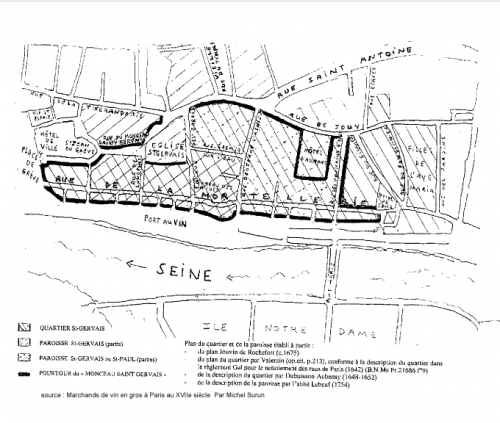 Un édit de Henri III de 1577 avait permis aux marchands de vins d'y établir le siège de leur corporation. Ces statuts ont été confirmés par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Blanchet Adam commence à y exercer vers 1595, et le "Monceau Saint Gervais" est cité officiellement dès 1680 comme lieu de tolérance au regard de la réglementation du commerce du vin, les "marchands de vin en gros du Monceau Saint Gervais" habitant et exerçant dans ce territoire à proximité immédiate du port de la vente au vin en grève.
Un édit de Henri III de 1577 avait permis aux marchands de vins d'y établir le siège de leur corporation. Ces statuts ont été confirmés par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Blanchet Adam commence à y exercer vers 1595, et le "Monceau Saint Gervais" est cité officiellement dès 1680 comme lieu de tolérance au regard de la réglementation du commerce du vin, les "marchands de vin en gros du Monceau Saint Gervais" habitant et exerçant dans ce territoire à proximité immédiate du port de la vente au vin en grève.
Sous Louis XIV, les marchands de vin eurent le siège de leur corporation dans la rue Grenier-sur-l'eau, au-dessus d'une cour de passage, formant ruelle, dont parle l'historien Henri Sauval (1623 - 1676) dans son Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, et qui menait à la rue aux Bretons. Leurs gardes et maîtres jouissaient des mêmes privilèges que ceux des six corps de marchands, et ils pouvaient remplir, par conséquent, les charges municipales et consulaires. Les armoiries qu'ils avaient obtenues en l'année 1629 comportaient principalement un navire à bannière de France, qui flottait entouré de six petites nefs, et une grappe de raisin en chef, sur champ d'azur. Au moment de la Révolution, le bureau se trouvait rue de la Poterie.
Au XVIe siècle, on trouve également des potiers dans la paroisse Saint-Gervais (cimetière Saint-Jean, rue du Grenier-sur-l'Eau), Saint-Paul (rue Saint-Antoine), Saint-Nicolas (rue aux Oies, rue des Gravilliers), et un four de potier, le seul actuellement connu pour la fin du Moyen Age à Paris, et une partie de sa production ont été mis au jour en 2001, lors de la fouille du Mémorial de la Shoah, allée des Justes de France, anciennement rue du Grenier-sur-l'Eau.. Une partie des actes notariés des notaires du quartier Saint-Gervais a été étudiée dans le but de retrouver le nom du ou des potiers qui ont travaillé dans cette rue.
Ainsi, les officines de potiers sont installées dans les rues proches de la Seine et du port de Grève où l'on pouvait s'approvisionner en bois. Ils sont également proches des Halles, principal lieu de vente. mais le four de la rue du Grenier-sur-l'Eau qui a cessé de fonctionner vers le milieu du XVIe siècle. Car les odeurs dues aux terres mises à pourrir, les fumées polluantes, les méfaits qui pourraient être occasionnés par l'emploi de plomb, de souffre et limaille, d'ocre et autres matériaux, et aussi la peur des incendies entraînent diverses procès et interdictions. Une lettre patente du 20 octobre 1563 du roi Charles IX vise à éloigner les industries polluantes comme la boucherie dans les faubourgs de la ville ; un édit du 21 novembre 1577 du roi Henri III homologue un Règlement de Police Générale pour les métiers et marchandises de la Ville de Paris et du royaume, et ordonne que "plus de tuileries ne seront construites dans l'intérieur de Paris". Comme le rappelle Lespinasse, à la fin du XIXe siècle, "... la salubrité de l'air, la pureté de l'eau, la bonté des aliments et des remèdes font les aspects immédiats des soucis de la santé publique. De là viennent les Ordonnances et les Règlements pour le nettoyement des rues, l'écoulement des inondations par les cloaques, et les décharges ... C'est sur ce motif que sont fondés les Règlements qui ordonnent que les tanneurs, les fours à cuire les poteries de terre, les teinturiers et les tueries des bestiaux seront éloignés du milieu des Villes"
Au lendemain de l'empire, le journaliste Auguste Vitu écrivait : "Pour sortir de la rue Geoffroy-l'Anier, qui n'a que huit mêtres de large et dont la perspective n'a rien d'engageant, les amateurs de pittoresque s'engageant dans la rue Grenier-sur-l'Eau, qui les mènera, à travers la rue des Barres, jusqu'au chevet de l'église Saint-Gervais. La rue Grenier-sur-l'Eau est si étroite qu'elle ne laisserait pas passer un chariot d'enfant, et n'est qu'une ruelle entre des murailles sans portes ni fenêtres, laissant à peine descendre le jour jusqu'au pavé glissant. Sa jonction avec la rue des Barres est pour ainsi dire bouchée par le surplomb d'une maison ancienne portée par des consoles et au-delà de laquelle on aperçoit l'abside de l'église Saint-Gervais (...) En quittant la rue des Barres, aussi sinistre d'aspect que placide en réalité, pour redescendre vers le quai de l'Hôtel-de -Ville, on revoit la clarté du jour, avec une satisfaction d'autant plus vive que, par la percée qui précède le pont Louis-Philippe, l'on aperçoit l'île Saint-louis, la montagne Sainte-Geneviève, et, à droite, la cathédrale de Paris" (Paris, Images et Traditions en 1889)
 Aujourd'hui, une partie de la rue Grenier-sur-l'Eau, piétonne et plantée d'une rangée d'arbres, s'appelle l'Allée des Justes. Elle longe le Mémorial de la Shoah, inauguré le 14 juin 2006, et s'y élève le Mur des Justes.
Aujourd'hui, une partie de la rue Grenier-sur-l'Eau, piétonne et plantée d'une rangée d'arbres, s'appelle l'Allée des Justes. Elle longe le Mémorial de la Shoah, inauguré le 14 juin 2006, et s'y élève le Mur des Justes.
20:23 Publié dans balade, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |














