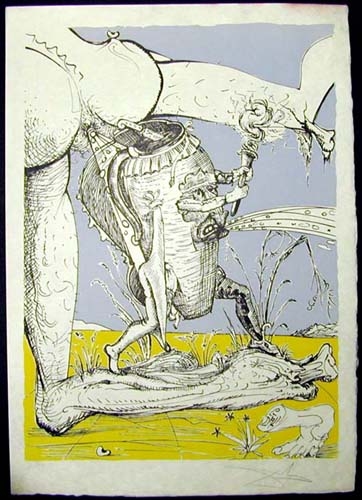mercredi, 26 mai 2010
Charles VII et la naissance de l'état moderne
 J'aime les éphémérides, ils sont quelques fois pour moi le point de départ d'un article pour mon blog. Je me dis "tiens, qu'est-il arrivé un 15 mars, ou un 25 juin", et une date m'accroche, je pars dans des recherches historiques ou scientifiques ... j'aime bien le blog "il y a un siècle", et son très jeune frère "il y a trois siècles". L'auteur nous conte des événements d'il y a un siècle de manière vivante et souvent amusante, inventant les situations, mais en respectant le contexte historique, si bien qu'on pourrait croire qu'ils se sont passés réellement . Je n'ai pas ce talent de conteur, mes posts sont plus factuels mais, ne me prenant évidemment pas pour une historienne, je suis plutôt chroniqueuse et "compilateure" de tout ce que je trouve sur internet, en essayant tout de même de trier le vrai du faux dans la mesure de mes moyens ... je savoure ainsi la (re)découverte de notre histoire, y vagabonde parfois tellement que je dépasse allègrement la date en question, ce qui m'oblige à remettre à plus tard l'édition de ma note ...
J'aime les éphémérides, ils sont quelques fois pour moi le point de départ d'un article pour mon blog. Je me dis "tiens, qu'est-il arrivé un 15 mars, ou un 25 juin", et une date m'accroche, je pars dans des recherches historiques ou scientifiques ... j'aime bien le blog "il y a un siècle", et son très jeune frère "il y a trois siècles". L'auteur nous conte des événements d'il y a un siècle de manière vivante et souvent amusante, inventant les situations, mais en respectant le contexte historique, si bien qu'on pourrait croire qu'ils se sont passés réellement . Je n'ai pas ce talent de conteur, mes posts sont plus factuels mais, ne me prenant évidemment pas pour une historienne, je suis plutôt chroniqueuse et "compilateure" de tout ce que je trouve sur internet, en essayant tout de même de trier le vrai du faux dans la mesure de mes moyens ... je savoure ainsi la (re)découverte de notre histoire, y vagabonde parfois tellement que je dépasse allègrement la date en question, ce qui m'oblige à remettre à plus tard l'édition de ma note ...
Le Moyen Age est ma période préférée, sans doute parce que je peux coupler ces recherches avec celles concernant un autre de mes hobbys, l'enluminure. Cette fois ci, le hasard m'a fait (re)découvrir combien notre organisation politique et économique devait à cette période.
 Onzième des douze enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et troisième à porter ce prénom, Charles devient dauphin à la suite de la mort prématurée de ses deux frères aînés, Louis de France en 1413 et Jean, duc de Touraine, mort en 1417. En 1418, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l'héritier de la couronne doit quitter Paris, aux mains des Bourguignons, et se réfugie à Bourges où il prend le titre de régent, suite à la démence du souverain.
Onzième des douze enfants de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, et troisième à porter ce prénom, Charles devient dauphin à la suite de la mort prématurée de ses deux frères aînés, Louis de France en 1413 et Jean, duc de Touraine, mort en 1417. En 1418, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l'héritier de la couronne doit quitter Paris, aux mains des Bourguignons, et se réfugie à Bourges où il prend le titre de régent, suite à la démence du souverain.
Henri V d'Angleterre, profitant de la folie du roi Charles VI de France et de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, relance la guerre de Cent Ans, remporte la bataille d'Azincourt en 1415, s'empare de la Normandie et installe son gouvernement au château de Rouen le 19 janvier 1419. À cette date, seul le Mont-Saint-Michel tient bon ! Les Anglais peuvent prendre Paris en 1419. Il s'allie alors avec le jeune duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui avait à venger le meurtre de son père Jean sans Peur par les partisans du dauphin à Montereau (10 septembre 1419) et avec la reine Isabeau de Bavière, et il obtient la couronne de France au traité de Troyes en 1420, à condition d'épouser Catherine de Valois, fille du roi de France, avec en dot l'Aquitaine et la Normandie, héritage d'Aliénor d'Aquitaine et de Guillaume le Conquérant confisqué petit à petit par la monarchie capétienne. Charles VI conserve néanmoins le titre de roi et son fils gouverne en qualité de régent les États qui lui restent.
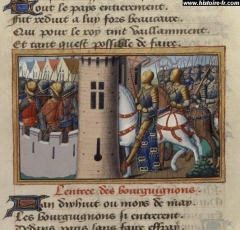


Cependant Paris est toujours occupé par les Anglais. Les notables se concertent pour mettre fin à la domination étrangère et ouvrent clandestinement les portes au connétable de Richemond qui reprend possession de la ville en 1436. Les Anglais sont alors inexorablement et progressivement repoussés. En 1453, ils ne contrôlent plus sur le continent que Calais, et les droits d'Henri VI sur le trône de France sont révoqués, Charles VII est donc rétabli sur le trône. Mais pour pouvoir bouter définitivement les Anglais hors de France, le roi doit disposer d'une armée mais pour cela il a besoin d'argent !
L'impôt et l'armée régulière ...
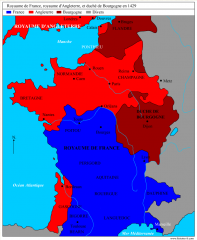 Déjà les "Etats" de 1435 ont admis que l'ancienne pratique "le roi vit du sien" n'est plus entièrement applicable en France face à la poussée des dépenses. Les revenus fournis par le domaine royal ne permettent plus au roi d'assumer les dépenses du royaume. Les Etats décident d'attribuer au roi les rentrées fiscales d'un impôt de consommation perçu sur les marchandises mises en vente : les aides. Parallèlement, la décision d'affranchir les clercs du paiement de cet impôt augmente les libertés, franchises et privilèges ceux-ci et renforce la cohésion de l'"ordre" du clergé. Les Etats de 1435 se plaignent par ailleurs des gens de guerre qui "continuellement s'arment et poursuivent les armes", ces "gens de guerre" étant souvent confondus avec l'"ordre" de la noblesse.
Déjà les "Etats" de 1435 ont admis que l'ancienne pratique "le roi vit du sien" n'est plus entièrement applicable en France face à la poussée des dépenses. Les revenus fournis par le domaine royal ne permettent plus au roi d'assumer les dépenses du royaume. Les Etats décident d'attribuer au roi les rentrées fiscales d'un impôt de consommation perçu sur les marchandises mises en vente : les aides. Parallèlement, la décision d'affranchir les clercs du paiement de cet impôt augmente les libertés, franchises et privilèges ceux-ci et renforce la cohésion de l'"ordre" du clergé. Les Etats de 1435 se plaignent par ailleurs des gens de guerre qui "continuellement s'arment et poursuivent les armes", ces "gens de guerre" étant souvent confondus avec l'"ordre" de la noblesse.
Car pour faire la guerre, le roi est obligé de faire appel à ses vassaux pour réunir l'Ost (coutume féodale du ban). Mais les vassaux ne sont tenus à répondre à l'appel que pendant 40 jours. Au delà, le roi doit recruter des compagnies de mercenaires. Lors des périodes de paix ou de trêve, ces mercenaires sans emploi se regroupent en bandes et vivent de pillages et de rançons. C'est ce qui s'était passé au début de la guerre de Cent Ans, après les victoires de Charles V et Du Guesclin, et se passe de nouveau après le traité d'Arras de 1435. Certaines de ces bandes, qui peuvent compter plusieurs milliers de membres, sont appelées les Écorcheurs. Elles sont souvent menées par des chefs qui ont servi Charles VII. Parmi les Écorcheurs les plus célèbres, on peut citer La Hire, Antoine de Chabannes, Jean Poton de Xaintrailles ou Rodrigue de Villandrando. Ces bandes mettent à mal les campagnes françaises, pillant, violant, brûlant et tuant et, selon les chroniques du temps, commettant des "abominations telles que les Sarrasins ne font pas aux Chrétiens".
Charles VII décide donc de poursuivre l'offensive avec une armée régulière, permettant d'assurer un engagement de longue durée aux anciens mercenaires. Il obtient progressivement des états de la langue d'Oïl puis d'Oc la possibilité de reconduire les "aides" sans réunir les états annuellement : c'est l'instauration de la permanence de l'impôt prélevé dans chaque famille du royaume.
Le 2 novembre 1439, les "Etats", réunis à Orléans, l'autorisent à lever régulièrement, chaque année, l'impôt pour la "taille des lances" (on parlera plus tard de la "taille" tout simplement). Le clergé et la noblesse en sont dispensés. Tirant parti de ces ressources financières régulières, le roi va pouvoir remplacer les mercenaires par une armée régulière. Dans ses Vigiles de Charles VII (écrites en 1439) Martial d'Auvergne écrit: "L'an mil quatre cent trente neuf / Le feu roi si fit les gens d'armes / Vêtir et habiller de neuf, / Car lors étoient en pauvres termes. / Les uns avoient habits usés / Allant par pièces et lambeaux / Et les autres tout déchirés / Ayant bon besoin de nouveau. / Si les monta et artilla, / Le feu roi selon son désir, / Et grandement les rhabilla / Car en cela prenoit plaisir."
Désormais nul ne peut être capitaine de gens d'armes sans avoir été nommé par le roi. Tous ceux qui étaient atteints par ces mesures, princes et seigneurs qui y voient, non sans raison, un risque pour leurs privilèges féodaux, chefs de bandes, ... cherchent aussitôt à en empêcher l'exécution, et dès lors "se machina une praguerie". Ce mouvement, appelé Praguerie parce qu'il coïncidait avec une manifestation analogue en Bohême, réunit plusieurs seigneurs de haut rang, comme le duc Charles I° de Bourbon, le comte de Dunois, le duc Jean II d'Alençon, le grand chambellan et ancien "favori" Georges de La Trémoïlle, et les capitaines de routiers, comme Antoine de Chabannes, etc. Il entraîna même le dauphin Louis, alors âgé de seize ans, dont l'ambition précoce commençaient à s'éveiller. Il est rapidement maté par le Connétable de Richemont.
 Par une ordonnance en date du 26 mai 1445, à Louppy-le-Châtel (près de Bar-le-Duc), le roi Charles VII crée les Compagnies de l'ordonnance ou compagnies d'ordonnance. Cette nouvelle formation militaire, constituée avec les éléments les plus présentables des bandes d'écorcheurs, devient la première armée permanente à la disposition du roi de France. Chaque compagnie est commandée par un capitaine nommé par le roi et comprend cent lances garnies, une lance garnie comprenant six hommes : un homme d'armes en armure, trois archers, un coutilier et un page. Cent lances forment une compagnie. Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. En 1448, Charles VII crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé de la taille d'où son nom de "franc-archer". Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. À l'image de l'Angleterre, la France se constitue ainsi une infanterie d'environ 8 000 francs-archers.
Par une ordonnance en date du 26 mai 1445, à Louppy-le-Châtel (près de Bar-le-Duc), le roi Charles VII crée les Compagnies de l'ordonnance ou compagnies d'ordonnance. Cette nouvelle formation militaire, constituée avec les éléments les plus présentables des bandes d'écorcheurs, devient la première armée permanente à la disposition du roi de France. Chaque compagnie est commandée par un capitaine nommé par le roi et comprend cent lances garnies, une lance garnie comprenant six hommes : un homme d'armes en armure, trois archers, un coutilier et un page. Cent lances forment une compagnie. Les 15 compagnies totalisent 9 000 hommes, dont 6 000 combattants qui forment la grande ordonnance. En 1448, Charles VII crée la petite ordonnance : en cas de mobilisation, chaque paroisse (cinquante feux) est tenue de mettre à la disposition du roi un archer bien équipé et bien exercé. Pour compenser les charges qui pèsent sur lui, il est dispensé de la taille d'où son nom de "franc-archer". Choisi par les agents du roi, il est tenu au service de ce dernier. À l'image de l'Angleterre, la France se constitue ainsi une infanterie d'environ 8 000 francs-archers.

La genèse de l'état moderne ...
Les Etats de 1439 et l'ordonnance du 26 mai 1445 jouent donc un rôle important dans la création de la France monarchique : ils définissent rigoureusement le droit de lever des armées et l'attribuent exclusivement au roi. Le droit de guerre ou de paix et le pouvoir de négocier avec les puissances étrangères deviennent un des attributs essentiels de la souveraineté en France. Après le droit de justice acquis sous les capétiens, avec la Curia regis , haute juridiction royale dérivée du conseil des vassaux, et les officiers royaux -baillis et sénéchaux - chargés de rendre et de contrôler la justice et créés par Philippe Auguste, après le monopole de battre la monnaie depuis Philippe de Valois par une ordonnance du 16 janvier 1346 déclarant "A nous et à notre majesté royale appartient seulement pour le tout, en notre royaume, le métier, le fait, la provision, et toute l'ordonnance de monnaie, et de faire monnoyer telles monnaie, et donner tel cours, pour tel prix, comme il nous plaît et comme bon nous semble" , confirmée par l'ordonnance du 20 mars 1381 "A nous seul, et pour le tout, de notre droit royal, par tout notre royaume, appartient de faire telles monnaies, comme il nous plaît, et de leur donner prix", c'est l'ensemble des droits régaliens qui sont ainsi clairement définis dans le royaume : Le souverain est seul justicier, seul homme de guerre, seul monnayeur ...
La cristallisation de la souveraineté nationale en la personne du Roi de France va s'accompagner, au cours du XVème et XVIème siècle, du développement des organisations permettant l'exercice de cette souveraineté, ancêtres de nos Services Publics ... L'administration centrale et territoriale se spécialise, se professionnalise et se hiérarchise. A la fin du Moyen Age, il existe un milieu d'officiers, distinct des seigneurs et des notables urbains, qui compose ces administrations : La Chancellerie, responsable de l'administration écrite, de la diplomatie, La Trésorerie, la cour des comptes qui contrôle la bonne gestion des comptes fiscaux et le parlement : C'est parmi les parlementaires que l'on remarque un milieu social autonome. En même temps se met en place une administration territoriale : Baillis, Sénéchaux, Receveur et Elus ... Les officiers prennent de plus en plus de pouvoir ; la carrière administrative est prometteuse.
 Sur le plan juridique, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser. Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans le 125ème article de l'ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts : "nous, voulant abréger les procès et litiges d'entre nos sujets et les relever de mise et dépends, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se pourra, et ôter toutes manières de variations et contrariétés, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous pays de notre royaume soient rédigés et mis en écrits (...) prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu'ils n'allèguent, ne proposent autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrété comme dit est"
Sur le plan juridique, le roi de France dispose du pouvoir législatif par le biais des ordonnances, qui portent sur le droit public et la réformation du royaume. Quant au droit privé, régi par la coutume, le roi cherche à le stabiliser, sinon à le rationaliser. Pour pallier les insuffisances du siècle précédent, Charles VII, dans le 125ème article de l'ordonnance de Montils-les-Tours (1454), ordonne aux baillis de rédiger les coutumes de leurs ressorts : "nous, voulant abréger les procès et litiges d'entre nos sujets et les relever de mise et dépends, et mettre certaineté ès jugements tant que faire se pourra, et ôter toutes manières de variations et contrariétés, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous pays de notre royaume soient rédigés et mis en écrits (...) prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu'ils n'allèguent, ne proposent autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrété comme dit est"
Mais cette ordonnance est mal conçue : le projet de rédaction de chaque bailliage doit en effet être renvoyé au roi, lequel doit consulter le Parlement avant promulgation. L'expérience montre que le Parlement, débordé de réclamations, ne peut faire face. Charles VIII de France repensera donc le système dans l'ordonnance de Moulin du 2 septembre 1497 : dans chacun des bailliages, ce sont désormais des commissaires délégués, issus du Parlement, qui rédigent le projet élaboré par le bailli assisté des notables. En conséquence les coutumes d'application géographique restreinte disparaissent, et les différences entre coutumes, désormais aisément identifiables, se trouvent mises en pleine lumière. Dans un souci d'harmonisation, la monarchie décide donc la "réformation" des coutumes. Ce travail juridique permet au roi d'évincer progressivement le droit romain, et de le remplacer par un droit royal français.
 La crise du Grand Schisme d'Occident (1378-1417) est également favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle de 1431, fournit l'occasion d'assurer cette autorité. Auparavant les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes. Charles VII fait examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publie, amendés, en une "Pragmatique Sanction de Bourges", ordonnance promulguée le 7 juillet 1438 avec l'accord du clergé. Elle donne son autonomie à l'Eglise de France face à la papauté et à la curie romaine. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France et surtout comme "première personne ecclésiastique du royaume". Son texte réserve à l'Église gallicane (c'est-à-dire française) tout ce qui relève de l'administration en laissant au pape ce qui relève de la foi. On peut admettre que cette "Pragmatique sanction" marque une étape importante dans le passage de la "Respublica christiana" - état de droit canon transcendant les divers Etats temporels, de droit civil et purement humain - à une conception moins exclusivement religieuse du monde, début d'un processus de laïcisation ... Ces idées que le "Prince" doit pouvoir disposer d'une force propre et de compétences militaires et que l'état laïc doit contrôler l'Église, Machiavel les théorisera quelques dizaines d'années plus tard dans "Le Prince" ...
La crise du Grand Schisme d'Occident (1378-1417) est également favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle de 1431, fournit l'occasion d'assurer cette autorité. Auparavant les papes s'attribuaient le droit de régenter les monarchies chrétiennes. Charles VII fait examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publie, amendés, en une "Pragmatique Sanction de Bourges", ordonnance promulguée le 7 juillet 1438 avec l'accord du clergé. Elle donne son autonomie à l'Eglise de France face à la papauté et à la curie romaine. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France et surtout comme "première personne ecclésiastique du royaume". Son texte réserve à l'Église gallicane (c'est-à-dire française) tout ce qui relève de l'administration en laissant au pape ce qui relève de la foi. On peut admettre que cette "Pragmatique sanction" marque une étape importante dans le passage de la "Respublica christiana" - état de droit canon transcendant les divers Etats temporels, de droit civil et purement humain - à une conception moins exclusivement religieuse du monde, début d'un processus de laïcisation ... Ces idées que le "Prince" doit pouvoir disposer d'une force propre et de compétences militaires et que l'état laïc doit contrôler l'Église, Machiavel les théorisera quelques dizaines d'années plus tard dans "Le Prince" ...
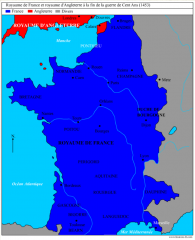 Son fils Louis XI transformera ce pays dépeuplé en un État de grande puissance. Il crée les parlements de Bordeaux et de Dijon, il encourage le commerce et facilite l'accès de la France aux négociants étrangers, il améliore les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres), il favorise l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondent, à Tours, les premières manufactures de soieries. Mais surtout il posera les bases d'une unité territoriale et administrative aux dépends des pouvoirs locaux. En 1482, Louis XI parvient à récupérer la Picardie et la Bourgogne par le traité d'Arras. Par le jeu d'héritages, dont celui de René Ier d'Anjou, il entre en possession du Maine et de la Provence. L'unité du pays est rétablie, les frontières ne sont pas tout à fait celles de la France actuelle mais elles s'en rapprochent. En 1483, pour la première fois, la représentation des trois ordres est organisée pour l'ensemble du royaume et les Etats de langue d'Oïl et ceux de langue d'Oc forment les Etats Généraux. Plus tard, la progression du français dans les élites sociales puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 instituant le français comme la langue des documents administratifs, montreront que les conseils du roi ont compris que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume.
Son fils Louis XI transformera ce pays dépeuplé en un État de grande puissance. Il crée les parlements de Bordeaux et de Dijon, il encourage le commerce et facilite l'accès de la France aux négociants étrangers, il améliore les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres), il favorise l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondent, à Tours, les premières manufactures de soieries. Mais surtout il posera les bases d'une unité territoriale et administrative aux dépends des pouvoirs locaux. En 1482, Louis XI parvient à récupérer la Picardie et la Bourgogne par le traité d'Arras. Par le jeu d'héritages, dont celui de René Ier d'Anjou, il entre en possession du Maine et de la Provence. L'unité du pays est rétablie, les frontières ne sont pas tout à fait celles de la France actuelle mais elles s'en rapprochent. En 1483, pour la première fois, la représentation des trois ordres est organisée pour l'ensemble du royaume et les Etats de langue d'Oïl et ceux de langue d'Oc forment les Etats Généraux. Plus tard, la progression du français dans les élites sociales puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 instituant le français comme la langue des documents administratifs, montreront que les conseils du roi ont compris que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume.
00:32 Publié dans enluminures, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 21 mai 2010
21 Mai 1910 : le prix du champagne !
 Il y a 100 ans, pour avoir effectué un vol d'une quarantaine de minutes entre Calais et le Royaume-Uni le 21 Mai 1910, le français Jacques de Lesseps gagne le prix de 12 500 francs-or (ce qui ferait aujourd'hui un peu moins de 40 000 €) créé le 15 novembre 1906 par André Ruinart de Brimont, pour récompenser une traversée de la Manche par « un appareil plus lourd que l'air, se mouvant par les seuls moyens de propulsion du bord ». Ce prix est complété par la prime de 100 £ offerte par le Daily Mail pour le second vol au dessus de la Manche.
Il y a 100 ans, pour avoir effectué un vol d'une quarantaine de minutes entre Calais et le Royaume-Uni le 21 Mai 1910, le français Jacques de Lesseps gagne le prix de 12 500 francs-or (ce qui ferait aujourd'hui un peu moins de 40 000 €) créé le 15 novembre 1906 par André Ruinart de Brimont, pour récompenser une traversée de la Manche par « un appareil plus lourd que l'air, se mouvant par les seuls moyens de propulsion du bord ». Ce prix est complété par la prime de 100 £ offerte par le Daily Mail pour le second vol au dessus de la Manche.
Louis Blériot pouvait bien entendu remporter également ce trophée lors de sa traversée de juillet 1909 mais il avait alors choisit de concourir exclusivement pour le prix du Daily Mail dont le montant était plus important encore.
Fils de l'illustre ingénieur Ferdinand de Lesseps, auquel on doit le percement du canal de Suez, Jacques de Lesseps est né à Paris, le 5 juillet 1883. Avec ses frères Bertrand, Paul et Robert, il se passionne pour l'aviation et décide d'apprendre à piloter au lendemain de l'inoubliable exploit de Blériot joignant le 25 juillet 1909 la France et l'Angleterre.
Pour former ses clients, Blériot a installé en hâte à Buc (Yvelines) une école de pilotage avant de monter des écoles plus importantes et mieux dotées en matériel à Issy-les-Moulineaux, Pau et Étampes. Certains de ses clients portent des noms célèbres, d'autres noms, inconnus, vont bientôt le devenir par leurs exploits. Jacques de Lesseps est le plus assidu de la petite école de pilotage, installée sur le champ de manoeuvres d'Issy-les-Moulineaux, sur un monoplan que Louis Blériot mettait à la disposition de quelques fanas.
Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l'aviation un brevet de pilote. Personne n'osant faire passer un examen à ces pionniers et pour éviter tous débats, il est décidé d'attribuer ces premiers brevets par ordre alphabétique, empêchant ainsi toute espèce de prééminence entre les 16 premiers brevetés. Le N°1 échoit ainsi à Louis Blériot et le dernier à Wilbur Wright. Deux numéros « bis » (5 et 10) et pas de numéro 13 ... La réglementation du brevet de pilote entre en vigueur le 1er janvier 1910 et Jacques de Lesseps l'obtient dès le 6 janvier 1910 avec le N° 26, après quelques séances d'entraînement en réalisant un vol de 1 h 50 sans toucher le sol. À Issy, Jacques de Lesseps se perfectionne par un entraînement assidu et il participe aux nombreuses compétitions et conférences sur le développement de l'aviation un peu partout dans le monde.

Après l'exploit de Louis Blériot d'avoir franchi la Manche, restait un prix en compétition offert par la marque de champagne Ruinart à celui qui traverserait le détroit un samedi ou un dimanche. Comme Louis Blériot 10 mois auparavant, Jacques de Lesseps décolle du lieu dit Les Baraques, près de Calais, le 21 mai 1910 en début d'après midi, à bord de son Blériot XI à moteur Gnome-et-Rhône de 50 cv, baptisé « Scarabée ». Quelques jours auparavant, son départ est retardé à cause du décès du roi Edouard VII d'Angleterre. À 15 h 50, l'appareil s'envole, prend de la hauteur, à 400 ou 500 mètres d'altitude, puis pique vers le large escorté par le contre-torpilleur Escopette. Trois-quarts d'heure après, il se pose sans encombre à proximité de la ferme de Wonston Court, à Sainte Margaret Bay, au Nord-Est de Douvres. Il est le second aviateur qui ait réussi la traversée de la Manche !

Jacques de Lesseps aurait souhaité rentrer en France avec son avion, mais la brume s'étant épaissie, il doit renoncer à ce projet et rejoint Calais le soir en steamer, où un banquet lui est offert. Le capitaine de frégate Prat, commandant la station des sous-marins de Calais, qui allait trouver la mort le 26 mai dans les flancs du "Pluviôse", prend la parole au dessert. Mais Jacques de Lesseps ne recevra pas autant d'honneurs que son prédécesseur Louis Blériot, la France ayant décrété un deuil national en mémoire des vingt-sept victimes du naufrage.
La traversée de la Manche ayant été réalisée à deux reprises, la Maison de Champagne Ruinart offre alors immédiatement un nouveau Prix pour le pilote qui réalisera le 1er aller-retour entre la France et l'Angleterre. Il sera remportée dans les jours qui suivirent, le 2 juin 1910, par l'anglais Charles Stewart Rolls, créateur de la célèbre firme automobile du même nom. " Les exploits des aviateurs se suivent et se surpassent, et l'on doit vraisemblablement s'attendre, après leurs derniers triomphes, à la prochaine réalisation de tous les rêves d'Icare. C'est pourquoi, si l'on admire toujours, on ne s'étonne presque plus" écrit la presse.
Héros, Jacques de Lesseps devait l'être également pendant la Première Guerre mondiale. Chef d'escadrille, il sert sur le front comme pilote de bombardier et de reconnaissance aérienne. Il effectue 95 missions de bombardement et défend Paris contre les Zeppelins allemands. Il est cité quatre fois à l'ordre du jour de l'armée française et est fait chevalier de la Légion d'honneur. La France lui décernera aussi la Croix de Guerre et le gouvernement américain lui attribuera la Distinguished Service Cross.
La paix revenue, il part au Canada, où il devient directeur technique de la compagnie aérienne Française-Canadienne (CAFC), qui se spécialise dans la rédaction de cartes géographiques à partir de photos aériennes. En 1926 et 1927, il est chargé par Honoré Mercier, ministre des Terres et Forêts du Québec, de réaliser un relevé cartographique de la Gaspésie depuis les airs. Cette technique s'avère beaucoup plus efficace que les relevés topographiques, difficiles à effectuer dans une région comme la Gaspésie. Pour photographier plus de 80 000 kilomètres carrés de territoire, il utilise 2 hydravions Schreck FBA et installe une hydrobase principale à Gaspé et une hydrobase secondaire à Val-Brillant, sur les rives du lac Matapédia.
Le travail est risqué, il n'y a pas de cabine de pilotage, il n'y a pas les instruments de navigation ni les cartes d'aujourd'hui et le photographe devait accomplir son travail dans des conditions souvent périlleuses, en vent, avec un gros appareil dont le négatif est de 8 pouces par 10 pouces ... S'envolant le 18 octobre 1927, par un après-midi brumeux, de Gaspé à destination de Québec avec son mécanicien Théodore Chichenko, Jacques de Lesseps ne parvient pas à destination. Le pilote et son copilote ont péri au large de Baie-des-Sables. À partir du 20 octobre, d'importants débris de l'avion, sauf le moteur, sont retrouvés sur le rivage et en mer, surtout entre Baie-des-Sables et Sainte-Félicité, 50 kilomètres en aval. Le corps de Jacques de Lesseps est trouvé le 5 décembre, à Port-au-Port, à Terre-Neuve. Celui de Chichenko n'a jamais été revu. Selon ses volontés, de Lesseps a été inhumé à Gaspé le 14 décembre 1927. En 1932, on lui érige un monument dans cette ville.
23:27 Publié dans espace, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 19 mai 2010
Balades dans Paris : la rue Volta
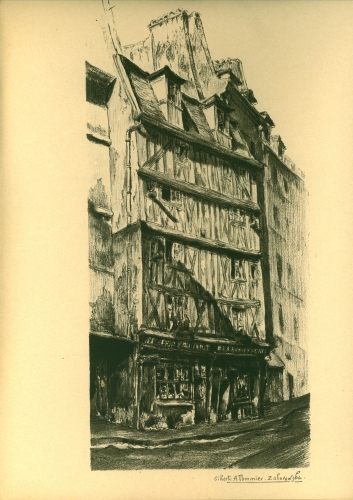 Poursuite de ma promenade dans le Marais, au fil des lithographies de Gilberte A. Pomier-Zaborowska.
Poursuite de ma promenade dans le Marais, au fil des lithographies de Gilberte A. Pomier-Zaborowska.
L'une d'elle concerne une vieille maison de la rue Volta, situé au numéro 3, presque à l'angle de la rue au Maire, point de départ donc de ma balade d'aujourd'hui.
La rue Volta est une rue située dans le quartier du Marais dans le 3e arrondissement de Paris. Elle résulte de la fusion en 1851, de trois rues, sous le nom du physicien italien Alessandro Volta : la rue Frépillon, la rue de la Croix et la rue du Pont-aux-Biches. Elle part de la rue au Maire, qui existait au XIIIème siècle. La rue Frépillon (1269) allait de la rue au Maire à la rue Phélippeaux (Réaumur). La rue de la Croix, du XIVème siècle, allait de la rue Phélippeaux à la rue du Vertbois, et la rue du Pont-aux-Biches (1520) allait de la rue du Vertbois à la rue Notre-Dame-de-Nazareth.
On a longtemps pensé que la maison du n°3, d'allure médiévale, était la plus vieille maison de Paris. En effet, une date repeinte sur la maison faisait remonter cette origine à 1242, et la légende dit que "le garde des chasses de Saint-Louis l'aimait habiter". Il a fallu attendre 1979 pour qu'une historienne dissipe cette légende. Cette maison a été en fait édifiée en 1644 par un bourgeois parisien. C'est une maison en pan de bois ou "en colombage" et à margelle de pierre. La construction de ce type de maisons était en effet interdite au 17ème siècle, mais l'interdiction semble avoir été inopérante. En fait sauf nouvelle surprise, la plus ancienne maison de Paris se trouve non loin de là, celle de Nicolas Flamel au 51 rue de Montmorency (1407).
 Le n°5 possède une porte et des ferrures assez intéressantes.
Le n°5 possède une porte et des ferrures assez intéressantes.
Au n°16, une maison du XVIIème siècle était à l'enseigne du Lion d'Or. Dans le cabaret du rez-de-chaussée de cette maison aurait été préparée l'insurrection du 5 juin 1832, tentative des Républicains de renverser la monarchie de Juillet immortalisée par Victor Hugo dans les Misérables.
Au n°37, on trouve le Théâtre du Marais, dont je reparlerai une autre fois ...
Mais tout d'abord un peu d'histoire ... Avant 1851, une partie de la rue s'appelait "rue Frépillon", du nom d'un village aux confins de la vallée de Montmorency et de la Vallée de l'Oise. On trouve trace de plusieurs seigneurs de Frépillon, et peut être l'un d'eux possédait-il un Hôtel particulier à Paris ? C'est cette explication qu'avance l'abbé Lebeuf en 1755: "Il est assez probable que la rue de Frépillon, à Paris, attenait à l'hôtel qu'habitaient en hiver les suzerains du village".
Selon Jean-Aymar Piganiol de la Force dans Description de la ville de Paris et de ses environs, paru en 1742, "La rue Frepillon avoit nom anciennement, selon Sauval, la rue Ferpillon ou Ferpeillon, et en 1269, vicus Ferpillonis. Elle aboutit à la rue Au-Maire & à celle de la Croix".(pdf ici)
En 1822, J.B De Saint Victor, dans son "tableau historique et pittoresque de Paris depuis les gaulois jusqu'à nos jours" reprend ces explications : "Elle fait la continuation de la rue de la Croix, et aboutit au cul-de-sac de Rome et à la rue au Maire. Elle doit son nom à celui d'une famille qui demeuroit dans cette rue au treizième siècle. Dans un acte de 1269 , elle est nommée vicus Ferpillonis; rue Ferpillon en 1282 ; vicus Ferpillionis dans le terrier de Saint-Martin-des-Champs, de 1300. Depuis ce temps ce nom a été altéré par le peuple ou par les copistes , et l'on a écrit Ferpeillon, Serpillon, Frepillon, Fripilon , etc.
En tous les cas, entre 1256 et 1278, les seigneurs de Frépillon se dessaisissent de leurs propriétés au profit des abbesses de l'abbaye de Maubuisson, dont nous avons vu qu'elles avaient une maison de ville dans la rue des Barres ... est-ce à cette époque qu'ils auraient eux aussi emménagé dans la capitale ?
Le site de l'Association pour la promotion de l'histoire et du patrimoine de la vallée de Montmorency, où se situe cette commune d'environ 2 300 habitants, nous raconte l'histoire de cette rue de Paris, que je retranscris ici :
"Cette voie doit être située dans l'environnement géographique et historique de l'abbaye de Saint-Martin des Champs : "L'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, où, depuis 1798, est établi le Conservatoire des Arts et Métiers, présente encore quelques restes remarquables de l'architecture du Moyen-Âge, échappés, comme par miracle, à toutes les causes de destruction qui ont privé Paris d'un si grand nombre de ses antiques monuments.
L'origine de ce monastère est imparfaitement connue. On sait seulement que, des le commencement du VIIIe siècle, il existait, près des murs de Paris, et probablement sur l'emplacement du Conservatoire, une église dédiée à saint Martin. Elle est qualifiée de basilique dans une charte de Childebert III, datée de l'année 710. Mais ce mot de basilique s'appliquait alors indifféremment à tous les édifices religieux. C'était dans le Moyen-Âge une opinion accréditée, et la pieuse tradition s'est conservée jusqu'à nos jours, que cette église avait été élevée au lieu même où, selon la légende, saint Martin guérit miraculeusement un lépreux, en lui donnant un baiser (...)
Le prieur Hugues, ou Eudes, qui administra le couvent vers le commencement du XIIe siècle, perfectionna ou refit l'enceinte fortifiée. Il enveloppa l'enclos, qui contenait environ quatorze arpents, d'un fossé et d'une muraille crénelée et flanquée de tours. En 1282, une chaussée nouvelle, qui devint la rue Frépillon, entama l'enclos du côté de l'Est, et l'on construisit alors un mur en pierre de taille pour le fermer" (Audiganne, P. Bailly, Eugène Carissan, Paris dans sa splendeur : Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Histoire de Paris. Environs de Paris, Paris, Charpentier, 1861 pages 40 à 42)
Avec le développement du Paris intra muros, le quartier change considérablement de physionomie au XIVe siècle, mais l'abbaye résiste, et la rue Frépillon également :
"Bientôt, une pléthore nouvelle se faisant sentir, les remparts de la Ville furent encore une fois reculés, les portes Saint-Martin et Saint-Denis se trouvèrent reportées en 1356, sous Charles V, à peu près à leur emplacement actuel.
A cette époque l'abbaye était limitée par les rues Saint-Martin à l'ouest, du Gaillard Bois au nord, de la Croix, Frépillon, du Puits de Rome à l'est, et la rue Aumaire au sud".(Amédée Gabillon, Le quartier des Arts et Métiers : conférence historique faite le 20 mai 1911, Paris, 1911, P. Collemant , pp. 22-23)
En 1712, le rempart crénelé apparaît inutile aux religieux : ils l'abattent pour élever à la place des maisons de location.
En mars 1848, trois ans avant sa disparition, la rue Frépillon se signale par la fondation au numéro 24, d'un Club de la Montagne, sous la présidence d'un certain abbé Constant. Voici comment un chroniqueur, manifestement orienté, le présente, dans un ouvrage consacré aux nombreux clubs qui foisonnent à Paris à cette époque :
" Réunion de bas-bleus crottés, de fous socialistes et de démocrates de ruisseau qui siégeaient dans la salle enfumée d'un marchand de vin, devant des tables couvertes de nappes maculées, entre des pots de vin bleu et des pipes culottées. Dans la salle du club de la rue Frépillon, les cinq sens étaient à la fois également blessés : on y buvait du vin détestable et de l'eau-de-vie frelatée, on y respirait les odeurs les plus nauséabondes. Il fallait, une fois qu'on était entré dans ce lupanar démocratique et social, se résigner à entendre des théories et des déclamations contre la société qui auraient trouvé des contradicteurs au bagne de Brest. Les assistants, à quelques rares exceptions près, étaient couverts des ces haillons sordides, qui ne sont pas la livrée de la pauvreté honnête et laborieuse, mais bien celle de la débauche ignoble.
Nous avons entendu le citoyen abbé Constant prononcer dans son club ces atroces paroles : "Nous ferons bouillir le sang des aristocrates dans les chaudières de la Révolution et nous en ferons du boudin pour rassasier tes prolétaires affamés."
Ce citoyen Constant a été condamné, le 11 mai 1841, à huit mois de prison et 300 fr. d'amende, pour outrage à la morale publique et atteinte à la propriété ; le 8 février 1847, à un an de prison et 1,000 fr. d'amende pour délits semblables" (Alphonse Lucas, Les clubs et les clubistes : histoire complète critique et anecdotique des clubs et des comités électoraux fondés à Paris depuis la révolution de 1848 : déclarations de principes, règlements, motions et publications des sociétés populaires, Paris, E. Dentu, 1851, page 183)
Un an plus tard, la rue Frépillon s'illustre lors de la manifestation du 13 juin 1849, qui est la dernière "journée révolutionnaire" de la IIe République. Il s'agit, à l'origine, d'une manifestation de protestation contre la politique menée par le gouvernement à Rome, organisée par l'extrême gauche de l'Assemblée Nationale autour de Ledru-Rollin, à savoir "la Montagne", qui compte alors 124 députés. Des barricades sont élevées dans un certain nombre de rues de Paris, dont la rue Frépillon. Une charge de grenadiers enlève la barricade en faisant trois morts parmi les insurgés. L'affaire est relatée à l'Assemblée nationale lors de sa séance du 10 juillet :
"Le Citoyen Sautayra : Dans la rue Frépillon, une barricade avait été élevée derrière le Conservatoire des arts et métiers. Le général Cornemuse la fait attaquer par une compagnie de grenadiers du 21e de ligne. Son commandant, le capitaine Bayard, sans s'inquiéter d'un feu très vif de mousqueterie dirigé contre lui des maisons voisines, lance sa troupe au pas de course, et enlève la barricade, où trois insurgés sont tués. Les autres prennent la fuite.
Je ne puis trop louer l'élan que la compagnie de grenadiers a montré à cette attaque. Le capitaine Bayard mérite aussi les plus grands éloges. Car non seulement il a réussi, mais, par la promptitude de son mouvement, il a su ménager le sang de ses soldats, dont pas un n'a été atteint. »
Permettez-moi de vous faire remarquer une chose, nous l'avons malheureusement vue l'année dernière : c'est que, lorsqu'une barricade est attaquée, il faut verser beaucoup de sang avant d'arriver de l'autre côté...
Citoyen Baraguey d'Hilliers : Lorsqu'elle est défendue !
Le Citoyen Sautayra : Lorsqu'elle est défendue, bien entendu. C'est un lapsus, et je remercie l'honorable général de son observation.
Je ne comprends pas comment on a pu supposer qu'une barricade avait été vaillamment défendue, surtout défendue par les fenêtres des maisons voisines, lorsque pas un des assaillants n'a été atteint, tandis que trois de ceux qui la défendaient ont été tués. Vous le savez, ceux qui sont derrière les barricades ont bien plus d'avantage pour se défendre, que ceux qui sont devant". (Compte rendu des séances de l'Assemblée nationale 1848-1849, séance du 10 juillet 1849, p. 572.)
La rue Frépillon disparaît en 1851 lors des grands travaux du Baron Haussmann : en fusionnant avec les rues de la Croix et du Pont-aux-Biches, elle donne lieu à la rue Volta, du nom du physicien italien Alessandro Volta. Toutefois, jusqu'à une date indéterminée, subsistera un passage Frépillon, donnant dans cette rue. Il s'agit, en fait, de l'ancien passage de la Marmite, qui doit son nom à l'enseigne d'un petit restaurant pour les ouvriers du quartier. Ce passage Frépillon est signalé dans le roman policier d'Emile Gaboriau, Monsieur Lecoq (1861), dans lequel le personnage principal personnage est poursuivi par les gardes et leur échappe de justesse : "Au passage Frépillon, son salut ne tint qu'à un fil".
 Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'ancienne rue de la Croix, mais divers plans du XVIIIème siècle montrent que cette rue longeait le couvent des religieuses du Tiers ordre de saint François dites "Filles de Sainte Elisabeth", qui avaient reçu quelques donations dans ce quartier, près du couvent des Pères de Nazareth, qui étaient du même ordre, et qui furent reconnues par Louis XIII par des lettres-patentes en 1614. Elles ont été établies rue du Temple en 1616 par Marie de Médicis. Celle-ci posa la première pierre de leur église, dédiée à Sainte Elisabeth de Hongrie, et de leur monastère le 14 avril 1628. Les religieuses, qui logeaient alors rue Neuve-Saint-Laurent, dans un hospice prété par les Pères de Nazareth, s'y installèrent en 1630. Les travaux de l'église furent réalisés par l'architecte Louis Noblet jusqu'en 1631, puis par Michel Villedo de 1643 à 1646. Elle fut consacrée le 14 juillet 1646 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. En 1792, l'église est transformée en entrepôt de fourrage sous la Révolution. Elle est rendue au culte en 1802 avec le Concordat. Le monastère servait alors de pensionnat de jeunes filles qui portaient alors un uniforme noir et payaient 500 livres de pension
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur l'ancienne rue de la Croix, mais divers plans du XVIIIème siècle montrent que cette rue longeait le couvent des religieuses du Tiers ordre de saint François dites "Filles de Sainte Elisabeth", qui avaient reçu quelques donations dans ce quartier, près du couvent des Pères de Nazareth, qui étaient du même ordre, et qui furent reconnues par Louis XIII par des lettres-patentes en 1614. Elles ont été établies rue du Temple en 1616 par Marie de Médicis. Celle-ci posa la première pierre de leur église, dédiée à Sainte Elisabeth de Hongrie, et de leur monastère le 14 avril 1628. Les religieuses, qui logeaient alors rue Neuve-Saint-Laurent, dans un hospice prété par les Pères de Nazareth, s'y installèrent en 1630. Les travaux de l'église furent réalisés par l'architecte Louis Noblet jusqu'en 1631, puis par Michel Villedo de 1643 à 1646. Elle fut consacrée le 14 juillet 1646 par Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors coadjuteur de l'archevêque de Paris. En 1792, l'église est transformée en entrepôt de fourrage sous la Révolution. Elle est rendue au culte en 1802 avec le Concordat. Le monastère servait alors de pensionnat de jeunes filles qui portaient alors un uniforme noir et payaient 500 livres de pension
Quand à l'ancienne rue du Pont aux Biche, elle doit son nom à un pont sur l'égout qui longeait autrefois la rue Notre-Dame de Nazareth, sans doute l'égout Saint-Martin à ciel ouvert jusqu'en en 1605, et peut être à une enseigne représentant des biches. En effet les égouts sont longtemps à ciel ouvert. Les premiers égouts à fossés ouverts apparaissent au XIVe siècle. Rive droite, le grand égout suit un ancien cours de la Seine, au pied des collines au nord de la ville, cours emprunté un temps par "Ru de Ménilmontant" qui reçoit plusieurs ruisseaux descendants des buttes de Belleville et de Ménilmontant ainsi que les eaux de plusieurs égouts distribués dans les différents quartiers. Il se jette dans la Seine à hauteur du Pont de l'Alma. D'autres égouts descendent également vers la Seine, drainant sa rive nord. Dès 1720, on commencera de paver et voûter la partie du grand égout découvert, et en 1737, commenceront les travaux définitifs pour canaliser et finalement de couvrir l'égout tout entier.
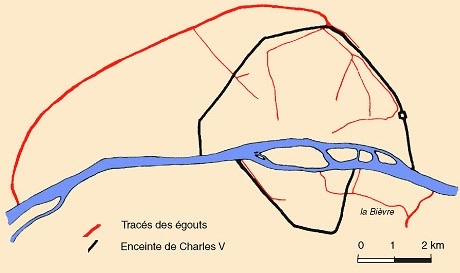
 Une ordonnance du 9 août 1698 nous apprend que des chiffonniers vivaient là, avec jusqu'à 300 chiens, dont les divagations et les aboiements gênent jour et nuit les habitants. En effet, en plus de leur activité de collecte de chiffons et débris divers, les chiffonniers sont souvent aussi écorcheurs de chevaux, de chats et de chiens, avec la graisse desquels ils fabriquent du suif destiné aux "chandeliers - ciriers - huiliers", ou encore du noir animal (ou charbon d'os) utilisé comme engrais ou comme pigment noir. Ils infligent donc aussi au quartier des puanteurs que l'ordonnance qualifie d'"excessives". Une ordonnance du 10 juin 1701 tente vainement de réglementer l'activité des chiffonniers qui sont désormais autorisés à n'avoir qu'un seul chien ! Ordonnance jamais appliquée, puisqu'une sentence du 18 juillet 1727 les condamne car "ils amassent les cuirs des bêtes qu'ils égorgent sans la précaution de les saler, en sorte qu'en peu de jours, les vers s'y mettent, gagnent les maisons voisines et causent des incommodités inexprimables" (source : Essai sur l'ordure en milieu urbain à l'époque pré-industrielle par Pierre-Denis Boudriot)
Une ordonnance du 9 août 1698 nous apprend que des chiffonniers vivaient là, avec jusqu'à 300 chiens, dont les divagations et les aboiements gênent jour et nuit les habitants. En effet, en plus de leur activité de collecte de chiffons et débris divers, les chiffonniers sont souvent aussi écorcheurs de chevaux, de chats et de chiens, avec la graisse desquels ils fabriquent du suif destiné aux "chandeliers - ciriers - huiliers", ou encore du noir animal (ou charbon d'os) utilisé comme engrais ou comme pigment noir. Ils infligent donc aussi au quartier des puanteurs que l'ordonnance qualifie d'"excessives". Une ordonnance du 10 juin 1701 tente vainement de réglementer l'activité des chiffonniers qui sont désormais autorisés à n'avoir qu'un seul chien ! Ordonnance jamais appliquée, puisqu'une sentence du 18 juillet 1727 les condamne car "ils amassent les cuirs des bêtes qu'ils égorgent sans la précaution de les saler, en sorte qu'en peu de jours, les vers s'y mettent, gagnent les maisons voisines et causent des incommodités inexprimables" (source : Essai sur l'ordure en milieu urbain à l'époque pré-industrielle par Pierre-Denis Boudriot)
Plus tard ces "biffins" se regrouperont dans la "zone", no man's land inconstructible, de 300 mètres de large qui entoure Paris au-delà des fortifications de Thiers laissées à l'abandon. C'est à cette zone que Eugène Atget, photographe infatigable de Paris, s'est intéressé à la zone au tournant du XXème siècle.
Le ..atalagueille
J'achepte vieur fer : vieur drapeaur
Aussi la mesnagere sage
En ramassant petis lambeaur
Fait tout servir a son mesnage.
Cris de Paris, vers 1500.
01:03 Publié dans balade, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 14 mai 2010
Balades dans Paris : la Rue des Barres et la rue du Grenier sur l'eau
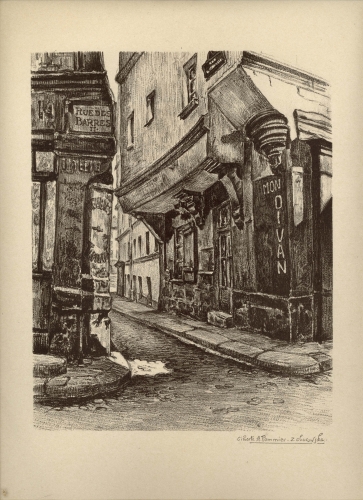 Commençons notre balade par l'un des endroits les plus romantiques du Marais et de Paris, les rues des Barres et Grenier sur l'eau !
Commençons notre balade par l'un des endroits les plus romantiques du Marais et de Paris, les rues des Barres et Grenier sur l'eau !
Pourquoi les "Barres" ? Une des premières possessions du Temple dans la capitale fut un moulin situé sous le Grand-Pont, avec une maison au-dessus, que légua à l'Ordre des Templiers une noble dame nommée Genta ou La Gente, moyennant trente livres versés chaque année au chapitre de Notre Dame. L'acte qui constate cet accord ne porte pas de date, mais il parait avoir été rédigé avant 1170, plutôt e 1137 ou 1147. Un peu plus tard, les Templiers possédaient également trois moulins, appelés "moulins des Barres"ou encore "moulins de Grève, "moulins assis sous Saint-Gervais", sur lesquels ils prélevaient les droits de mouture et droits de fournage.
En 1252, les templiers possédaient aussi une grange aux Barres", on en voit mention dès 1233, "granchia Templi de Barris, in censiva Templi". C'est peut-être une dépendance pour les arrivages par la rivière. En 1293, "en la rivière de Seine, au quay du Temple", un accord est passé entre le prévôt de la marchandise de l'eau et les échevins de la ville de Paris d'une part, et les chevaliers du Temple, pour leurs moulins au Pont de Grève. Ils s'engageaient à faire un pont de bois avec autant d'arches qu'il serait jugé nécessaire, et de payer 6 deniers chaque année au parloir aux Bourgeois
 Mais pourquoi ce nom de "barres" ? Ce nom donné à la rue et aux moulins, et peut être aussi aux terrains alentour, pourrait venir de l'enceinte du XIème siècle. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Marquis de Rochegude, dans un ouvrage "Promenades dans toutes les Rues de Paris (origines des rues, maisons historiques ou curieuses, anciens et nouveaux hôtels, enseignes), paru en 1910 Il écrit que le nom vient de ce que des barres étaient placées autrefois sur le sentier jusqu'à sa descente à la Seine par les officiers des Aides (ou "Aydes") et de la gabelle, sans doute pour empêcher les fraudeurs de passer inaperçus.
Mais pourquoi ce nom de "barres" ? Ce nom donné à la rue et aux moulins, et peut être aussi aux terrains alentour, pourrait venir de l'enceinte du XIème siècle. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Marquis de Rochegude, dans un ouvrage "Promenades dans toutes les Rues de Paris (origines des rues, maisons historiques ou curieuses, anciens et nouveaux hôtels, enseignes), paru en 1910 Il écrit que le nom vient de ce que des barres étaient placées autrefois sur le sentier jusqu'à sa descente à la Seine par les officiers des Aides (ou "Aydes") et de la gabelle, sans doute pour empêcher les fraudeurs de passer inaperçus.
 La rue des Barres, qui relie aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville à la rue François Miron, est donc l'ancienne ruelle aux Moulins des Barres, qui descendait d'une petite butte vers les berges verdoyantes de la Seine, vers des moulins situés sur la rivière à cet endroit qu'on appelait donc "les Barres", et elle date de 1250. Cette petite éminence, qu'on appelait anciennement monceau (moncellum), surplombait les marécages, ce qui avait permis aux pêcheurs, mariniers de l'époque gallo-romaine de venir s'installer ici. Dès le IIe siècle, une nécropole avait été construite sur le versant nord du monticule, puis au VIe siècle, les chrétiens, sur le même emplacement, avaient construit une chapelle funéraire dédiée aux martyrs Gervais et Protais, d'où le nom de "monceau Saint Gervais" qui sera donné vers 1680 à tout le quartier. Ce lieu était à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste.
La rue des Barres, qui relie aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville à la rue François Miron, est donc l'ancienne ruelle aux Moulins des Barres, qui descendait d'une petite butte vers les berges verdoyantes de la Seine, vers des moulins situés sur la rivière à cet endroit qu'on appelait donc "les Barres", et elle date de 1250. Cette petite éminence, qu'on appelait anciennement monceau (moncellum), surplombait les marécages, ce qui avait permis aux pêcheurs, mariniers de l'époque gallo-romaine de venir s'installer ici. Dès le IIe siècle, une nécropole avait été construite sur le versant nord du monticule, puis au VIe siècle, les chrétiens, sur le même emplacement, avaient construit une chapelle funéraire dédiée aux martyrs Gervais et Protais, d'où le nom de "monceau Saint Gervais" qui sera donné vers 1680 à tout le quartier. Ce lieu était à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste.
En 1293, la ruelle aux Moulins des Barres devient ruelle des Moulins du Temple. En 1362, on lui donne, dans un titre passé sous le règne de Charles V; la dénomination de rue qui va de la Seine à la porte Baudet et, en 1386, de rue du Chevet de Saint-Gervais, et parfois rue des Barres. Au XVIe siècle, c'était la rue Malivaux; du nom des moulins de Malivaux, placés sur la rivière, en face de cette rue. Mais ce n'était qu'une la partie de la rue qui portait ce nom, celle du côté de la rue Saint Antoine (maintenant rue François-Miron dans cette partie) était confondue avec la rue du Pourtour, alors appelée rue du Cimetière Saint Gervais. Enfin, au XVIIe siècle, dans toute sa longueur, c'était de nouveau la rue des Barres.
Une décision ministérielle, en date du 13 thermidor an VI, signée François de Neufchâteau, fixe la largeur de cette voie publique à 8 m. En vertu d'une ordonnance royale du 19 mai 1838, sa moindre largeur devait être portée à 10 m. Seules quelques maisons ont été "alignées".
 L'Hôtel des Barres fut bâti vers 1269. En 1362, les moines de Saint-Maur l'achetèrent ainsi que les moulins à eau des Barres, qui en dépendaient. Il prit le nom d'Hôtel de Saint-Maur.
L'Hôtel des Barres fut bâti vers 1269. En 1362, les moines de Saint-Maur l'achetèrent ainsi que les moulins à eau des Barres, qui en dépendaient. Il prit le nom d'Hôtel de Saint-Maur.
Cet hôtel fut habité plus tard par Louis de Boisredon, écuyer et amant d'Isabeau de Bavière. Celle-ci distribuait à ses "admirateurs" tout ce que ceux-ci exigeaient, et Louis de Boisredon avait les dents longues ! Cette aventure se termina par un drame : en 1417, le comte d'Armagnac, excédé des bavardages de la Cour et de la ville, révéla au roi Charles VI la conduite de la reine. Après avoir fait appeler le dauphin qui confirma les dires du connétable, le souverain donna l'ordre à Tanneguy Duchâtel, prévôt de Paris, de se saisir du capitaine. Ce dernier fut condamné à mort. On l'enferma dans un sac de cuir sur lequel étaient inscrits ces mots : "Laissez passer la justice du Roi". Le tout fut jeté dans la Seine. Quant à Isabeau, elle ne put échapper à la relégation. Le couvent de Marmoutiers lui servit de résidence surveillée
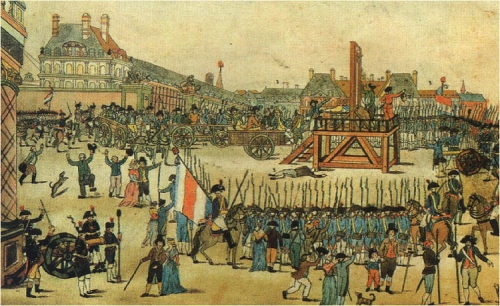 Cet Hôtel devint par la suite propriété des seigneurs de Charni, qui lui donnèrent leur nom (à ne pas confondre cependant avec le Grand et le Petit Hôtel de Charny, dans la rue Beautreillis). On y avait établi, vers la fin du XVIIIème siècle, le bureau de l'administration des aides, avant qu'il ne soit transféré rue de Choiseul juste avant la révilution Dans cet Hôtel de Charni siégeait, en 1793, le Comité civil de la Section de la Commune. C'est là que, le 10 thermidor, à 2heures du matin, Augustin de Robespierre dit Le Jeune, qui venait de se jeter d'une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, fut transporté sanglant. Il y fut pansé, puis transféré au Comité de Salut public, d'où on le conduisit à l'échafaud, le 28 juillet 1794, avec son frère Maximilien, et plusieurs membres de la convention et de la commune mis hors la loi. Cette habitation servit ensuite à la justice de paix de l'arrondissement, et devint plus tard une propriété particulière portant le n°4 La plus grande partie de cet hôtel a été démolie pour livrer passage à la rue du Pont-Louis-Philippe.
Cet Hôtel devint par la suite propriété des seigneurs de Charni, qui lui donnèrent leur nom (à ne pas confondre cependant avec le Grand et le Petit Hôtel de Charny, dans la rue Beautreillis). On y avait établi, vers la fin du XVIIIème siècle, le bureau de l'administration des aides, avant qu'il ne soit transféré rue de Choiseul juste avant la révilution Dans cet Hôtel de Charni siégeait, en 1793, le Comité civil de la Section de la Commune. C'est là que, le 10 thermidor, à 2heures du matin, Augustin de Robespierre dit Le Jeune, qui venait de se jeter d'une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, fut transporté sanglant. Il y fut pansé, puis transféré au Comité de Salut public, d'où on le conduisit à l'échafaud, le 28 juillet 1794, avec son frère Maximilien, et plusieurs membres de la convention et de la commune mis hors la loi. Cette habitation servit ensuite à la justice de paix de l'arrondissement, et devint plus tard une propriété particulière portant le n°4 La plus grande partie de cet hôtel a été démolie pour livrer passage à la rue du Pont-Louis-Philippe.
 Au n° 12 de la rue des Barres, à l'angle de la rue du Grenier sur l'eau, en face du chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, on trouve une des rares maisons à colombages de Paris. Il s'agit de l'ancienne maison de ville de l'Abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, fondée par la reine Blanche de Castille (mère de Saint-Louis) en 1242. L'édifice actuel a été bâti vers 1540. Les religieuses, les Jeunes Filles de la Croix, s'y étaient établies dès 1664, bien qu'elles n'y fussent propriétaires qu'en vertu de lettres-patentes signées en juillet 1778. Ces dames, avaient pour mission de s'occuper de l'instruction religieuse des jeunes filles. Cette communauté, supprimée en 1790, devint propriété nationale et fut vendue le 16 vendémiaire an IV. Sur la façade qui donne du côté de la rue du Grenier-sur-l'eau, on peut admirer l'encorbellement monté sur des consoles massives. De telles avancées sur rue ont presque partout disparu (on en trouve aussi dans la rue des arbalétriers qui est situé à la limite du 4e arrondissement mais côté 3e). Elles étaient la règle au Moyen Âge car elles permettaient une utilisation intensive de l'espace urbain et de plus elles protégeaient de la pluie.
Au n° 12 de la rue des Barres, à l'angle de la rue du Grenier sur l'eau, en face du chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, on trouve une des rares maisons à colombages de Paris. Il s'agit de l'ancienne maison de ville de l'Abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, fondée par la reine Blanche de Castille (mère de Saint-Louis) en 1242. L'édifice actuel a été bâti vers 1540. Les religieuses, les Jeunes Filles de la Croix, s'y étaient établies dès 1664, bien qu'elles n'y fussent propriétaires qu'en vertu de lettres-patentes signées en juillet 1778. Ces dames, avaient pour mission de s'occuper de l'instruction religieuse des jeunes filles. Cette communauté, supprimée en 1790, devint propriété nationale et fut vendue le 16 vendémiaire an IV. Sur la façade qui donne du côté de la rue du Grenier-sur-l'eau, on peut admirer l'encorbellement monté sur des consoles massives. De telles avancées sur rue ont presque partout disparu (on en trouve aussi dans la rue des arbalétriers qui est situé à la limite du 4e arrondissement mais côté 3e). Elles étaient la règle au Moyen Âge car elles permettaient une utilisation intensive de l'espace urbain et de plus elles protégeaient de la pluie.
C'est cette maison que l'on peut voir sur la lithographie de Gilberte A. Pomier-Zaborowska. Comme durant une partie du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle, les façades de cette maison à pans de bois avaient été plâtrées afin de leur donner un aspect plus luxueux et moderne, et au rez-de-chaussée, elle abritait apparemment une boutique, ou plus sûrement un estaminet. La ville de Paris acheta le bâtiment en 1972. il a été restauré, les colombages ont été remis à nu, et elle accueille aujourd'hui la MIJE (Maison Internationale de la Jeunesse et des Etudiants). On y trouve des lits à prix défiant toute concurrence !!!
Au n° 15, on aperçoit à travers les grilles, un jardin sur l'emplacement de l'ancien charnier de Saint-Gervais., qui a été fermé en 1765. L'ancienne chapelle de la Communion, désaffectée a été occupée un temps par une maison de confiserie. C'est dans cette chapelle que fut sans doute enterré Philippe de Champaigne. D'une fenêtre de la confiserie on avait vue sur l'église et les charniers. L'architecte Albert Laprade restaura cet endroit entre 1943 et 1945, en y installant un jardin. Malheureusement, ce jardin n'est pas accessible, on peut juste photographier à travers les grilles.
 Au n°17, le motif central des balcons en fer forgé de toutes les fenêtres du premier étage rappelle l'orme de la place Saint-Gervais, mentionné pour la première fois en 1235, à l'occasion d'une vente et cité dans Le dit des rues de Paris, de Guillot vers 1310 : "Saint-Gervais et puis l'ourmetiau", preuve de son existence dès cette époque. En 1314, on le signale comme lieu de supplice : Philippe et Gauthier d'Aunay, accusés d'avoir entretenu des relations amoureuses avec les belles-filles de Philippe le Bel, furent suppliciés sous ses branches. Mais surtout l'Orme de Saint Gervais et Saint Protais était un lieu où venaient s'asseoir les juges "pédanés", qu'on appelait aussi "juges de dessous l'orme" les juges des seigneurs y tenaient leur juridiction et les vassaux venaient payer leurs créances "le jour de saint Rémy et à la saint Martin d'hiver". C'était aussi un lieu de réunion traditionnel des corporations, celle des Francs-Maçons, mais également les autres, les corporations pénitentielles ... Il y a tout lieu de penser que l'orme fut remplacé plusieurs fois. En 1787, Jaillot, historien de Paris, écrit d'ailleurs : "En face de l'église est un orme qu'on renouvelle de tems en tems." En effet, les estampes et manuscrits du XVIIè siècle ou du du XVIIIè siècle, il n'a guère plus de 7 à 8 mètres de haut et est toujours représente sur le parvis de l'église d'un muret de pierre.
Au n°17, le motif central des balcons en fer forgé de toutes les fenêtres du premier étage rappelle l'orme de la place Saint-Gervais, mentionné pour la première fois en 1235, à l'occasion d'une vente et cité dans Le dit des rues de Paris, de Guillot vers 1310 : "Saint-Gervais et puis l'ourmetiau", preuve de son existence dès cette époque. En 1314, on le signale comme lieu de supplice : Philippe et Gauthier d'Aunay, accusés d'avoir entretenu des relations amoureuses avec les belles-filles de Philippe le Bel, furent suppliciés sous ses branches. Mais surtout l'Orme de Saint Gervais et Saint Protais était un lieu où venaient s'asseoir les juges "pédanés", qu'on appelait aussi "juges de dessous l'orme" les juges des seigneurs y tenaient leur juridiction et les vassaux venaient payer leurs créances "le jour de saint Rémy et à la saint Martin d'hiver". C'était aussi un lieu de réunion traditionnel des corporations, celle des Francs-Maçons, mais également les autres, les corporations pénitentielles ... Il y a tout lieu de penser que l'orme fut remplacé plusieurs fois. En 1787, Jaillot, historien de Paris, écrit d'ailleurs : "En face de l'église est un orme qu'on renouvelle de tems en tems." En effet, les estampes et manuscrits du XVIIè siècle ou du du XVIIIè siècle, il n'a guère plus de 7 à 8 mètres de haut et est toujours représente sur le parvis de l'église d'un muret de pierre.
 Vers la fin du XVIIIe siècle, certains critiques demandèrent la mise à mort de cet arbre légendaire qui cachait la vue du portail. L'orage de 1789 allait essayer, lui aussi, de renverser l'orme légendaire. Le 1er ventôse an II (19 février 1794), la section de la Maison commune demanda sa mise à mort et "décida que cet emblème de la superstition serait abattu, que son tronc servirait à confectionner des affûts de canon et ses branches brûlées pour en faire du salpêtre". On ne sait pas quand la place Saint-Gervais perdit son orme. Certains prétendent qu'il fut abattu en 1811 ; Victor Hugo le cite, dans Les Misérables, comme étant encore debout en 1832. Il est possible cependant qu'il ait subsisté jusqu'en 1837. Quoi qu'il en soit, en 1847, le curé de la paroisse demande que les rangées de platanes qui se meurent autour de la place soient remplacées par un orme. Le souvenir de l'arbre légendaire fut conservé non seulement dans les appuis de fenêtre et dans les plaques de cheminées, mais aussi dans une enseigne provenant de la rue du Temple, aujourd'hui au Musée Carnavalet. Depuis l'orme de Saint-Gervais se dresse à nouveau : Le 10 mars 1914, un jeune plant de quinze ans, provenant des pépinières du Val-d'Aulnay-en-Châtenay fut fiché en terre devant la vieille église. L'orme actuel a, lui, été planté en 1936. Avant la Révolution, Pierre. Sue, "chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville", oncle d'Eugène Sue, aurait habité cette maison du n°17 ?
Vers la fin du XVIIIe siècle, certains critiques demandèrent la mise à mort de cet arbre légendaire qui cachait la vue du portail. L'orage de 1789 allait essayer, lui aussi, de renverser l'orme légendaire. Le 1er ventôse an II (19 février 1794), la section de la Maison commune demanda sa mise à mort et "décida que cet emblème de la superstition serait abattu, que son tronc servirait à confectionner des affûts de canon et ses branches brûlées pour en faire du salpêtre". On ne sait pas quand la place Saint-Gervais perdit son orme. Certains prétendent qu'il fut abattu en 1811 ; Victor Hugo le cite, dans Les Misérables, comme étant encore debout en 1832. Il est possible cependant qu'il ait subsisté jusqu'en 1837. Quoi qu'il en soit, en 1847, le curé de la paroisse demande que les rangées de platanes qui se meurent autour de la place soient remplacées par un orme. Le souvenir de l'arbre légendaire fut conservé non seulement dans les appuis de fenêtre et dans les plaques de cheminées, mais aussi dans une enseigne provenant de la rue du Temple, aujourd'hui au Musée Carnavalet. Depuis l'orme de Saint-Gervais se dresse à nouveau : Le 10 mars 1914, un jeune plant de quinze ans, provenant des pépinières du Val-d'Aulnay-en-Châtenay fut fiché en terre devant la vieille église. L'orme actuel a, lui, été planté en 1936. Avant la Révolution, Pierre. Sue, "chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville", oncle d'Eugène Sue, aurait habité cette maison du n°17 ?
Perpendiculaire à la rue des Barres, voilà la rue du Grenier sur l'eau. Rien à voir avec une grange ou un hangar ... c'est ruelle du XIIIème siècle qui doit son nom à son voisinage de la rivière et à un personnage nommé Garnier ou Guernier, bourgeois de Paris qui fit quelques donations au Temple en 1241 et qui y habitait. Ce nom propre est devenu ensuite par corruption Grenier. En 1257, elle s'appelait rue André-sur-l'Eau. On la trouve aussi désignée sous les noms de Garnier sur l'Yaue et Guernier sur l'Eau. En 1391, elle figurait dans les comptes relevés de la taille sous le nom de Garnier-sur-l'Eau, et deux contribuables y étaient signalés, Jacob de Marcilli pour une maison "qui fust aux Nonneardierre, depuis aux moines de Prully, depuis à Jacques Lenoble, tenant à la maison du coin de ladicte rue de vers Seine", et Raulin Petit "d'austre part de ladicte rue, maison à apentis." En1833, la rue a été coupée en deux par la rue du Pont-Louis-Philippe.
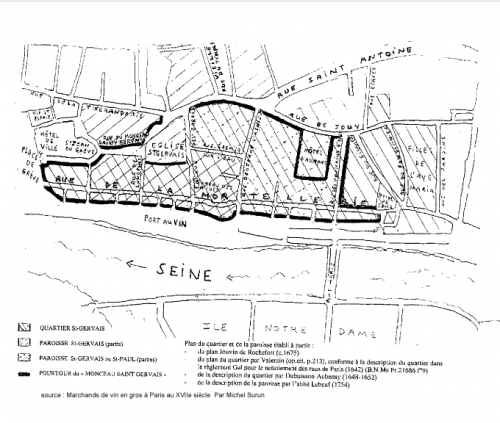 Un édit de Henri III de 1577 avait permis aux marchands de vins d'y établir le siège de leur corporation. Ces statuts ont été confirmés par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Blanchet Adam commence à y exercer vers 1595, et le "Monceau Saint Gervais" est cité officiellement dès 1680 comme lieu de tolérance au regard de la réglementation du commerce du vin, les "marchands de vin en gros du Monceau Saint Gervais" habitant et exerçant dans ce territoire à proximité immédiate du port de la vente au vin en grève.
Un édit de Henri III de 1577 avait permis aux marchands de vins d'y établir le siège de leur corporation. Ces statuts ont été confirmés par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Blanchet Adam commence à y exercer vers 1595, et le "Monceau Saint Gervais" est cité officiellement dès 1680 comme lieu de tolérance au regard de la réglementation du commerce du vin, les "marchands de vin en gros du Monceau Saint Gervais" habitant et exerçant dans ce territoire à proximité immédiate du port de la vente au vin en grève.
Sous Louis XIV, les marchands de vin eurent le siège de leur corporation dans la rue Grenier-sur-l'eau, au-dessus d'une cour de passage, formant ruelle, dont parle l'historien Henri Sauval (1623 - 1676) dans son Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, et qui menait à la rue aux Bretons. Leurs gardes et maîtres jouissaient des mêmes privilèges que ceux des six corps de marchands, et ils pouvaient remplir, par conséquent, les charges municipales et consulaires. Les armoiries qu'ils avaient obtenues en l'année 1629 comportaient principalement un navire à bannière de France, qui flottait entouré de six petites nefs, et une grappe de raisin en chef, sur champ d'azur. Au moment de la Révolution, le bureau se trouvait rue de la Poterie.
Au XVIe siècle, on trouve également des potiers dans la paroisse Saint-Gervais (cimetière Saint-Jean, rue du Grenier-sur-l'Eau), Saint-Paul (rue Saint-Antoine), Saint-Nicolas (rue aux Oies, rue des Gravilliers), et un four de potier, le seul actuellement connu pour la fin du Moyen Age à Paris, et une partie de sa production ont été mis au jour en 2001, lors de la fouille du Mémorial de la Shoah, allée des Justes de France, anciennement rue du Grenier-sur-l'Eau.. Une partie des actes notariés des notaires du quartier Saint-Gervais a été étudiée dans le but de retrouver le nom du ou des potiers qui ont travaillé dans cette rue.
Ainsi, les officines de potiers sont installées dans les rues proches de la Seine et du port de Grève où l'on pouvait s'approvisionner en bois. Ils sont également proches des Halles, principal lieu de vente. mais le four de la rue du Grenier-sur-l'Eau qui a cessé de fonctionner vers le milieu du XVIe siècle. Car les odeurs dues aux terres mises à pourrir, les fumées polluantes, les méfaits qui pourraient être occasionnés par l'emploi de plomb, de souffre et limaille, d'ocre et autres matériaux, et aussi la peur des incendies entraînent diverses procès et interdictions. Une lettre patente du 20 octobre 1563 du roi Charles IX vise à éloigner les industries polluantes comme la boucherie dans les faubourgs de la ville ; un édit du 21 novembre 1577 du roi Henri III homologue un Règlement de Police Générale pour les métiers et marchandises de la Ville de Paris et du royaume, et ordonne que "plus de tuileries ne seront construites dans l'intérieur de Paris". Comme le rappelle Lespinasse, à la fin du XIXe siècle, "... la salubrité de l'air, la pureté de l'eau, la bonté des aliments et des remèdes font les aspects immédiats des soucis de la santé publique. De là viennent les Ordonnances et les Règlements pour le nettoyement des rues, l'écoulement des inondations par les cloaques, et les décharges ... C'est sur ce motif que sont fondés les Règlements qui ordonnent que les tanneurs, les fours à cuire les poteries de terre, les teinturiers et les tueries des bestiaux seront éloignés du milieu des Villes"
Au lendemain de l'empire, le journaliste Auguste Vitu écrivait : "Pour sortir de la rue Geoffroy-l'Anier, qui n'a que huit mêtres de large et dont la perspective n'a rien d'engageant, les amateurs de pittoresque s'engageant dans la rue Grenier-sur-l'Eau, qui les mènera, à travers la rue des Barres, jusqu'au chevet de l'église Saint-Gervais. La rue Grenier-sur-l'Eau est si étroite qu'elle ne laisserait pas passer un chariot d'enfant, et n'est qu'une ruelle entre des murailles sans portes ni fenêtres, laissant à peine descendre le jour jusqu'au pavé glissant. Sa jonction avec la rue des Barres est pour ainsi dire bouchée par le surplomb d'une maison ancienne portée par des consoles et au-delà de laquelle on aperçoit l'abside de l'église Saint-Gervais (...) En quittant la rue des Barres, aussi sinistre d'aspect que placide en réalité, pour redescendre vers le quai de l'Hôtel-de -Ville, on revoit la clarté du jour, avec une satisfaction d'autant plus vive que, par la percée qui précède le pont Louis-Philippe, l'on aperçoit l'île Saint-louis, la montagne Sainte-Geneviève, et, à droite, la cathédrale de Paris" (Paris, Images et Traditions en 1889)
 Aujourd'hui, une partie de la rue Grenier-sur-l'Eau, piétonne et plantée d'une rangée d'arbres, s'appelle l'Allée des Justes. Elle longe le Mémorial de la Shoah, inauguré le 14 juin 2006, et s'y élève le Mur des Justes.
Aujourd'hui, une partie de la rue Grenier-sur-l'Eau, piétonne et plantée d'une rangée d'arbres, s'appelle l'Allée des Justes. Elle longe le Mémorial de la Shoah, inauguré le 14 juin 2006, et s'y élève le Mur des Justes.
20:23 Publié dans balade, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 13 mai 2010
Balades dans Paris : le Marais des Templiers
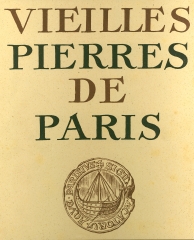 En vidant la maison de mes parents, j'ai trouvé un recueil de 20 lithographies en noir de Gilberte A. Pomier-Zaborowska, "vieilles pierres de Paris" sur quelques vestiges remarquables du quartier latin et du Marais, assorties d'une préface de Pierre Mornand, "conservateur adjoint de la Bibliothèque Nationale", et de commentaires historiques dont je ne sais s'ils sont de l'artiste ou de Pierre Mornand. Mes recherches sur des sites de librairies spécialisées situent ces tirages dans les années 1930 ou 1940.
En vidant la maison de mes parents, j'ai trouvé un recueil de 20 lithographies en noir de Gilberte A. Pomier-Zaborowska, "vieilles pierres de Paris" sur quelques vestiges remarquables du quartier latin et du Marais, assorties d'une préface de Pierre Mornand, "conservateur adjoint de la Bibliothèque Nationale", et de commentaires historiques dont je ne sais s'ils sont de l'artiste ou de Pierre Mornand. Mes recherches sur des sites de librairies spécialisées situent ces tirages dans les années 1930 ou 1940.
L'occasion donc d'une promenade dans l'un des plus anciens secteur préservé de Paris !
D'abord un peu d'histoire ? Fondé à Jérusalem, l'ordre des Templiers ne se composait que de 6 religieux et du grand maître, lorsqu'ils quittèrent la Palestine et se présentèrent en 1128, au Concile de Troyes. Le pape Honoré II les accueillit avec une bienveillance extrême et confirma alors la fondation de l'ordre. Les chevaliers du Temple voulaient établir à Paris le siège de leur puissance, mais l'époque où ils vinrent s'y établir n'est pas bien précisément connue. On croit généralement que c'est Louis VI de France, dit le Gros ou le Batailleur, qui avait donné aux Templiers une maison voisine de l'église Saint-Gervais dans laquelle ils s'installèrent ...
La Censive du Temple, appendice à la thèse de Henri de Curzon "La Maison du Temple de Paris", publiée à Paris en 1888, qui dénombre les possessions de l'Ordre dans la capitale à toutes les époques du Temple, nous apprend que "C'est aux Barres qu'eut lieu une des premières donations que nous connaissions, celle d'une maison "de Froger l'asnier", avec toute sa justice, faite en 1152 (ou 1132 ?) par le comte Mathieu de Beaumont". Cette maison devait faire partie de la terre et seigneurie de Reuilly, alors hors des murs de Paris, et sur laquelle se trouvaient de très anciens bâtiments accédant au réseau de drainage romain
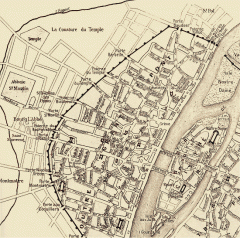 Au fil des acquisitions, les propriétés des Templiers occupaient une superficie de cent vingt à cent trente hectares et s'étendaient depuis l'entrée du faubourg du Temple jusqu'à la rue de la Verrerie. Elles englobaient le bourg Thibourg, une partie du "beaubourg" et des maisons éparses dans la campagne.
Au fil des acquisitions, les propriétés des Templiers occupaient une superficie de cent vingt à cent trente hectares et s'étendaient depuis l'entrée du faubourg du Temple jusqu'à la rue de la Verrerie. Elles englobaient le bourg Thibourg, une partie du "beaubourg" et des maisons éparses dans la campagne.
Au XIIIème siècle, les terres des templiers étaient coupées en 2 par l'enceinte de Philippe Auguste, construite entre 1190 et 1220. Deux portes faisaient communiquer les deux quartiers, celles dites du Temple et Barbette; une troisième, la poterne du Chaume, fut percée plus tard, à la demande des habitants, en 1287. Philippe le Hardi, par lettres-patentes de l'année 1279, reconnut à l'Ordre l'entière et libre disposition de ses biens avec la haute, moyenne et basse justice, pour toutes ses possessions en dehors de Paris, "depuis la porte ou poterne vulgairement nommée Barbette, comme les murs s'estendent jusques à la porte de la rue du Temple, jusques au fossé nommé vulgairement le fossé de Boucelle qui s'estend entre les Saulsoys de la rue du Temple et la terre de Unfroy Nuffle et de là, comme le fossé s'estend, jusques au coing de la Courtille Barbette, du costé des champs et de là suivant le chemin de Mesnil-Mautemps, jusques à la poterne Barbette." Quant aux possessions des Templiers à l'intérieur de Paris, Philippe le Hardi ne leur accorda que le droit de cens et celui de basse justice. La première maison des Templiers en faisaient partie ...
 La partie hors du rempart constituait l'enclos du Temple (la "coultoure" du Temple, ou la "couture", traduction du mot cotura pièce de terre). Les templiers y firent construire le "chef-lieu" de la "province" de France, la maison de l'ordre du Temple à Paris, sur d'anciens marécages, l'actuel quartier du Marais, qu'ils firent assécher. Cette commanderie et ses abords furent appelés la "Villeneuve du Temple" (depuis 1298) en opposition avec le Vieux Temple, la toute première maison que les Templiers possédèrent dans Paris (puis plus tard "le chantier de l'Hôpital" quand les biens des Templiers furent transmis aux Hospitaliers). Elle comprenait une chapelle, des bâtiments conventuels pour loger les moines-soldats, une cuisine, un réfectoire, un colombier, des écuries et divers bâtiments entourés de hautes murailles crénelées, renforcées de distance en distance par des tourelles. Ce système défensif était complété par une tour carrée, dite tour de César, et par un imposant donjon, la Tour du Temple construite à partir de 1240 sous le règne de Saint-Louis. A cela s'ajoutaient échoppes, jardins, vergers, vignobles et terres cultivées. En 1667, l'enclos du temple sera détruit et remplacé par des hôtels particuliers.
La partie hors du rempart constituait l'enclos du Temple (la "coultoure" du Temple, ou la "couture", traduction du mot cotura pièce de terre). Les templiers y firent construire le "chef-lieu" de la "province" de France, la maison de l'ordre du Temple à Paris, sur d'anciens marécages, l'actuel quartier du Marais, qu'ils firent assécher. Cette commanderie et ses abords furent appelés la "Villeneuve du Temple" (depuis 1298) en opposition avec le Vieux Temple, la toute première maison que les Templiers possédèrent dans Paris (puis plus tard "le chantier de l'Hôpital" quand les biens des Templiers furent transmis aux Hospitaliers). Elle comprenait une chapelle, des bâtiments conventuels pour loger les moines-soldats, une cuisine, un réfectoire, un colombier, des écuries et divers bâtiments entourés de hautes murailles crénelées, renforcées de distance en distance par des tourelles. Ce système défensif était complété par une tour carrée, dite tour de César, et par un imposant donjon, la Tour du Temple construite à partir de 1240 sous le règne de Saint-Louis. A cela s'ajoutaient échoppes, jardins, vergers, vignobles et terres cultivées. En 1667, l'enclos du temple sera détruit et remplacé par des hôtels particuliers.
Ce qui n'était pas resté en bois et jardins dans la "couture" ou dans les marais situés à l'est de l'Enclos était exploité comme cultures de rapport par des maraîchers et des jardiniers qui avaient fait des baux avec le grand prieur. On leur permit d'abord d'y bâtir quelques constructions légères pour leur usage, sous condition de les enlever à la fin de leur bail; plus tard, au XVIIe siècle, ils obtinrent de se faire de vraies petites maisons, parce que les baux étaient à très long terme. Mais dès le XVIe siècle on avait commencé de remplacer une partie des terrains cultivés par des maisons de rapport, et substitué les baux à cens et rentes aux baux à ferme.
 Sous Charles V, Paris s'agrandit et une nouvelle enceinte absorba pratiquement tout domaine, y compris l'"Enclos du Temple".
Sous Charles V, Paris s'agrandit et une nouvelle enceinte absorba pratiquement tout domaine, y compris l'"Enclos du Temple".
Mais les plus grands changements eurent lieu sous le règne d'Henri IV, qui "choisit, entre autres, les terrains qui dépendaient de l'Enclos à l'est, pour y percer tout un quartier neuf. Cette partie de la censive propre du Temple rapportait peu, et le grand prieur n'eut pas de peine à obtenir du grand maître de l'Ordre l'autorisation de l'aliéner à l'Etat. La vente était stipulée à raison de 44 000 livres pour le prieuré, et 8000 livres pour désintéresser les locataires actuels. Il était entendu, de plus, que l'Ordre conservait le cens annuel sur les habitants, et que les nouvelles rues demeuraient "perpétuellement en la haute, moyenne et basse justice et voierie du Temple, sujettes à confiscations, aubaines, déshérences et autres droits seigneuriaux". L'acte est daté du 29 décembre 1608. L'entrepreneur inscrit en nom, comme acheteur, un certain Michel Pigoux, devait s'occuper de faire percer les rues selon les plans qui lui seraient remis par Sully, grand voyer, tout en se conformant aussi aux alignements tracés par le voyer du Temple.
 "Le plan consistait en une place demi-circulaire dite de France; la partie droite était fermée par les remparts de la ville, et communiquait avec le dehors par une porte monumentale dite aussi de France, ouvrant entre deux corps de bâtiments, avec une halle et un marché. La place avait, dans le projet, les dimensions de 40 toises sur 80, et 139 de circonférence (78 mètres sur 156 et 271,05) ; elle était ornée de sept pavillons à portiques et à trois étages, flanqués de tourelles aux angles. Entre ces pavillons s'ouvraient huit larges rues, désignées par des noms de provinces, et qu'un cercle de sept autres rues devait, plus loin, traverser et faire communiquer entre elles. Henri IV autorisa ce plan par lettres du 7 janvier 1609, homologuées au Parlement le même mois, et les travaux commencèrent. Mais la mort du roi vint tout interrompre. On renonça à la place et à la porte de ville, mais plusieurs des rues projetées étaient déjà percées, d'autres suivirent sur un autre plan, et toutes se garnirent peu à peu de maisons neuves. Toutefois le lieu resta longtemps assez désert pour que les habitants, au témoignage de Sauval (en 1626), fissent fermer la nuit leurs rues par des chaînes.
"Le plan consistait en une place demi-circulaire dite de France; la partie droite était fermée par les remparts de la ville, et communiquait avec le dehors par une porte monumentale dite aussi de France, ouvrant entre deux corps de bâtiments, avec une halle et un marché. La place avait, dans le projet, les dimensions de 40 toises sur 80, et 139 de circonférence (78 mètres sur 156 et 271,05) ; elle était ornée de sept pavillons à portiques et à trois étages, flanqués de tourelles aux angles. Entre ces pavillons s'ouvraient huit larges rues, désignées par des noms de provinces, et qu'un cercle de sept autres rues devait, plus loin, traverser et faire communiquer entre elles. Henri IV autorisa ce plan par lettres du 7 janvier 1609, homologuées au Parlement le même mois, et les travaux commencèrent. Mais la mort du roi vint tout interrompre. On renonça à la place et à la porte de ville, mais plusieurs des rues projetées étaient déjà percées, d'autres suivirent sur un autre plan, et toutes se garnirent peu à peu de maisons neuves. Toutefois le lieu resta longtemps assez désert pour que les habitants, au témoignage de Sauval (en 1626), fissent fermer la nuit leurs rues par des chaînes.
En 1695, le roi Louis XIV ordonna au prévôt des marchands et aux échevins de reprendre les travaux des nouveaux remparts. L'emplacement que ces remparts devaient occuper du côté du Temple ne consistait encore qu'en terrains vagues. La Maison en possédait 4580 toises, qui furent rachetées par la Ville dans les conditions suivantes : On laissait une bande de 1480 toises le long des murs de l'Enclos, afin de l'isoler entièrement; et de plus le prévôt s'engageait à faire combler le fossé qui servait de cloaque et bordait la clôture (3), depuis le chemin de la Courtille jusqu'à la rue d'Angoumois, et à donner écoulement aux eaux. Ce fossé est représenté dans les anciens plans de Paris, celui de Bale notamment (1552), comme un ruisseau continuant au delà de l'Enclos au nord-est, et en deçà, le long de la censive de Saint-Martin, à l'ouest. Il passait sous la rue du Temple.
Enfin il devait y faire aménager, sans aucuns frais pour le Temple, une rue avec plantation d'arbres qui porterait le nom du grand prieur de Vendôme et serait pavée. Le reste des terrains, laissés libres pour les remparts de la ville, demeurait chargé d'une redevance annuelle de 50 livres envers le Temple. Comme d'habitude, un prête-nom fut porté pour acquéreur : Jean Beausire, conseiller du roi, maître général des bâtiments de Sa Majesté. Quelque temps après, le 19 octobre 1697, le grand prieur, suivant un nouveau contrat avec la Ville, céda encore 780 toises de terrains sur les 1480 qui lui avaient été laissées; il fut stipulé alors que la rue-nouvelle serait séparée des murs de l'Enclos par 30 toises de terrains convertis en jardin, et aboutirait à une place au milieu de laquelle un grand bassin serait édifié sous le nom de fontaine de Vendôme. Tous ces projets furent exécutés." (Source : http://www.templiers.net/commanderies/index.php?page=comm... )
 A la fin du XVIIème siècle, l'ancienne couture des Templiers était entièrement couverte de maisons, sauf les terrains restés au delà des murs d'enceinte, c'est-à-dire compris entre la rue de la Folie-Mérieourt, le boulevard du Temple, et la rue de Ménilmontant ...
A la fin du XVIIème siècle, l'ancienne couture des Templiers était entièrement couverte de maisons, sauf les terrains restés au delà des murs d'enceinte, c'est-à-dire compris entre la rue de la Folie-Mérieourt, le boulevard du Temple, et la rue de Ménilmontant ...
L'histoire de ce quartier est donc, au Moyen Age, intimement liée à celle des Templiers, jusqu'à l'extinction de l'ordre, en 1313, où les biens du Temple furent dévolus aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (les Hospitaliers), qui héritèrent de tous les biens de ces moines guerriers.
22:51 Publié dans balade, Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |
lundi, 10 mai 2010
11 Mai 2010 : 400ème anniversaire de la mort de Matteo Ricci, le jésuite qui nous a ouvert les portes de la Chine
 Cette année marque le 400ème anniversaire de la mort du missionnaire Matteo Ricci.(Macerata 1552-Pékin 11 mai 1610), lettré de la Renaissance italienne qui fut le premier européen à assimiler la culture chinoise et le précurseur de l'échange des savoirs entre la Chine et l'Europe.
Cette année marque le 400ème anniversaire de la mort du missionnaire Matteo Ricci.(Macerata 1552-Pékin 11 mai 1610), lettré de la Renaissance italienne qui fut le premier européen à assimiler la culture chinoise et le précurseur de l'échange des savoirs entre la Chine et l'Europe.
Si nous parcourons l'histoire, nous trouvons des tentatives de pénétrer en Chine : au 7e siècle, des chrétiens dits Nestoriens venant de Syrie, ainsi que des adeptes d'autres religions ; mais à la suite d'une grande persécution, tout cela a disparu, si ce n'est, dit-on, quelques traces dans certaines sectes populaires. Ensuite, au 13e siècle il y a eu les Franciscains, entrés par la voie des Mongols, au temps où la Chine était sous leur domination, mais cette chrétienté a disparu avec cette domination. L'aventure de l'Italien Marco Polo se situe à la même époque. Missionnaires ou voyageurs sont ainsi arrivés en Chine avant Ricci, mais leur entrée n'a pas été efficace, en ce sens qu'il n'en est rien resté.
Matteo Ricci est né à Macerata le 6 octobre 1552, dans les Marches italiennes, devient novice jésuite à Rome en 1578, s'embarque à Lisbonne la même année, et est ordonné prêtre à Cochin (Inde) en 1580. Pour certains donc, le grand mérite de Ricci est d'avoir ouvert la Chine au catholicisme ...
Personnellement je retiendrai surtout les apports de Ricci à la Chine en astronomie, mathématiques, cartographie ... Et tous les lycéens chinois le connaissent encore sous son nom sinisé de « Li Matou »
 Avant lui, une trentaine d'autres jésuites l'ont précédé en Extrême-Orient, mais les populations ont mal supporté l'attitude supérieure des Occidentaux venus les évangéliser un crucifix à la main ! Avec ses confrères responsables des missions de l'Orient, en particulier avec le père Alessandro Valignano, il élabore donc une nouvelle stratégie que l'on pourrait résumer par le mot " inculturation " : une optique dans laquelle la culture du peuple chinois n'est plus un obstacle à surmonter, mais une ressource pour l'Evangile. Pour les christianiser, il faut donc prendre leur culture au sérieux, apprendre à parler, lire, écrire la langue, se faire Chinois parmi les Chinois, en s'adaptant en tout à leurs coutumes et en adoptant le mode de vie du lettré - ainsi il choisira de porter le costume et non celui de "jésuite" - et si possible toucher l'empereur dont tout dépend. En dépit des difficultés de la langue, de la politique très fermée de la dynastie Ming et de la nouveauté totale des rapports avec le peuple chinois, Matteo Ricci se lance à fond dans l'étude de la culture chinoise, notamment des Quatre Livres qui sont la base de l'éducation confucéenne, au point d'être considéré comme un expert égal, sinon supérieur, aux lettrés chinois qui se pressent pour le connaître et s'entretenir avec lui. C'est cette attitude, dépourvue de préjugés et de tout esprit de conquête, qui permet à Matteo Ricci d'établir avec le peuple chinois un rapport de confiance et d'estime. Ce n'est pas un hasard si sa première œuvre en langue chinoise est un Traité sur l'Amitié (De amicitia Jiaoyoulun), recueil de 100 maximes sur l'amitié puisées chez les classiques grecs et latins, remporte un large succès dés sa première édition à Nankin en 1595. Ce Traité figurera dans l'Encyclopédie impériale.
Avant lui, une trentaine d'autres jésuites l'ont précédé en Extrême-Orient, mais les populations ont mal supporté l'attitude supérieure des Occidentaux venus les évangéliser un crucifix à la main ! Avec ses confrères responsables des missions de l'Orient, en particulier avec le père Alessandro Valignano, il élabore donc une nouvelle stratégie que l'on pourrait résumer par le mot " inculturation " : une optique dans laquelle la culture du peuple chinois n'est plus un obstacle à surmonter, mais une ressource pour l'Evangile. Pour les christianiser, il faut donc prendre leur culture au sérieux, apprendre à parler, lire, écrire la langue, se faire Chinois parmi les Chinois, en s'adaptant en tout à leurs coutumes et en adoptant le mode de vie du lettré - ainsi il choisira de porter le costume et non celui de "jésuite" - et si possible toucher l'empereur dont tout dépend. En dépit des difficultés de la langue, de la politique très fermée de la dynastie Ming et de la nouveauté totale des rapports avec le peuple chinois, Matteo Ricci se lance à fond dans l'étude de la culture chinoise, notamment des Quatre Livres qui sont la base de l'éducation confucéenne, au point d'être considéré comme un expert égal, sinon supérieur, aux lettrés chinois qui se pressent pour le connaître et s'entretenir avec lui. C'est cette attitude, dépourvue de préjugés et de tout esprit de conquête, qui permet à Matteo Ricci d'établir avec le peuple chinois un rapport de confiance et d'estime. Ce n'est pas un hasard si sa première œuvre en langue chinoise est un Traité sur l'Amitié (De amicitia Jiaoyoulun), recueil de 100 maximes sur l'amitié puisées chez les classiques grecs et latins, remporte un large succès dés sa première édition à Nankin en 1595. Ce Traité figurera dans l'Encyclopédie impériale.
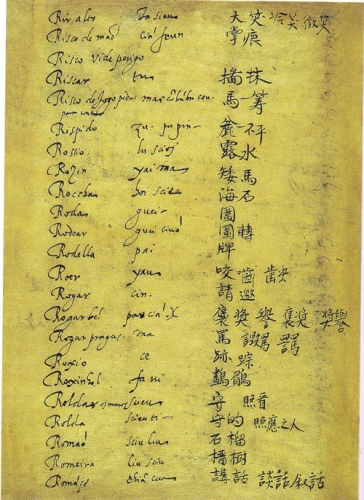 Il prend conscience du rôle des hauts magistrats, des eunuques du palais et des lettrés dans la structure politique de l'empire confucéen et il assimile vite que la vision chinoise du monde est globale, comme une sorte d'idéologie où science, technologie, éthique et enseignement philosophique formeraient un tout. Le dialogue, principalement scientifique, qu'il engage avec les savants chinois de l'époque le fait prendre très au sérieux. L'homme de science grappille petit à petit du terrain pour parvenir à son but, l'empereur. Il n'avance pas directement ses thèses mais vit de sa foi dans le secret de sa vie privée et se dit que si les chinois le croient sur les questions de sciences, de mathématiques, d'astronomie, ils le croiront ensuite sur les questions de foi. Ainsi un an avant sa mort, il écrivait au Supérieur de la vice province du Japon et de la Chine : "Les Chinois ont une belle intelligence naturelle et aiguë ; ce qui transparaît bien dans leurs livres, dans leurs discours [...] et dans le gouvernement de cette machine qui émerveille tout l'Orient. Aussi, si nous pouvions leur enseigner nos sciences, [...] pourrions-nous à travers elles les conduire aisément à notre sainte loi et ils n'oublieront jamais un si grand bienfait, [...] car ne leur ayant enseigné jusqu'ici que peu de choses des sciences mathématiques et de la cosmographie, ils nous en sont tellement reconnaissants que bien des fois j'ai entendu, de mes oreilles, dire de personnes importantes que nous avons ouverts les yeux aux Chinois qui étaient aveugles ; et ils ne parlaient que de ces sciences naturelles que j'ai dites, de la mathématique ; que diront-ils donc des autres [...] comme les sciences physiques, métaphysiques, théologiques et surnaturelles ?" (Lettre au P. Francesco Pasio. Pékin, le 15 du mois de février 1609).
Il prend conscience du rôle des hauts magistrats, des eunuques du palais et des lettrés dans la structure politique de l'empire confucéen et il assimile vite que la vision chinoise du monde est globale, comme une sorte d'idéologie où science, technologie, éthique et enseignement philosophique formeraient un tout. Le dialogue, principalement scientifique, qu'il engage avec les savants chinois de l'époque le fait prendre très au sérieux. L'homme de science grappille petit à petit du terrain pour parvenir à son but, l'empereur. Il n'avance pas directement ses thèses mais vit de sa foi dans le secret de sa vie privée et se dit que si les chinois le croient sur les questions de sciences, de mathématiques, d'astronomie, ils le croiront ensuite sur les questions de foi. Ainsi un an avant sa mort, il écrivait au Supérieur de la vice province du Japon et de la Chine : "Les Chinois ont une belle intelligence naturelle et aiguë ; ce qui transparaît bien dans leurs livres, dans leurs discours [...] et dans le gouvernement de cette machine qui émerveille tout l'Orient. Aussi, si nous pouvions leur enseigner nos sciences, [...] pourrions-nous à travers elles les conduire aisément à notre sainte loi et ils n'oublieront jamais un si grand bienfait, [...] car ne leur ayant enseigné jusqu'ici que peu de choses des sciences mathématiques et de la cosmographie, ils nous en sont tellement reconnaissants que bien des fois j'ai entendu, de mes oreilles, dire de personnes importantes que nous avons ouverts les yeux aux Chinois qui étaient aveugles ; et ils ne parlaient que de ces sciences naturelles que j'ai dites, de la mathématique ; que diront-ils donc des autres [...] comme les sciences physiques, métaphysiques, théologiques et surnaturelles ?" (Lettre au P. Francesco Pasio. Pékin, le 15 du mois de février 1609).
 Son travail est immense, il établit un lexique chinois-portugais. puis traduit «Geometrica Pratica et Trigonometrica», les oeuvres de son maitre Cristophe Clavius en latin et de nombreux livres et essais sur les instruments mathématiques, comme l'astrolabe, la sphère ou l'arithmétique, rendant pour la première fois accessibles aux Chinois les travaux mathématiques occidentaux. Il introduit aussi les instruments trigonométriques et astronomiques et traduit, toujours en chinois, les 6 livres d'Euclide, travail qui lui assure encore aujourd'hui une place importante dans l'histoire des mathématiques. Certes la Chine avait une tradition solide en mathématiques, mais tombée dans l'oubli et Ricci a ainsi pu amener les Chinois à renouer avec leur propre tradition. Sa contribution à la géographie de l'époque est tout aussi impressionnante. Entre 1584 et 1600 il publie les premières cartes géographiques de la Chine, qui permettent à l'Occident de découvrir la Chine, et à la Chine de considérer, pour la première fois dans son histoire, le reste du monde et la distribution des océans et des masses de terre. Pour ne choquer là encore une fois il décide de placer la Chine au centre de son planisphère et ensuite de dessiner tous les autres pays et continents à partir de ce "centre". Ses calculs dévoilent la largeur de la Chine, au trois quart plus petite que ce que pensaient les occidentaux. Il comprend aussi que la Chine et Pékin font bien parties du fameux Cathay décrit par Marco Polo. Cette mappemonde, qui révolutionnera la conception chinoise du monde, fascinera l'empereur.
Son travail est immense, il établit un lexique chinois-portugais. puis traduit «Geometrica Pratica et Trigonometrica», les oeuvres de son maitre Cristophe Clavius en latin et de nombreux livres et essais sur les instruments mathématiques, comme l'astrolabe, la sphère ou l'arithmétique, rendant pour la première fois accessibles aux Chinois les travaux mathématiques occidentaux. Il introduit aussi les instruments trigonométriques et astronomiques et traduit, toujours en chinois, les 6 livres d'Euclide, travail qui lui assure encore aujourd'hui une place importante dans l'histoire des mathématiques. Certes la Chine avait une tradition solide en mathématiques, mais tombée dans l'oubli et Ricci a ainsi pu amener les Chinois à renouer avec leur propre tradition. Sa contribution à la géographie de l'époque est tout aussi impressionnante. Entre 1584 et 1600 il publie les premières cartes géographiques de la Chine, qui permettent à l'Occident de découvrir la Chine, et à la Chine de considérer, pour la première fois dans son histoire, le reste du monde et la distribution des océans et des masses de terre. Pour ne choquer là encore une fois il décide de placer la Chine au centre de son planisphère et ensuite de dessiner tous les autres pays et continents à partir de ce "centre". Ses calculs dévoilent la largeur de la Chine, au trois quart plus petite que ce que pensaient les occidentaux. Il comprend aussi que la Chine et Pékin font bien parties du fameux Cathay décrit par Marco Polo. Cette mappemonde, qui révolutionnera la conception chinoise du monde, fascinera l'empereur.
Peu à peu, Ricci est perçu par les Chinois lettrés comme un transmetteur du savoir encyclopédique de l'Occident. En 1601 il se fait inviter à la cour impériale de Pékin, en tant qu'ambassadeur des Portugais auprès de l'empereur Wanli, porteur d'une épinette, d'une mappemonde et de deux horloges à sonnerie. L'empereur l'autorise enfin à venir s'établir à Pékin à proximité de son palais et à y construire une résidence et une première église catholique. Tous ses frais sont pris en charge par le trésor public et, à sa mort, le 11 mai 1610, il a le privilège - jamais concédé jusqu'alors à un étranger - d'être enterré dans la Cité impériale. La Chine compte alors huit jésuites et 2 500 chrétiens.
Ricci n'a pas lui-même accompli beaucoup de conversions, mais son rayonnement a entraîné les dirigeants confucéens vers un savoir de plus en plus pratique, et la plupart des grands lettrés garderont par la suite des contacts avec les jésuites. Ainsi la direction de l'Observatoire astronomique de Pékin et la révision du Calendrier chinois, achevée quelques années après la mort de Matteo Ricci, seront confiées aux jésuites qui poursuivirent son œuvre. La vaste documentation conservée dans l'ancien Observatoire astronomique de Pékin et l'inscription du père Matteo Ricci parmi les personnages les plus illustres de Chine témoignent aujourd'hui encore de la gratitude des Chinois pour la contribution apportée par le missionnaire jésuite et par ses confrères au progrès des connaissances humanistes et scientifiques dans leur pays. Et en 2010, les manuels chinois de mathématiques utilisent toujours ses travaux ! En France, son Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la Chine, suivie de la mission française à Pékin, ouvre la voie à ce qui deviendra la "sinologie".
02:27 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
samedi, 08 mai 2010
8 mai 1945 ... le retour, enfin !
 Le 7 mai 1945, à 2 h 41, la reddition de l'armée allemande est signée à Reims ... Cette date correspond donc à la fin des combats en Europe de l'Ouest. Les journalistes occidentaux répandirent prématurément la nouvelle de la capitulation, précipitant ainsi les célébrations. Les combats continuèrent cependant sur le front de l'Est jusqu'à ce que les Allemands signent à nouveau un acte de capitulation spécifique avec les Soviétiques à Berlin. C'est donc peu avant minuit, le 8 mai, qu'une seconde reddition sans condition fut signée dans la banlieue Est de Berlin. Les représentants de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis arrivèrent peu avant minuit. Après que le maréchal Georgi Joukov eut ouvert la cérémonie, les représentants du Haut commandement allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, furent invités à signer l'acte de capitulation entrant en vigueur à 23 h 01, heure d'Europe centrale.
Le 7 mai 1945, à 2 h 41, la reddition de l'armée allemande est signée à Reims ... Cette date correspond donc à la fin des combats en Europe de l'Ouest. Les journalistes occidentaux répandirent prématurément la nouvelle de la capitulation, précipitant ainsi les célébrations. Les combats continuèrent cependant sur le front de l'Est jusqu'à ce que les Allemands signent à nouveau un acte de capitulation spécifique avec les Soviétiques à Berlin. C'est donc peu avant minuit, le 8 mai, qu'une seconde reddition sans condition fut signée dans la banlieue Est de Berlin. Les représentants de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis arrivèrent peu avant minuit. Après que le maréchal Georgi Joukov eut ouvert la cérémonie, les représentants du Haut commandement allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, furent invités à signer l'acte de capitulation entrant en vigueur à 23 h 01, heure d'Europe centrale.
Per me si va nielle cita dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va alla perduta gente.
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate !
Par moi on pénètre dans la cité de la souffrance ;
Par moi on entre dans l'éternelle douleur,
Par moi, on marche vers le peuple des perdus.
Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance !
Dante Alighieri, La divine comédie, 1472.
Le lundi 7 mai 1945, le convoi ramenant Granny de Hanovre, via la Belgique, passait la frontière française, non loin de Lille. Le 8 mai à 9h, elle était à Paris ...
Une de ses amies, Simonne Rohner, déportée comme elle, a fait le récit de leur déportation à son retour. Ce récit, dont j'ai gardé précieusement une copie, je l'ai retrouvé un jour sur internet ...
Granny, c'est "Madeleine" - matricule 38990 - partie comme Simonne le 13 mai 1944 par le convoi I.212 qui ne transportait que des femmes, 552 en tout, et qui arriva à Ravensbrück le 18 mai 1944. Près des deux tiers de ces femmes ne restent pas dans ce camp de concentration, et sont ensuite transférées dans des Kommandos de travail, ("camp annexe" en allemand) souvent éloignés, produisant pour l'économie de guerre du Reich et dépendant d'autres camps. Simonne et Granny sont ainsi transférées le 21 Juin 1944 dans un "kommando" de travail, le Lager-Arbeit de Limmer près de Hanovre, dépendant du KL Neuengamme, pour y fabriquer des masques à gaz.
Libérées le 23 avril 1945 par la Croix-Rouge, leur retour, d'abord prévu en avion, se fit en fait en camion jusqu'à Clèves, sur des routes allemandes défoncées par les bombardements et la guerre, et enfin en train à travers la Hollande et la Belgique. Voilà le récit que Simone fit de la fin du voyage :
"Le train repartit, la plupart des camarades dormaient. Hélène et moi, enveloppées dans nos couvertures étions restées sur le marchepied, scrutant la nuit noire, nous étions silencieuses, toutes à nos pensées intimes. A chaque station, nous posions la question :
- Est-ce là la FRANCE ?
- Pas encore, bientôt !
A une toute petite station, le chef de gare nous dit :
- Vous en êtes à quelques kilomètres...
Comme nos coeurs battaient !
A l'arrêt suivant, des employés de la S.N.C.F. nous accueillirent, un grand cri s'éleva de tout le convoi :
- Nous sommes en FRANCE !
Personne ne pensait plus à dormir, on s'embrassait, on riait, on chantait et bientôt le train ralentit. Nous étions à LILLE, dans une gare de triage. Il était 3 h du matin. Des Officiers nous attendaient et nous firent le salut militaire puis nous partîmes en camions au travers de la ville endormie. Comme tout était calme, silencieux. On nous conduisit dans un ancien séminaire où un repas nous attendait. Nous n'avions guère faim, mais malgré tout nous fîmes honneur au saucisson, à la tranche de viande froide, pommes de terre et gâteaux, plus un grand verre de vin rouge, le premier depuis notre libération.
Des scouts, des dames de la CROIX-ROUGE nous entouraient s'informant de nos moindres désirs. Nous étions plus de mille. Tout à coup un soldat se leva et réclama la"MARSEILLAISE". Celle-ci fut chantée d'une voix vibrante, nous étions tous profondément émus. Quelques soldats chantèrent des chansons de camps et nous, nous entonnâmes le chant des"MARAIS". Lorsque nous eûmes terminées un silence de mort plana sur la salle, la plupart des soldats pleuraient, cette vision était bouleversante.
Enfin, l'ordre d'aller nous reposer quelques heures arriva et on nous conduisit dans des petites chambres où des lits bien blancs nous attendaient. Nous n'en pouvions plus d'émotion, de fatigue, de joie et le sommeil nous terrassa immédiatement.
Le soleil brillait déjà haut dans le ciel, lorsque nous ouvrîmes les yeux. On nous fit savoir que nous devions aller à la sécurité militaire, ainsi qu'à la visite médicale. Trois Officiers nous interrogeaient, compulsaient des fiches puis nous remirent nos feuilles de Rapatriés. Ensuite nous reçûmes une prime de 1 500 francs, plus une somme de 1 000 francs, offerte en réalité par les prisonniers porteurs de marks. Je remis ces 1 000 francs à Nicole, car je n'ignorais pas qu'elle était dans le plus grand dénuement, les Boches lui ayant tout pris. On nous fit prendre une douche, on nous vaccina, puis les Majors nous examinèrent, radioscopie, radio tirée ; je tombais sur un phénomène qui me demanda candidement :
- Vous n'avez pas été malheureuse en ALLEMAGNE ?
- Oh ! non, lui répondis-je en riant, c'était le paradis !"
[...]A midi 1/2, on nous fit remonter en camions et nous prîmes la direction de la gare. Les civils nous regardaient avec des airs méfiants, quelques huées furent lancées à notre adresse. Nous nous regardions surprises. Quoi ? La FRANCE ignorait-elle les déportés ? Nos costumes de bagnardes n'expliquaient donc rien ? A la gare ce fut pire, nous eûmes à subir des paroles cinglantes, nous en pleurions de rage. Où était l'ambiance la gentillesse des Hollandais, des Belges !
Nous recevions un accueil hostile, nous étions déroutées. Sur le quai, Alice avisa un jeune homme et le pria d'aider une de nos camarades qui n'arrivait plus à traîner son baluchon, il répondit brutalement :
- Elle est bien capable de le porter elle-même !
- Salaud ! lui cria Alice, elle écumait de colère. Ah ! on m'y reprendra de faire de la Résistance, ah ! les salauds ! être reçue de cette façon dans notre pays. Ah ! non, jamais je n'oublierai cela, après avoir souffert ce que nous avons souffert, c'est un peu violent !
Un des Officiers alla au haut-parleur et s'adressant aux civils, il prononça des paroles dures, blâmant une pareille attitude à notre égard. Le train démarra, nous étions installées dans un grand wagon de seconde classe à couloir central, affalées sur nos banquettes, silencieuses, le coeur lourd de larmes.
Peu de temps après le départ, un jeune homme et une jeune femme vinrent vers nous :
- Tout le monde a compris, dirent-ils, et nous venons chercher quelques-unes d'entre vous pour parcourir les wagons, nous avons organisé une collecte à votre profit !
En effet, un peu plus tard, elles revinrent toutes joyeuses, tenant dans leur robe de nombreux billets, lorsque le partage fut fait, nous reçûmes chacune 187,50 Frs... Alice riait aux larmes :
- J'empoche, dit-elle, car jusqu'à PARIS, je reste cloche et vis de la mendicité publique, cela me paiera mon métro !
La gaieté reparut et nous chantions à tue-tête.
A ARRAS, il y eut arrêt.
Des infirmières nous distribuèrent un casse-croûte et du vin. La ville était très abîmée, je la retrouvais comme en 1919... Puis le train roula, roula à travers la plaine de l'ARTOIS, de la SOMME, pays plat, riche en cultures, mes yeux se souvenaient de tous ces coins que j'avais parcouru chaque année lorsque nous allions sur la tombe de papa.
Nous approchâmes de CREIL, arrêt, puis la forêt de CHANTILLY avec ses frondaisons de printemps. Nous longions l'OISE où ses ponts sautés, ses villas endommagées nous montraient encore la figure sinistre de la guerre. Enfin, la banlieue avec ses petites maisons, puis le Sacré-Coeur se dessina et nous entrâmes en gare du Nord, il était 8 heures !
PARIS !
Nous étions enfin à PARIS...
Les employés nous aidèrent à descendre, nous souriaient, nous interrogeaient. Les scouts se précipitèrent et on nous entraîna dans une grande salle aménagée en Centre d'Accueil, personne n'avait faim. [...]
Je piétinais dans l'attente des autobus qui devaient venir nous chercher, les Officiers m'empêchèrent de rentrer par mes propres moyens :
- Vous devez passer par LUTETIA pour le contrôle !
Enfin, vers 9 heures, ils arrivèrent ornés de drapeaux, je restais sur la plate-forme avec Hélène, Nicole et Henriette.
Tout PARIS était dehors, les fenêtres étaient pavoisées et dans le ciel deux faisceaux lumineux formaient un grand V symbolique. Je ne retrouvais pas la liesse de BRUXELLES, ni le souvenir de la joie débordante de 1918, c'était autre chose, une joie presque grave. Le long du parcours, les gens nous saluaient, nous envoyaient des baisers, agitaient les mains et nos camarades criaient :
- Bonjour la FRANCE ! Bonjour PARIS !
PARIS intact, toujours beau sous son ciel de Mai, la nuit tombait poudrant tout d'une douceur inconnue en ALLEMAGNE. Je dévorais des yeux tous ces coins si connus, si aimés.
PARIS !
Mon PARIS, je le retrouvais... Combien de fois avais-je rêvé à lui, pendant les nuits d'usine où seule avec mes souvenirs, je voyais défiler toutes ses rues, ses boulevards, ses quartiers où j'avais laissé tant de moi-même, bons ou mauvais souvenirs.
Qu'importe, je l'aimais mon PARIS...
A LUTETIA, une foule attendait, visages crispés, torturés, des gens se précipitèrent, nous entourèrent, nous interrogèrent, il fallut que les scouts et les agents s'interposent pour nous laisser entrer. Nouveau contrôle militaire, puis enfin, je vis arriver Jo et Suzanne, après nous être embrassé en pleurant de joie, je les interrogeai avidement.
- Père et Jacques n'ont pas pu venir, ils sont très fatigués, mais ce ne sera rien, un peu de repos suffira !
Je pressais le pas, courant presque, une hâte d'arriver, de les voir. Lorsque la porte s'ouvrit, je vis Tito... hâve, décharné, semblable aux photos vues à HANOVRE. Il vint vers moi :
- Tu vois, me dit-il, ce que je suis devenu ?
Quel reproche dans sa voix... Je me sentis glacée.
- Où est Jacques ?
- Là-haut, il t'attend !
Je grimpais les escaliers en courant et bondis dans la petite chambre, un cadavre m'attendait. Il tourna les yeux vers moi et un pauvre sourire se dessina sur ses lèvres :
- Ah ! te voilà maman ! Tu es revenue toi aussi... Il referma les yeux, je posais mes lèvres sur sa face ruisselante de sueur, il ouvrit à nouveau les yeux et me dit :
- Ils ne m'ont pas eu les vaches !...
Puis il tourna la tête d'un air las.
Je restais près de lui, tenant sa main fiévreuse, effondrée devant la réalité brutale, une nouvelle lutte à soutenir m'attendait, lutte contre la mort que l'on sentait rôder dans la petite pièce étouffante.
Lorsque je gagnais mon lit, ce fut une nuit terrible, pleine de larmes et de sanglots. Ah ! ce n'était pas cela que j'avais rêvé... comme retour.
La vie me pesait.
Toute joie avait disparu de mon coeur.
Le cortège de soucis, d'angoisse, de lutte recommençaient.
C'était le 8 Mai 1945..."
A voir ! les dessins de l'article " l'art et les camps" http://pagesperso-orange.fr/d-d.natanson/art_et_camps
18:05 Publié dans femmes, Histoire, messages perso ... | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 07 mai 2010
Songes drolatiques de Pantagruel ...
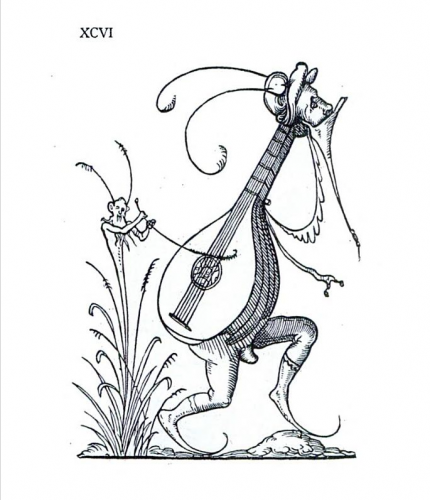 Internet est une mine, et mes recherches pour mes cours de peinture m'amènent parfois à faire des découvertes qui me passionnent.
Internet est une mine, et mes recherches pour mes cours de peinture m'amènent parfois à faire des découvertes qui me passionnent.
Ainsi, alors que je recherchais des photos de tableaux avec des diamants, des perles et des pierres précieuses pour mon stage du week end dernier, j'ai découvert un peu de mon bonheur sur "le petit carnet de Maxence", puis sautant de post en post, des gravures qui me serviront de modèles pour faire quelques enluminures !!! Je cherchais des sujets non religieux, les voilà ... tirés d'un petit volume d'illustrations paru en 1565, 12 ans après la mort de Rabelais, Les Songes drolatiques de Pantagruel, où sont contenues plusieurs figures de l'invention de maistre François Rabelais: & dernière oeuvre d'iceluy, pour la récréation de bons esprits.
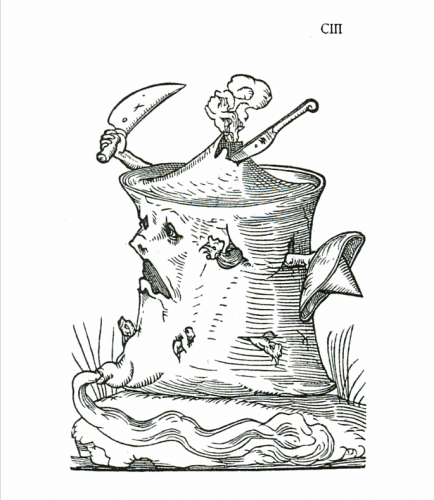 En effet ces gravures sont interprétées un peu à la manière des grotesques L'original, dont aucun des dessins n'est arrivé jusqu'à nous, a été publié par Richard Breton à Paris. La signification exacte des dessins n'est pas claire, car hormis un préambule qui n'explique pas grand-chose, il n'y a que des images. Certains chercheurs prétendent qu'il sont politiques et satiriques, arguant, par exemple, de la ressemblance avec le pape Jules II dans au moins de vingt et une gravures. En tous les cas, cette suite de cent vingt planches décline, avec une incroyable inventivité, le thème du monstre qui a fasciné la Renaissance, comme ceux décrits dans le fameux Des monstres et prodiges d'Ambroise Paré.
En effet ces gravures sont interprétées un peu à la manière des grotesques L'original, dont aucun des dessins n'est arrivé jusqu'à nous, a été publié par Richard Breton à Paris. La signification exacte des dessins n'est pas claire, car hormis un préambule qui n'explique pas grand-chose, il n'y a que des images. Certains chercheurs prétendent qu'il sont politiques et satiriques, arguant, par exemple, de la ressemblance avec le pape Jules II dans au moins de vingt et une gravures. En tous les cas, cette suite de cent vingt planches décline, avec une incroyable inventivité, le thème du monstre qui a fasciné la Renaissance, comme ceux décrits dans le fameux Des monstres et prodiges d'Ambroise Paré.
Dans l'introduction et la postface d'un livre paru en 2004, un historien de la littérature, Michel Jeanneret, et un historien de l'art, Frédéric Elsig, rappellent l'origine probable des Songes drolatiques : le milieu parisien des imprimeurs, des brodeurs et des décorateurs : ils leur servaient de source d'inspiration pour créer des costumes de carnaval ? Ils les rapprochent de la mode des grotesques dans les marges des enluminures de manuscrits du Moyen Age et de la renaissance, et les replacent dans la tradition des drôleries gothiques et flamandes, celle de Bosch et de Bruegel, qui étaient tous deux contemporains de Rabelais. Ils rappellent que l'univers mental de la Renaissance est peuplé de monstres et, pour saisir l'enjeu de ces gravures étranges, proposent une réflexion sur le rapport qu'entretiennent la peur et le rire, suggérant que, si l'attribution à François Rabelais est historiquement fausse, elle rejoint pourtant, dans l'esprit, les joyeuses aventures des Pantagruélistes.
La publication de Gargantua et de Pantagruel a rapidement inspiré imitations, parodies et commentaires par d'autres écrivains, l'un des premiers a été un long poème de François Habert, Le Songe de Pantagruel, avec la déploration de feu messire Anthoine Du Bourg, chevalier, chancellier de France, publié en 1542.
 Je ne connais rien au tarot, mais des sites "spécialisés" indiquent que Rabelais en connaissait les cartes et font remarquer la similitude entre l'iconographie de certains arcanes du tarot et quelques-unes des 120 gravures.
Je ne connais rien au tarot, mais des sites "spécialisés" indiquent que Rabelais en connaissait les cartes et font remarquer la similitude entre l'iconographie de certains arcanes du tarot et quelques-unes des 120 gravures.
Dali a été attiré par la fantaisie, la satire, la subversion, l'érotisme et le matériel onirique contenus dans les textes de Rabelais en raison de leur similitude avec les idées surréalistes. Il s'en est largement inspiré pour les 25 illustrations à la gouache et crayon feutre, Les chansons (Songes) drolatiques de Pantagruel, éditées en lithographies en 1973 Là non plus, aucun commentaire, uniquement une annotation alphabétique. Certaines de ces images ont également été influencées par le travail du peintre et graveur suisse Urs Graf (1485-c.1529).
22:56 Publié dans art, coup de coeur, enluminures, litterature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 30 avril 2010
Paroles d'un croyant
Le 30 avril 1834 paraît à Paris Paroles d'un croyant. Dans cet ouvrage, Félicité de Lamennais constate et déplore le "désenchantement" du monde, et lance un appel pressant à la liberté de l'Église, à partir duquel, il commence à développer les tendances socialistes et démocratiques du message évangélique. Ce petit ouvrage, qui en appelle à l'insurrection contre l'injustice au nom de l'Évangile, est immédiatement condamné par le Saint-Siège. Voici ce qu'en écrit Alexandre Dumas dans Mes Mémoires (Chapitre CXCI)
"Pour les rédacteurs de l'Avenir, la position n'était plus tenable. Si, d'un côté, la démocratie religieuse, abreuvée de tristesse et de fiel, recueillait avec amour les paroles des envoyés, de l'autre, l'opposition des chefs de l'Eglise catholique devenait formidable, l'accusation d'hérésie courait de bouche en bouche. L'abbé de Lamennais regarda autour de lui, et ne vit, comme le prophète Isaïe, que des champs où la désolation était assise. La Pologne, blessée au flanc, la main hors du suaire, dormait dans l'attente éternellement trompeuse de la main de la France ; et, cependant, elle était tombée pleine de désespoir et de doute, en disant : « Dieu est trop haut, et la France est trop loin !! » L'Irlande éperdue de misère, mourant de faim, comprimée à la fois par le poing et par le genou de l'Angleterre, se prosternait en vain devant ses croix de bois en implorant le secours du ciel : rien ne venait ! Il semblait que la Liberté eût détourné sa face d'un monde qui n'était point digne d'elle. La Pologne et l'Irlande, ces deux alliées naturelles de toute démocratie religieuse, disparaissaient de la scène politique, et, en disparaissant, entraînaient dans leur chute l'existence de l'Avenir.
Le flot des oppositions, semblable à une marée sans reflux, montait, montait toujours. Les uns en voulaient à l'opinion de M. de Lamennais, les autres à son talent ; ces derniers n'étaient pas les moins animés contre lui. Il fallut céder. Comme tous les journaux qui glissent dans le vide, l'Avenir annonça qu'il suspendait sa publication ; ce furent ses adieux de Fontainebleau.
« Si nous nous retirons un moment, écrivait M. de Lamennais, ce n'est point par lassitude, encore moins par découragement ; c'est pour aller, comme autrefois les soldats d'Israël, consulter le Seigneur en Silo.
« On a mis en doute notre foi et nos intentions même ; car, en ces temps-ci, que n'attaque-t-on point ? Nous quittons un instant le champ de bataille pour remplir un autre devoir également pressant. Le bâton du voyageur à la main, nous nous acheminons vers la chaire éternelle, et, là prosternés aux pieds du pontife que Jésus-Christ a préposé pour guide et pour maître à ses disciples, nous lui dirons : « O père ! Daignez abaisser vos regards sur quelques-uns d'entre les derniers de vos enfants qu'on accuse d'être rebelles à votre infaillible et douce autorité ! O père ! Prononcez sur eux la parole qui donne la vie parce qu'elle donne la lumière, et que votre main s'étende pour bénir leur obéissance et leur amour." »
Il serait puéril de mettre ici en question la sincérité de celui qui écrivait ces lignes. Comme Luther, qui promettait, lui aussi, de se soumettre à Rome, l'abbé de Lamennais avait l'intention de persévérer dans la foi catholique. Si, plus tard, son orthodoxie s'ébranla ; si, à la vue de Rome et des cardinaux, sa foi au vicaire de Jésus et à la représentation visible de l'Eglise se démentit, il faut en accuser peut-être la forme toute païenne sous laquelle la religion du Christ lui apparut, comme jadis au moine d'Eisleben, dans la ville éternelle.
Quand j'en serai là de ma vie, à moi, je raconterai mes propres sensations, et je dirai mes longues conversations à ce sujet avec le pape Grégoire XVI.
Les trois pèlerins de l'Avenir, l'abbé de Lamennais, l'abbé Lacordaire et le comte Charles de Montalembert se mirent donc en route pour l'Italie, non tout à fait comme l'avait annoncé l'un d'eux. Le bâton du voyageur à la main, mais animés d'une foi réelle, et la douleur dans l'âme. Ils ne laissaient pas sans un regret mortel le rêve de onze mois derrière eux ; l'Avenir avait, en effet, duré du 16 octobre 1830 au 17 septembre 1831.
Nous ne raconterons point les impressions de voyage de l'abbé de Lamennais, car l'auteur de l'Essai sur l'indifférence n'est point un homme à impressions extérieures. Il passa devant l'Italie sans la voir ; à travers cette merveille des merveilles, il n'apercevait que son idée et le but de son itinéraire.
C'est dix ans plus tard qu'étant prisonnier à Sainte-Pélagie, et déjà vieux, Lamennais retrouva dans un coin de ses souvenirs l'Italie encore chaude de son soleil ; par un procédé de daguerréotype qu'explique assez la nature de l'homme dont nous nous occupons, les monuments de l'art et le paysage s'étaient décalqués invisiblement sur la plaque de son cerveau ! Il fallut la rêverie, le silence et la captivité, comme il faut l'iode à la plaque argentée, pour faire sortir de sa mémoire la figure des belles choses qu'il avait oublié d'admirer dix ans auparavant. C'est à cause de cela qu'il nous disait en 1841, sous le plafond écrasé de son cachot :
- Je commence à voir l'Italie... C'est un pays merveilleux !
On pourrait faire sur l'abbé de Lamennais, surtout en le comparant aux autres poètes de son temps, une curieuse étude psychologique.
L'auteur de l'Essai sur l'indifférence voit peu et mal ; il a un nuage sur les yeux et un nuage sur le cerveau ; à l'endroit de la perception du monde extérieur, le seul sens qui soit pour ainsi dire, éternellement éveillé dans cette organisation particulière, est le sens de l'ouïe, qui répond à la faculté musicale : l'abbé de Lamennais joue du piano, et se plaît surtout aux compositions de Liszt. De là peut-être la cause de sa profonde tendresse pour ce grand artiste.
Quant au reste, c'est-à-dire quant à ce qui se rapporte au monde objectif, le spectacle est en lui, et, lorsqu'il veut voir, c'est dans son âme qu'il regarde. De cette disposition de l'homme, il résulte une nature de style qui rentre dans la manière psychologique. Décrit-il un paysage, comme dans les Paroles d'un croyant ou dans les tableaux datés de sa prison, c'est toujours la ligne infinie qui étend sous sa plume de vagues horizons ; chez lui, la pensée voit, non pas l'oeil.
C'est que M. de Lamennais est de la race des penseurs maladifs dont était Blaise Pascal. Que la médecine ne s'avise jamais de guérir ces natures souffrantes : elle leur enlèverait leur génie.
Le voyage, avec ses relais forcés, donna souvent à l'abbé de Lamennais le loisir d'étudier notre littérature moderne, qu'il connaissait peu. Dans un monastère d'Italie où les pèlerins reçurent l'hospitalité, MM. de Lamennais et Lacordaire lurent pour la première fois Notre-Dame de Paris et Henri III.
Arrivé à Rome, l'abbé de Lamennais logea dans l'hôtel et dans l'appartement qu'avait occupé, quelques mois auparavant, la comtesse Guiccioli. Son idée fixe était de voir le pape, de terminer avec lui ses affaires, qui étaient celles de la démocratie religieuse. Après de longs retards, après une foule de démarches infructueuses, après sept ou huit demandes d'audience restées sans résultat, l'abbé de Lamennais se plaignit ; alors, un ecclésiastique de Rome auquel il témoignait son mécontentement lui fit naïvement observer que peut-être il avait omis de déposer la somme de *** dans les mains du cardinal ***. L'abbé de Lamennais avoua qu'il aurait cru offenser Son Eminence en la traitant comme le portier d'une courtisane.
- Alors, ne vous étonnez plus, lui répondit l'abbé italien, de n'avoir pas encore été reçu par Sa Sainteté.
L'ignorant voyageur avait oublié la formalité essentielle. Et, cependant, quoique renseigné, il s'obstina à voir le pape gratis ; en payant, il lui eût semblé devenir le complice d'une simonie.
Les rédacteurs de L'Avenir étaient déjà depuis trois mois oubliés dans la ville sainte, attendant que le pape voulût bien s'occuper d'une question qui tenait en suspens une moitié de Europe catholique. L'abbé Lacordaire avait pris le parti de retourner en France ; le comte de Montalembert se préparait à partir pour Naples ; M. de Lamennais seul continuait de frapper aux portes du Vatican, plus fermées et plus inexorables que celles de Lydie dans ses mauvais jours. Le père Ventura, alors général des Théatins, reçut l'illustre voyageur français à Santo-Andrea della Valle.
« Je n'oublierai jamais, dit M. de Lamennais dans ses Affaires de Rome, les jours paisibles que j'ai passés dans cette pieuse maison, entouré des soins les plus délicats, parmi ces bons religieux si édifiants, si appliqués à leurs devoirs, si éloignés de toute intrigue. La vie du cloître, régulière, calme et, pour ainsi dire, retirée en soi, tient une sorte de milieu entre la vie purement terrestre et cette vie future que la foi nous montre sous une forme vague encore, et dont tous les êtres humains ont en eux-mêmes l'irrésistible pressentiment. »
Enfin, après bien des instances, l'abbé de Lamennais fut reçu par Grégoire XVI en audience particulière. Il se rendit au Vatican, monta l'escalier gigantesque tant de fois monté et descendu par Raphael et par Michel-Ange, par Léon X et par Jules II ; il traversa les hautes et silencieuses salles aux deux rangs de fenêtres superposées, à l'extrémité de ce long palais splendide et désert, il arriva, conduit par un huissier, dans une chambre d'attente où deux cardinaux, immobiles comme des statues, assis sur des sièges de bois, lisaient gravement leur bréviaire. Le moment venu, l'abbé de Lamennais fut introduit. - Dans une chambre petite, nue, toute tendue de rouge, où un seul fauteuil annonçait qu'un seul homme avait là le droit de s'asseoir, se tenait debout un grand vieillard calme et souriant dans son blanc linceul. Il recevait M. de Lamennais debout ; grand honneur ! le plus grand que cet homme divin pût faire à un autre homme sans violer l'étiquette.
Alors, le pape entretint le voyageur français du beau soleil, de la belle nature de l'Italie, des monuments de Rome, des arts, de l'histoire ancienne ; mais de son affaire, du but de son voyage, pas un mot. Le pape n'avait point commission pour cela : cette question se traitait quelque part dans l'ombre, entre des cardinaux nommés pour en connaître, et dont on ne savait point les noms. Un mémoire avait été adressé à la cour de Rome par les rédacteurs de l'Avenir ; ce mémoire devait amener une décision autour de laquelle régnait le mystère le plus impénétrable. Le pape, d'ailleurs, se montra bienveillant pour le prêtre français dont le génie honorait l'Eglise catholique.
- Quelle est, parmi les oeuvres d'art, demanda-t-il à M. de Lamennais, celle qui vous a le plus frappé ?
- Le Moïse de Michel-Ange, répondit le prêtre.
- Eh bien, lui dit Grégoire XVI, je vais vous montrer une chose que personne ne voit, ou plutôt que bien peu d'élus voient à Rome.
Et, en disant ces mots, le grand vieillard blanc entra dans une sorte d'alcôve fermée par des rideaux, et revint soutenant dans ses bras une réduction en argent du Moïse faite par Michel-Ange lui-même. L'abbé de Lamennais admira, salua et se retira accompagné par les deux cardinaux qui gardaient l'entrée de cette chambre.
Il fut forcé de rendre hommage à la gracieuse réception du saint-père ; mais, en conscience, il n'était pas venu de Paris à Rome pour voir la statuette de Moïse !
Ce fut un désenchantement infini. L'abbé de Lamennais secoua sur Rome la poussière de ses sandales, une poussière de tombe, et s'en revint à Paris.
Après un long silence, au moment où l'affaire de L'Avenir semblait ensevelie dans les hypogées du Saint-Siège, Rome parla : elle condamnait les doctrines des hommes qui avaient essayé de rallier le christianisme à la liberté.
La douleur de l'abbé de Lamennais fut immense. Le pasteur étant frappé, les brebis se dispersèrent ; à peine la nouvelle d'une censure arrivait-elle à La Chesnaie, que les disciples furent saisis de frayeur, et prirent la fuite. M. de Lamennais resta seul dans le vieux château abandonné, seul avec le triste silence qu'interrompaient parfois le murmure des grands chênes et le chant des oiseaux plaintifs. Bientôt cette retraite même lui fut enlevée : l'abbé de Lamennais se réveilla, un jour, ruiné par la faillite d'un libraire dont il avait garanti la signature.
Alors, l'ex-rédacteur de l'Avenir commença son voyage à travers un océan d'amertume ; les tourments de l'âme l'empêchèrent de s'apercevoir de sa pauvreté, qui fut extrême ; ses meubles, ses livres, il vendit tout. Deux fois il baissa sous la main du chef de l'Eglise une tête résignée, et deux fois il se releva, plus triste chaque fois, chaque fois plus indompté, chaque fois plus convaincu que l'esprit humain, le progrès, la raison, la conscience ne pouvaient avoir tort. Ce ne fut point sans déchirements profonds qu'il se sépara du dogme de sa jeunesse, de sa vie de prêtre, de l'obéissance tranquille, de l'unité majestueuse et forte, en un mot, de tout ce qu'il avait défendu ; mais l'esprit nouveau l'avait pris aux cheveux, selon le langage de la Bible, et lui disait : « Va ! »
C'est alors que, dans le silence, au milieu des persécutions que sa docilité même n'avait pu désarmer, à Paris, dans une petite chambre meublée d'un lit de sangle, d'une table et de deux chaises, l'abbé de Lamennais écrivit les Paroles d'un croyant. Le manuscrit resta une année dans le portefeuille de l'auteur ; remis plusieurs fois entre les mains de l'éditeur Renduel, retiré, puis redonné, puis retiré encore, ce beau livre subit avant sa publication toute sorte de vicissitudes, rencontra toute sorte d'obstacles ; les principales difficultés vinrent de la famille même de l'abbé de Lamennais, surtout d'un frère qui ne voyait pas sans terreur son frère s'aventurer sur cet océan de la démocratie qu'agitaient les tempêtes de 1833. Enfin, après bien des retards et des hésitations douloureuses, la forte volonté de l'auteur l'emporta sur les instances de l'amitié.
Le livre parut.
C'est ici la troisième transformation de l'écrivain : l'abbé de la Mennais et M. de Lamennais venaient de faire place au citoyen Lamennais.
Nous le retrouverons sur les bancs de la Constituante de 1848.
Comme tous les hommes d'un grand génie, et qui, pilotes de leur propre pensée, ont eu à conduire ce génie à travers les orages religieux et politiques qui ont soufflé depuis trente ans, M. de Lamennais a été l'objet des jugements les plus opposés. Nous ne nous faisons ici ni son apologiste ni son accusateur ; nous essayons de lui rendre le service qu'il appartient à tout homme de coeur de rendre à un homme qu'il admire : nous essayons de le montrer aux autres tel qu'à nous-même il est apparu."
Alexandre Dumas
Mes Mémoires - Chapitre CXCI
On peut lire Parole d'un croyant sur internet ici ou ici
Lire aussi http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=252
06:47 Publié dans Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mardi, 27 avril 2010
27 avril 1578, le duel des "mignons"
 Jacques de Lévis, comte de Caylus ou Quélus selon la prononciation du nord de la France, (1554-1578) fut l'un des "mignons" du roi Henri III.
Jacques de Lévis, comte de Caylus ou Quélus selon la prononciation du nord de la France, (1554-1578) fut l'un des "mignons" du roi Henri III.
Le nom " mignon " désigne alors les courtisans et favoris des seigneurs de chaque grande maison comme celle duc de Guise, le duc de Montmorency et bien évidemment la Cour des Valois. Le terme a été dévoyé et pourvu d'une connotation péjorative propagée par les calvinistes qui condamnaient avec démesure le genre de vie raffiné.
Henri III s'entoure d'hommes qui lui sont complètement dévoués. Pensions et dons royaux, responsabilités militaires et politiques, positions honorifiques... autant de largesses qui échappent aux grandes familles aristocratiques, qui considèrent les "mignons" comme illégitimes auprès du roi parce que n'appartenant pas à la plus haute noblesse, et les méprisent car ils les jugent dénuées de cet esprit d'indépendance qui fait encore le noble à la fin du XVIe siècle. Pourtant, malgré l'appui du roi, les mignons n'ont pas réussi supplanter les grands princes, comme les Guise et les Montmorency, ou les responsables de partis religieux.
Ces gentilshommes s'habillent avec raffinement, se fardent, se poudrent et se frisent les cheveux, portent des boucles d'oreilles, de la dentelle et de grandes fraises empesées. A l'époque on tolère mal le penchant d'Henri III et de son entourage pour la fête et le goût pour l'apparence et on les accuse d'avoir dévergondé la cour avec leurs jeux pervers. Ces courtisans font donc aussi l'objet des railleries de la part du peuple qui, habitué à la virilité brute, considère le raffinement comme de la faiblesse. Et en ces temps troublés des Guerres de Religion, c'est à travers eux que s'exprime l'hostilité au roi. En 1577, un sonnet ironise ainsi sur les honneurs trop facilement acquis des mignons: "Saint Luc, petit qu'il est, commande bravement / A la troupe Hautefort, que sa bourse a conquise / Mais Caylus, dédaignant si pauvre marchandise / Ne trouve qu'en son cul tout son avancement."
Certes efféminés, ces "mignons" sont aussi des courageux guerriers, de fines lames qui affrontent régulièrement les adversaires du roi. Car le règne d'Henri III est celui des rivalités entre trois factions : le parti du roi, celui du duc de Guise et des Ligueurs et les Huguenots. Les guerres de religion ont été avant tout fomentées par ces partis. "Malgré la paix, la discorde régnoit partout, et surtout à la cour, le roi avoit ses mignons, Monsieur avoit ses braves, ceux-ci insultoient les mignons qui les persécutoient ; le roi haïssoit Monsieur... " .
Au printemps 1578, l'hostilité est à son comble contre les Mignons, qui ont eu l'outrecuidance de persuader le roi de retirer au duc de Guise la dignité de grand maître de France pour le donner à l'un d'entre eux, Jacques de Lévis, comte de Caylus. Et le 27 avril, un de ces duels va rester dans les mémoires par les récits qui en ont été fait dans la littérature : les mignons s'entretuent place des Vosges non loin du Louvre. Pourtant Henri III a tenté de réglementer le duel en promulguant, le 29 décembre 1576, l'édit de Blois, qui définit cette pratique comme crime de lèse-majesté. Mais l'usage du duel est si profondément ancré dans les mentalités et la noblesse y a si souvent recours pour "laver" son honneur qu'il n'a jamais fait appliquer cette loi...
En apparence, simple querelle amoureuse ! "un trait de jalousie que le Sieur de Quélus conceut contre Entraguet, le voyant sortir un samedy au soir de la chambre d'une Dame plus doüée de beauté que de chasteté. Et pour ce qu'elle estoit aimée d'un grand, Quélus luy dit comme en folastrant qu'il estoit un sot : l'autre luy respond de mesme, qu'il avojt menty. Là dessus il font complot de se battre" (Jean de La Taille, Discours notable des duels, de leur origine en France, et du malheur qui en arrive tous les jours au grand interest du public. Ensemble des moyens qu'il y auroit d'y pourvoir, 1607)
Mais cet événement traduit l'affrontement à distance entre le roi et le duc de Guise : "Sire, ce mal m'a esté faict pour l'amour de vous et pour avoir sostenu vostre honneur" aurai dit Caylus au roi avant de mourir. Il peut aussi être interprété comme le signe d'une compétition permanente entre les gentilshommes de la cour pour accéder aux faveurs du roi. Car en fait, le jeune Entraguet, qui fut lui aussi "mignon" du roi, est surtout alors en disgrâce, et c'est surtout par opportunisme politique que le duc de Guise va se souvenir que la maison de Balsac l'a précédemment servi...
Donc, le 26 au soir, Caylus, amoureux d'une dame, se rend chez elle et trouve devant sa porte Charles de Balzac, baron d'Entragues, surnommé "le bel Entraguet" et favori d'Henri de Guise. Querelle, insultes, provocations en duel, rendez-vous est pris pour régler l'affaire le lendemain, Porte St Antoine, au marché aux chevaux, près de la forteresse de la Bastille (actuelle place des Vosges).
Entragues a pour seconds Georges de Schomberg, dit Schomberg le Jeune, et le seigneur de Ribérac. Caylus est accompagné de Jean d'Arcès, seigneur de Livarot et de Louis de Maugiron, dit "le brave borgne" depuis qu'il a perdu un oeil au siège d'Issoire au printemps 1577.
Le combat est si furieux que Maugiron et Schomberg meurent sur place. Ribérac, très grièvement blessé, meurt le lendemain à l'hôtel de Guise. Livarot également est très sérieusement atteint et restera estropié à vie. Caylus, qui a reçu dix neuf coups d'épée, est transporté à l'hôtel de Boissy, où il va agoniser pendant un mois. Entraguet est le seul à ne recevoir q'une égratignure au bras.
 Alexandre Dumas père a immortalisé le duel dans "la Dame de Monsoreau":
Alexandre Dumas père a immortalisé le duel dans "la Dame de Monsoreau":
Le terrain sur lequel allait avoir lieu cette terrible rencontre était ombrage d'arbres, ainsi que nous l'avons vu, et situe a l'écart.
Il n'était fréquenté d'ordinaire que par les enfants, qui venaient y jouer le jour, ou les ivrognes et les voleurs, qui venaient y dormir la nuit.
Les barrières, dressées par les marchands de chevaux, écartaient naturellement la foule, qui, semblable aux flots d'une rivière, suit toujours un courant, et ne s'arrête ou ne revient qu'attirée par quelque remous.
Les passants longeaient cet espace et ne s'y arrêtaient point.
D'ailleurs, il était de trop bonne heure, et l'empressement général se portait vers la maison sanglante de Monsoreau.
Chicot, le coeur palpitant, bien qu'il ne fût pas fort tendre de sa nature, s'assit en avant des laquais et des pages sur une balustrade de bois.
Il n'aimait pas les Angevins, il détestait les mignons; mais les uns et les autres étaient de braves jeunes gens, et sous leur chair courait un sang généreux que bientôt on allait voir jaillir au grand jour.
D'Epernon voulut risquer une dernière fois la bravade.
- Quoi! On a donc bien peur de moi? s'écria-t-il.
- Taisez-vous, bavard! lui dit Antraguet.
- J'ai mon droit, répliqua d'Epernon; la partie fut liée à huit.
- Allons, au large! dit Ribérac impatiente en lui barrant le passage.
Il s'en revint avec des airs de tête superbes, et rengaina son épée.
- Venez, dit Chicot, venez, fleur des braves, sans quoi vous allez perdre encore une paire de souliers comme hier.
- Que dit ce maître fou?
- Je dis que tout à l'heure il y aura du sang par terre, et vous marcheriez dedans comme vous fîtes cette nuit.
D'Epernon devint blafard. Toute sa jactance tombait sous ce terrible reproche.
Il s'assit à dix pas de Chicot, qu'il ne regardait plus sans terreur.
Ribérac et Schomberg s'approchèrent après le salut d'usage.
Quélus et Antraguet, qui, depuis un instant déjà, étaient tombes en garde, engagèrent le fer en faisant un pas en avant.
Maugiron et Livarot, appuyés chacun sur une barrière, se guettaient en faisant des feintes sur place pour engager l'épée dans leur garde favorite.
Le combat commença comme cinq heures sonnaient à Saint-Paul.
La fureur était peinte sur les traits des combattants; mais leurs lèvres serrées, leur pâleur menaçante l'involontaire tremblement du poignet, indiquaient que cette fureur était maintenue par eux à force de prudence, et que, pareille à un cheval fougueux, elle ne s'échapperait point sans de grands ravages.
Il y eut durant plusieurs minutes, ce qui est un espace de temps énorme, un frottement d'épées qui n'était pas encore un cliquetis. Pas un coup ne fut porté.
Ribérac, fatigué ou plutôt satisfait d'avoir tâté son adversaire, baissa la main, et attendit un moment.
Schomberg fit deux pas rapides, et lui porta un coup qui fut le premier éclair sorti du nuage.
Ribérac fut frappé. Sa peau devint livide, et un jet de sang sortit de son épaule; il rompit pour se rendre compte à lui-même de sa blessure.
Schomberg voulut renouveler le coup; mais Ribérac releva son épée par une parade de prime, et lui porta un coup qui l'atteignit au coté.
Chacun avait sa blessure.
- Maintenant, reposons-nous quelques secondes, si vous voulez, dit Ribérac.
Cependant Quélus et Antraguet s'échauffaient de leur cote; mais Quélus, n'ayant pas de dague, avait un grand désavantage; il était oblige de parer avec son bras gauche, et, comme son bras était nu, chaque parade lui coûtait une blessure.
Sans être atteint grièvement, au bout de quelques secondes, il avait la main complètement ensanglantée.
Antraguet, au contraire, comprenant tout son avantage, et non moins habile que Quélus, parait avec une mesure extrême. Trois coups de riposte portèrent, et, sans être touche grièvement, le sang s'échappa de la poitrine de Quélus par trois blessures.
Mais, à chaque coup, Quélus répéta:
- Ce n'est rien.
Livarot et Maugiron en étaient toujours à la prudence.
Quant à Ribérac, furieux de douleur et sentant qu'il commençait à perdre ses forces avec son sang, il fondit sur Schomberg.
Schomberg ne recula pas d'un pas et se contenta de tendre son épée.
Les deux jeunes gens firent coup fourré.
Ribérac eut la poitrine traversée, et Schomberg fut blessé au cou.
Ribérac, blessé mortellement, porta la main gauche à sa plaie en se découvrant.
Schomberg en profita pour porter à Ribérac un second coup qui lui traversa les chairs.
Mais Ribérac, de sa main droite, saisit la main de son adversaire, et, de la gauche, lui enfonça dans la poitrine sa dague jusqu'à la coquille.
La lame aigue traversa le coeur.
Schomberg poussa un cri sourd et tomba sur le dos, entraînant avec lui Ribérac, toujours traversé par l'épée.
Livarot, voyant tomber son ami, fit un pas de retraite rapide et courut à lui, poursuivi par Maugiron. Il gagna plusieurs pas dans la course, et, aidant Ribérac dans les efforts qu'il faisait pour se débarrasser de l'épée de Schomberg, il lui arracha cette épée de la poitrine.
Mais alors, rejoint par Maugiron, force lui fut de se défendre avec le désavantage d'un terrain glissant, d'une garde mauvaise et du soleil dans les yeux.
Au bout d'une seconde, un coup d'estoc ouvrit la tête de Livarot, qui laissa échapper son épée et tomba sur les genoux.
Quélus était vivement serré par Antraguet. Maugiron se hâta de percer Livarot d'un coup de pointe. Livarot tomba tout a fait.
D'Epernon poussa un grand cri.
Quélus et Maugiron restaient contre le seul Antraguet. Quélus était tout sanglant, mais de blessures légères.
Maugiron était a peu près sauf.
Antraguet comprit le danger. Il n'avait pas reçu la moindre égratignure; mais il commençait à se sentir fatigué; ce était cependant pas le moment de demander trêve à un homme blessé et à un autre tout chaud de carnage. D'un coup de fouet il écarta violemment épée de Quélus, et, profitant de l'écartement du fer, il sauta légèrement par-dessus une barrière.
Quélus revint par un coup de taille, mais qui n'entama que le bois.
Mais, en ce moment, Maugiron attaqua Antraguet de flanc. Antraguet se retourna. Quélus profita du mouvement pour passer sous la barrière.
- Il est perdu, dit Chicot.
- Vive le roi! dit d'Epernon, hardi, mes lions, hardi!
- Monsieur, du silence, s'il vous plait, dit Antraguet; n'insultez pas un homme qui se battra jusqu'au dernier souffle.
- Et qui n'est pas encore mort! s'écria Livarot.
Et, au moment ou nul ne pensait plus à lui, hideux de la fange sanglante qui lui couvrait le corps, il se releva sur ses genoux et plongea sa dague entre les épaules de Maugiron, qui tomba comme une masse en soupirant:
- Jésus, mon Dieu! Je suis mort!
Livarot retomba évanoui; l'action et la colère avaient épuisé le reste de ses forces.
- Monsieur de Quélus, dit Antraguet, baissant son épée, vous êtes un homme brave, rendez-vous, je vous offre la vie.
- Et pourquoi me rendre? dit Quélus, suis-je à terre?
- Non; mais vous êtes criblé de coups, et moi, je suis sain et sauf.
- Vive le roi! Cria Quélus, j'ai encore mon épée, monsieur.
Et il se fendit sur Antraguet, qui para le coup, si rapide qu'il eut été.
- Non, monsieur, vous ne l'avez plus, dit Antraguet, saisissant à pleine main la lame près de la garde.
Et il tordit le bras de Quélus, qui lâcha épée
Seulement Antraguet se coupa légèrement un doigt de la main gauche.
- Oh! hurla Quélus, une épée! une épée!
Et, se lançant sur Antraguet d'un bond de tigre, il l'enveloppa de ses deux bras.
Antraguet se laissa prendre au corps, et, passant son épée dans sa main gauche et sa dague dans sa main droite, il se mit àa frapper sur Quélus sans relâche et partout, s'éclaboussant à chaque coup du sang de son ennemi, à qui rien ne pouvait faire lâcher prise, et qui criait à chaque blessure:
- Vive le roi!
Il réussit même à retenir la main qui le frappait, et à garrotter, comme eut fait un serpent, son ennemi intact entre ses jambes et ses bras.
Antraguet sentit que la respiration allait lui manquer.
En effet, il chancela et tomba.
Mais, en tombant, comme si tout le devait favoriser ce jour-la, il étouffa, pour ainsi dire, le malheureux Quélus
- Vive le roi! murmura ce dernier, à l'agonie.
Antraguet parvint à dégager sa poitrine de l'étreinte; il se raidit sur un bras, et, le frappant d'un dernier coup qui lui traversa la poitrine:
- Tiens, lui dit-il, es-tu content?
- Vive le r..., articula Quélus, les yeux à demi fermés.
Ce fut tout; le silence et la terreur de la mort régnaient sur le champ de bataille.
Antraguet se releva tout sanglant, mais du sang de son ennemi; il n'avait, comme nous l'avons dit, qu'une égratignure à la main.
D'Epernon, épouvanté, fit un signe de croix et prit la fuite, comme s'il eut été poursuivi par un spectre.
Antraguet jeta sur ses compagnons et ses ennemis, morts et mourants, le même regard qu'Horace dut jeter sur le champ de bataille qui décidait les destins de Rome.
Chicot secourut et releva Quélus, qui rendait son sang par dix-neuf blessures.
Le mouvement le ranima.
Il rouvrit les yeux.
- Antraguet, sur l'honneur, dit-il, je suis innocent de la mort de Bussy.
- Oh! Je vous crois, monsieur, fit Antraguet attendri, je vous crois.
- Fuyez, murmura Quélus, fuyez, le roi ne vous pardonnerait pas.
- Et moi, monsieur, je ne vous abandonnerai pas ainsi, dit Antraguet, dut l'échafaud me prendre.
- Sauvez-vous, jeune homme, dit Chicot, et ne tentez pas Dieu; vous vous sauvez par un miracle, n'en demandez pas deux le même jour.
Antraguet s'approcha de Ribérac, qui respirait encore.
- Eh bien? demanda celui-ci.
- Nous sommes vainqueurs, répondit Antraguet à voix basse pour ne pas offenser Quélus
- Merci, dit Ribérac. Va-t'en.
Et il retomba évanoui.
Antraguet ramassa sa propre épée, qu'il avait laissée tomber dans la lutte, puis celles de Quélus, de Schomberg et de Maugiron.
- Achevez-moi, monsieur, dit Quélus, ou laissez-moi mon épée
- La voici, monsieur le comte, dit Antraguet en la lui offrant avec un salut respectueux.
Une larme brilla aux yeux du blesse.
- Nous eussions pu être amis, murmura-t-il.
Antraguet lui tendit la main.
- Bien! fit Chicot; c'est on ne peut plus chevaleresque. Mais sauve-toi, Antraguet, tu es digne de vivre.
- Et mes compagnons? demanda le jeune homme.
- J'en aurai soin, comme des amis du roi.
Antraguet s'enveloppa du manteau que lui tendait son écuyer, afin que l'on ne vit pas le sang dont il était couvert, et, laissant les morts et les blessés au milieu des pages et des laquais, il disparut par la porte Saint-Antoine.
La perte de ses favoris préférés, Jacques de Caylus et Louis de Maugiron, laisse le roi en proie à une tristesse et à une douleur indicibles. Leurs funérailles sont celles réservées aux personnes de premier rang. Et leurs tombeaux, commandés par le roi à Germain Pilon, sont décrits comme des "tombeaux étincelants de marbre et de bronze, avec de merveilleuses statues de marbre". Sur celui de Caylus, cette épitaphe : Non injuriam, sed mortem, patienter tulit. Ces tombeaux seront saccagés quelques années plus tard par la vindicte populaire après l'assassinat des Guise.
Parce qu'il frappe directement l'entourage le plus intime du roi, mais surtout parce qu'il montre le fossé qui se creuse entre le roi et ses sujets, ce duel a rapidement un écho national et même international. Le petit peuple se réjouit de l'événement "c'est grand dommage/qu'on en a tué davantage" proclament des libellés abondamment diffusés dans le royaume. Au delà des victimes, c'est tout l'entourage du roi qui est malmené, comme dans une petite pièce commençant ainsi : "Vers semés après ce beau combat, qu'on titra du nom de courtisans, c'est-à-dire peu honnêtes, sales et vilains, à la mode de la cour".
Antraguet est, lui, accusé de venir se recueillir au pied des tombeaux de ses victimes, ce dont se moquent les pamphlets de l'époque Il n'est pas poursuivi par la justice parce que le souverain n'a pas intérêt à renforcer le mécontentement de ses adversaires, en particulier du duc de Guise qui revendique le statut de protecteur du meurtrier et qui affirme qu'il est prêt à le défendre l'épée au poing.
Malgré le désespoir du roi, il semble qu'Entraguet obtint grâce auprès du roi quelques temps après. .Il fut lieutenant général au gouvernement d'Orléans et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, enfin chevalier des ordres du roi et reçut le collier du Saint Esprit en 1595, à moins que ce ne soit son neveu, nommé comme lui Charles de Balsac.
En tous les cas, dans Henri III et sa cour, drame en 5 actes, en prose, Alexandre Dumas imagine un dialogue entre le roi et Entraguet :
Henri : "Approchez ici, baron, et fléchissez le genou...Charles Balzac d'Entragues, nous vous avons accordé la faveur de notre présence royale, au milieu de notre cour, pour vous rendre, là où nous vous les avions ôtés, vos dignités et vos titres...Relevez-vous, baron de Dunes, comte de Graville, gouverneur général de notre province d'Orléans, et reprenez près de notre personne royale les fonctions que vous y remplissiez autrefois...Relevez-vous"
D'entragues :"Non, sire,...je ne me relèverai pas, que Votre Majesté n'ait reconnu publiquement que ma conduite, dans ce funeste duel, a été celle d'un loyal et honorable cavalier"
Henri : "Oui,...nous le reconnaissons, car c'est la vérité...Mais vous avez porté des coups bien malheureux !"
D'entragues :"Et maintenant, sire ... votre main à baiser, comme gage de pardon et d'oubli
Henri : "Non, non Monsieur ne l'espérez pas
Catherine : "Mon fils que faites vous
Henri : "Non, Madame, non ... j'ai pu lui pardonner comme chrétien, le mal qu'il m'a fait ... mais je ne l'oublierai de ma vie
D'entragues :"Sire ... j'appelle le temps à mon secours; peut être ma fidélité et ma soumission finiront-elles par fléchir le courroux de Votre Majesté
José-Maria de Heredia, dans Les Trophée,s écrira plus tard en 1893 ce sonnet :
Épitaphe
Suivant les vers de Henri III
Ô passant, c'est ici que repose Hyacinte
Qui fut de son vivant seigneur de Maugiron ;
Il est mort - Dieu l'absolve et l'ait en son giron ! -
Tombé sur le terrain, il gît en terre sainte.
Nul, ni même Quélus, n'a mieux, de perles ceinte,
Porté la toque à plume ou la fraise à godron ;
Aussi vois-tu, sculpté par un nouveau Myron,
Dans ce marbre funèbre un morceau de jacinthe.
Après l'avoir baisé, fait tondre, et de sa main
Mis au linceul, Henry voulut qu'à Saint-Germain
Fût porté ce beau corps, hélas ! inerte et blême ;
Et jaloux qu'un tel deuil dure éternellement,
Il lui fit en l'église ériger cet emblème,
Des regrets d'Appolo triste et doux monument.
A lire : Nicolas Le Roux, La Faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers 1547-vers 1589), Seyssel, Champ Vallon, collection « Époques », 2001. C'est sur internet
05:57 Publié dans Histoire, litterature | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |